Par Brugerolles Julien, le 30 June 2018
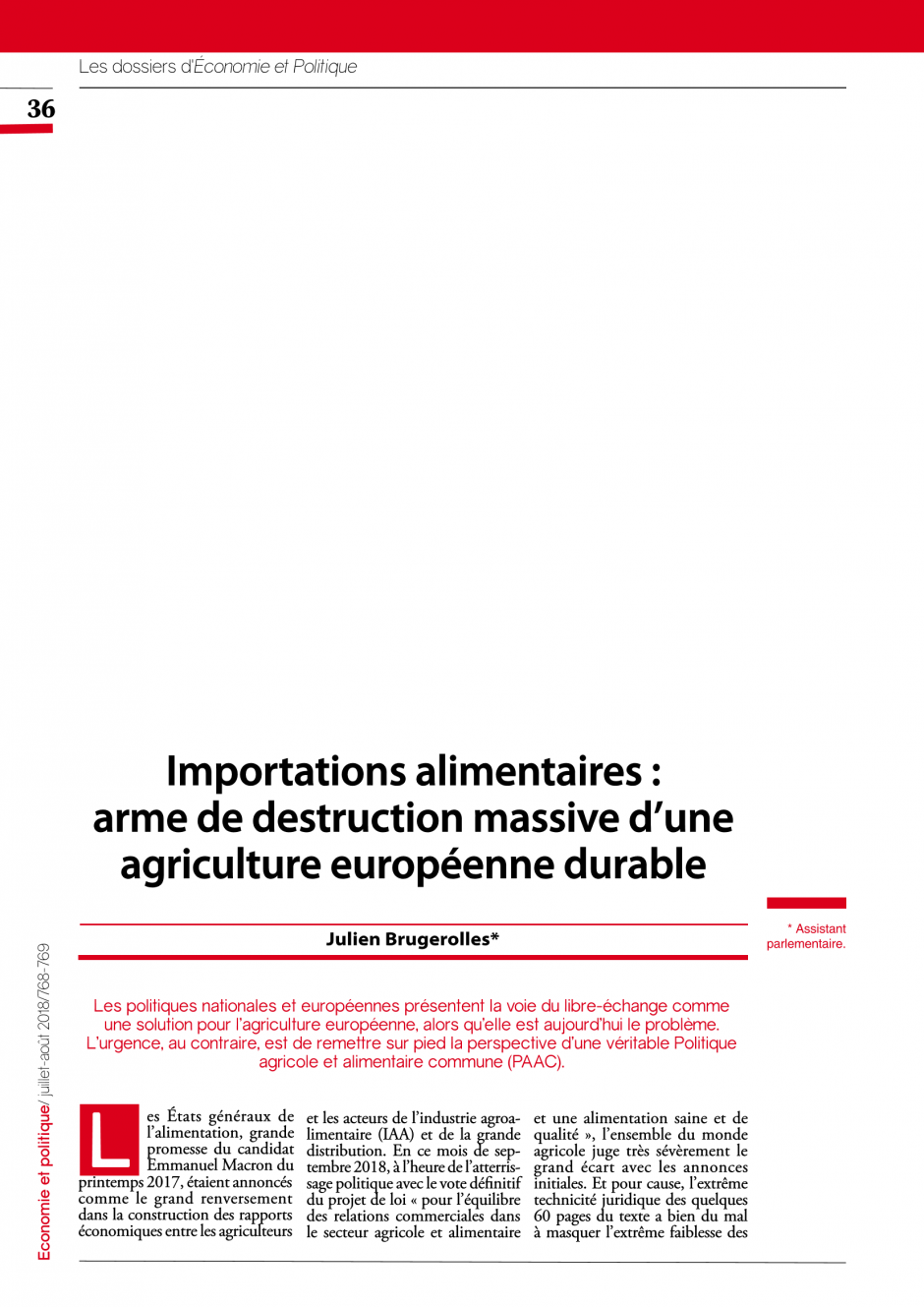
Les politiques nationales et européennes présentent la voie du libre-échange comme une solution pour l’agriculture européenne, alors qu’elle est aujourd’hui le problème.
L’urgence, au contraire, est de remettre sur pied la perspective d’une véritable Politique agricole et alimentaire commune (PAAC).
Les États généraux de l’alimentation, grande promesse du candidat Emmanuel Macron du printemps 2017, étaient annoncés comme le grand renversement dans la construction des rapports économiques entre les agriculteurs et les acteurs de l’industrie agroalimentaire (IAA) et de la grande distribution. En ce mois de septembre 2018, à l’heure de l’atterrissage politique avec le vote définitif du projet de loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et de qualité », l’ensemble du monde agricole juge très sévèrement le grand écart avec les annonces initiales. Et pour cause, l’extrême technicité juridique des quelques 60 pages du texte a bien du mal à masquer l’extrême faiblesse des outils et des moyens publics mis en place pour « renverser la logique de construction des prix ». En omettant volontairement d’agir sur les causes profondes des déséquilibres économiques et commerciaux du secteur agricole et alimentaire, il semble en effet bien difficile d’opérer la « révolution » tant promise. Car le déni de réalité porte avant tout un nom : la poursuite effrénée de l’ouverture du marché agricole européen.
L’analyse, même incomplète, des logiques de croissance des importations alimentaires qui résultent de ce choix politique assumé permet de mieux comprendre l’hypocrisie du discours politique porté par le pouvoir. Car les importations constituent aujourd’hui un des leviers majeurs – pour ne pas dire essentiel – des groupes transnationaux de l’industrie agroalimentaire et de la distribution pour assurer leurs stratégies de marges et de rentabilité financière. L’essentiel du travail de communication politique des derniers mois a ainsi consisté à entretenir l’illusion d’un volontarisme au service des producteurs qui s’opérerait sur la base d’une simple évolution du droit commercial interne, mais en occultant le fond du contenu des politiques économiques soutenues au niveau communautaire et international. Un grand écart que résumait fort bien le journaliste Gérard Le Puill dans L’Humanité du 24 mai 2018 sous la forme interrogative : « Peut-on promettre des prix rémunérateurs aux paysans et augmenter les importations ? »
Présentons donc d’abord quelques éléments de constat. Alors que la balance commerciale française poursuit sa dégradation globale (comme en témoignent les dernières données de juin 2018 des services des Douanes), le secteur agricole et agroalimentaire est toujours un moteur d’équilibre, troisième excédent commercial en valeur à 5,7 milliards d’euros en 2017. Mais le moteur tousse, et le fléchissement notable n’est pas dû à la perte de capacité exportatrice de la France (en hausse quasi constante à 60,4 milliards d’euros en 2017), mais bien à la très forte croissance parallèle des importations de produits agricoles et alimentaires à 54,8 milliards d’euros en valeur en 2017.
En 5 ans, la progression des importations en valeur approche les 9 milliards d’euros. L’analyse plus précise du contenu de ces importations permet aussi d’avoir une image assez précise des mécanismes économiques et commerciaux à l’œuvre. Cette croissance porte fortement sur les produits bruts. Non seulement la progression des importations de fruits s’accélère en particulier depuis 2010 pour atteindre les 4,5 milliards d’euros en 2015, mais le secteur des viandes et des abats, jusqu’alors plus épargné, progresse aujourd’hui aussi très fortement à 4,4 milliards d’euros en 2015 (dernières données AGRESTE). Au sein de la filière « viandes », l’exemple de l’évolution des importations de poulet, un des seuls marchés de la viande en progression en termes de consommation ces dernières années, est particulièrement démonstratif des stratégies financières de l’aval du secteur. Les volumes d’import ont quasiment triplé en 15 ans, de 188 000 tonnes par an en 2000, à près de 533 000 tonnes en 2015. Cette même année 2015, 43 % du poulet consommé n’était pas produit en France. Les viandes de volaille d’importation en restauration hors domicile représentaient 60 % de l’offre, et plus encore sur le segment du poulet standard (80 %). Pour des filières déjà historiquement très touchées comme la filière fruits et légumes, la part des importations dans la consommation annuelle est tout simplement sidérante : la France importe aujourd’hui 40 % de ses fruits et légumes.
Alors que notre pays compte tous les atouts et toutes les complémentarités agronomiques pour produire sur son propre territoire l’essentiel de ses fruits et légumes, pour élever ses poulets avec ses céréales, ces données révèlent l’ampleur de la réorientation économique à l’œuvre autour de la mise en application de stratégies très agressives d’importation par les grands opérateurs économiques nationaux et européens du secteur.
En surfant sur l’achat de produits agricoles à très bas prix, et par conséquent à très bas salaires, sans aucune exigence quant aux conditions sociales, environnementales et sanitaires, la guerre de « profitabilité » que mènent les grands groupes transnationaux s’appuie sur la conquête permanente de marges sur la transformation et la distribution. Et cette stratégie d’importation se construit sur deux pieds : une concurrence communautaire en l’absence d’harmonisation des conditions sociales et environnementales de production au sein de l’UE, et une concurrence extra communautaire avec le déploiement récent de nouveaux accords de libre-échange. Les taux de marge élevés sur ces produits importés, permettent également le déploiement de toute une panoplie d’outils marketing, depuis la simple promotion ponctuelle jusqu’à la construction d’allégations qualitatives trompeuses. Qui n’a pas été au moins une fois dupé par ces linéaires de conserves de haricots verts « extra-fins » et « rangés à la main », mais tous produits et transformés à Madagascar ou au Kenya ? Qui n’achète pas au quotidien ces cornichons « tendres » et « extra-fins » dont la production a été quasiment intégralement délocalisée en Chine et en Inde au début des années 2000 ?
L’extension de cette seule logique de rentabilité dans le secteur alimentaire a été encouragée par des choix politiques nationaux et européens très forts ces 15 dernières années. En France, la loi « Chatel » et la loi de modernisation de l’économie (dite LME) de 2008, directement inspirée des travaux de la Commission Attali « pour le libération de la croissance française » dont un des rapporteurs n’était autre qu’Emmanuel Macron, ont servi d’appui pour accentuer la pression sur les fournisseurs dans les négociations commerciales. Réforme de la PAC après réforme de la PAC, l’ouverture aux marchés mondiaux de toutes les productions avec l’abandon progressif de l’ensemble des outils de gestion des volumes et d’intervention sur le marché européen a clairement fait le lit de rapports de force toujours plus déséquilibrés pour les producteurs nationaux.
Aujourd’hui, la conduite de négociations d’accords de libre-échange bilatéraux de l’UE avec près d’une douzaine de pays dans le monde est une nouvelle étape dans l’ouverture aux importations au service des transnationales des IAA et de la distribution. En tant qu’accords globaux, le secteur agricole y est clairement marginalisé, et utilisé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne (DG Commerce), en charge des négociations, prioritairement comme une monnaie d’échange permettant l’ouverture commerciale aux autres secteurs. Le Commissaire européen à l’agriculture, Phil Hogan, auditionné le 10 octobre 2017 par l’Assemblée nationale sur les conséquences du traité de libre-échange avec le Canada (CETA), en convenait d’ailleurs très librement en ces termes : « il faut faire des compromis et des concessions en matière agricole pour que les secteurs financiers et industriels, créateurs d’emplois en France comme ailleurs en Europe, bénéficient également de ces accords. » De quoi justifier sans rechigner l’arrivée sans droits de douanes de 50 000 tonnes supplémentaires de viandes bovines canadiennes d’animaux engraissées aux farines animales et aux antibiotiques et de 100 000 tonnes supplémentaires, essentiellement d’origine brésilienne, dans le cadre de l’accord avec les pays du MERCOSUR à l’heure des scandales sanitaires sur des viandes avariées écoulées sur le marché mondial. Et que dire de l’ouverture des négociations avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, deux pays qui ont déjà inondé le marché de la viande ovine en Europe ces vingt dernières années, mais qui ne manqueront pas de faire valoir leurs nouveaux intérêts.
L’ouverture tous azimuts aux importations d’un secteur qui répond à un besoin fondamental de l’humanité est révélatrice de la pression accrue du capital sur l’ensemble de l’économie européenne. Cette pression se fait au mépris de toutes les conséquences alimentaires, sociales, territoriales, économiques, écologiques et climatiques de ces orientations. L’essentiel des « coûts » réels de cette fuite en avant vers la dépendance alimentaire européenne sont cachés. Qu’il s’agisse de la dégradation de la qualité gustative, nutritionnelle et sanitaire des produits, du glissement vers des modes de consommation défavorables à la santé, du soutien à des modes de production construits sur la spécialisation, l’intensification et l’utilisation massive d’intrants, de l’encouragement actif au changement d’affectation des sols avec la déforestation et ses effets multiplicateurs sur les émissions de CO2, de la remise en cause à large échelle des surfaces d’agriculture vivrière dans les pays du Sud, de l’accaparement des terres et de la spéculation foncière… difficile de trouver les traces d’une évaluation sérieuse et publique de ces impacts dans la littérature libérale de la Commission !
Et quand bien même une analyse d’impact est instruite, comme pour les accords de libre-échange en cours de négociation, elle se limite à la classique (et très contestable) expertise « coûts/avantages » sur la balance commerciale des filières. Comme le souligne le dernier rapport d’information « pour une agriculture durable pour l’Union européenne » présenté le 31 mai 2018 par les députés André Chassaigne et Alexandre Freschi devant la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale, la DG Agriculture de la Commission européenne a bien rendu publique une étude « sur l’impact économique cumulé » des (12) futurs accords commerciaux sur l’agriculture européenne d’ici 2025. Ses conclusions avancent non seulement un impact négatif pour l’essentiel des filières, en particulier pour les viandes bovines et ovines, mais surtout elles ne font jamais le lien direct avec sa traduction sur la réalité humaine, sociale, économique, territoriale et environnementale.
Contrairement à l’image de « réalisme économique » si souvent véhiculée, on n’importe pas seulement des « produits agricoles », on délocalise surtout à bon compte l’ensemble des facteurs de production, tout en déstructurant des systèmes agricoles historiquement construits et qui peuvent être par ailleurs soutenus par des politiques publiques comme la PAC. Pour donner une illustration parmi d’autres de ces implications, une estimation reprise notamment par le think tank Momagri évaluait en 2008 à 35 millions d’hectares de terres agricoles l’équivalent en termes de surfaces de production des importations agricoles de l’UE. Ces « terres virtuelles » représentaient alors 35 % de l’ensemble de la surface agricole utile européenne. Où en sommes-nous 10 ans plus tard ?
En faisant le choix de valoriser sur le marché européen des productions importées, en substitution de productions européennes, l’UE porte atteinte délibérément à l’ensemble de l’agriculture communautaire, aux principes fondateurs de la PAC et à toute ambition de transition agricole et alimentaire vers des systèmes durables, créateurs de richesse et d’emplois pérennes.
L’urgence est à remettre sur pied la perspective d’une véritable Politique agricole et alimentaire commune (PAAC), au moment où la voie du libre-échange est poussée comme une solution alors qu’elle est aujourd’hui le problème. Cela implique une première rupture politique à conquérir aux côtés des actifs agricoles, de leurs représentants syndicaux et des citoyens européens : la reconnaissance d’une exception agricole, d’une exclusion du secteur agricole des accords de libre-échange et l’indispensable besoin d’une coopération basée sur des objectifs communs et partagés. Tandis que l’horizon qui se dégage des propositions de la Commission européenne pour la PAC 2020-2025 est celui d’une renationalisation marquée des politiques agricoles, le premier risque est de voir s’amplifier encore les concurrences intracommunautaires, et la fuite en avant des États vers des politiques de « compétitivité » toujours plus agressives, poussés qu’ils sont en cela par leurs champions nationaux du secteur.
Cette conquête d’une vision commune se doit d’éviter l’écueil des raccourcis et des simples injonctions au regard de la situation réelle de l’agriculture européenne comme nationale, et de la dégradation marquée et continue des agro-systèmes à l’échelle mondiale. Elle est indispensable pour progresser vers d’autres avancées telles que l’harmonisation des normes sanitaires et environnementales et la lutte pour une protection sociale de haut niveau pour tous les travailleurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
Bien entendu, et de façon complémentaire, notre projet de PAAC doit aussi pouvoir s’articuler autour de propositions plus concrètes et spécifiques : le maintien d›un budget fort et solidaire, la réorientation du premier pilier au profit d’un soutien à l›actif, à l’installation et à la montée en gamme des productions, le retour de mécanismes de régulation des volumes et des marchés, la définition de nouveaux outils en faveur de garanties de revenus, des soutiens spécifiques à l’échelle européenne pour le transfert des pratiques agricoles durables sur chaque type de production.
le 30 June 2018
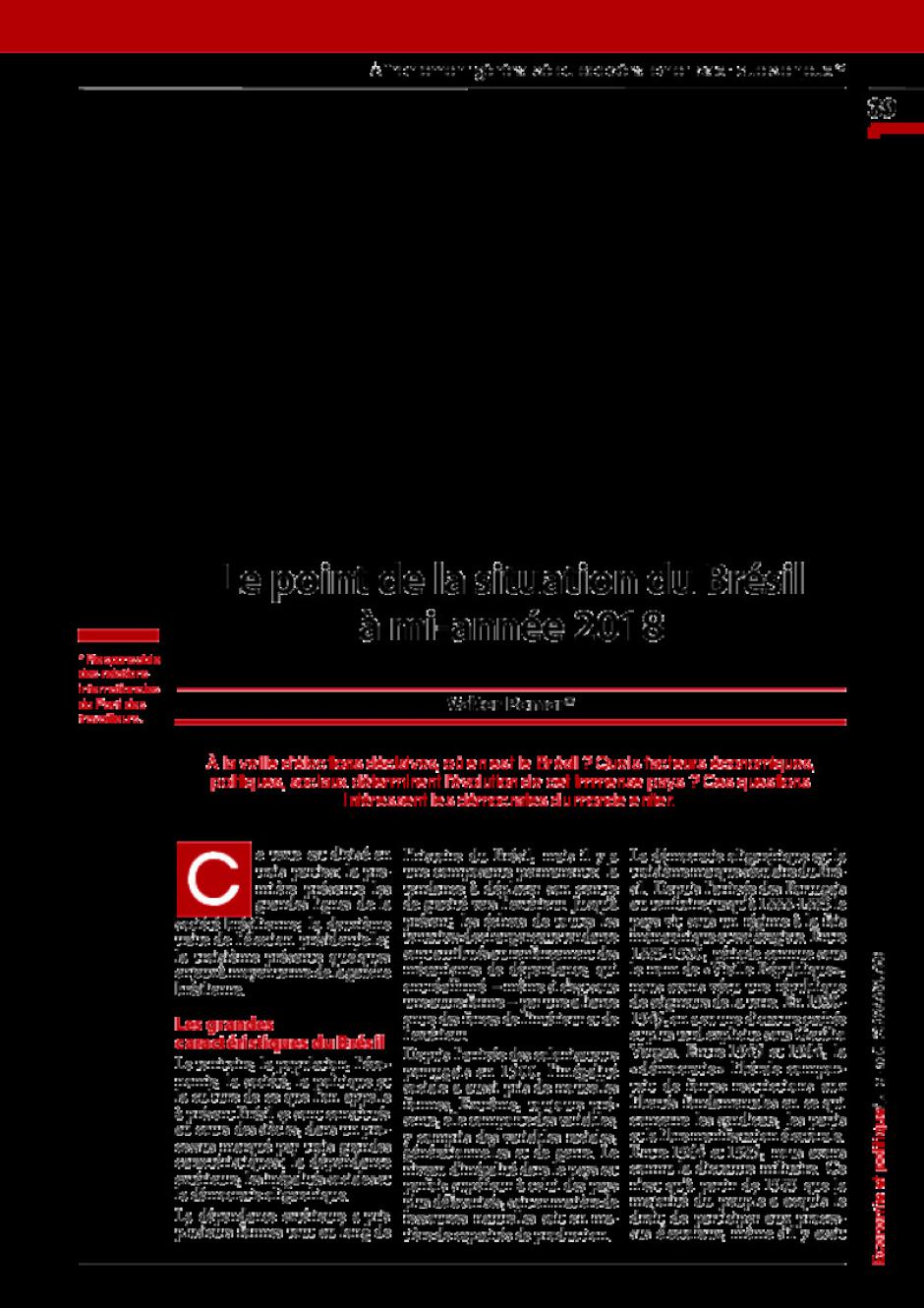
Ce texte est divisé en trois parties : la première présente les grandes lignes de la société brésilienne ; la deuxième traite de l’élection présidentielle ; la troisième présente quelques enjeux à moyen terme de la gauche brésilienne.
Le territoire, la population, l’économie, la société, la politique et la culture de ce que l’on appelle à présent Brésil se sont constitués au cours des siècles, dans un processus marqué par trois grandes caractéristiques : la dépendance extérieure, les inégalités sociales et la démocratie oligarchique.
La dépendance extérieure a pris plusieurs formes tout au long de l’histoire du Brésil, mais il y a une composante permanente : la tendance à déplacer son centre de gravité vers l’extérieur. Jusqu’à présent, les échecs de toutes les tentatives de changer cette tendance sont attribués au renforcement des mécanismes de dépendance, qui ont réaffirmé – même si c’est sous une autre forme – par une alliance entre des forces de l’intérieur et de l’extérieur.
Depuis l’arrivée des colonisateurs portugais en 1500, l’inégalité sociale a aussi pris de nouvelles formes. Extrême, toujours présente, elle comporte des variables, y compris des variables raciales, générationnelles et de genre. Le niveau d’inégalité dans le pays est parfois supérieur à celui des pays plus défavorisés, soit en matière de ressources naturelles soit en matière de capacités de production.
La démocratie oligarchique est la troisième marque séculaire du Brésil. Depuis l’arrivée des Portugais au territoire jusqu’à 1888-1889 le pays vit sous un régime à la fois monarchique et esclavagiste. Entre 1889-1930, période connue sous le nom de « Vieille République », nous avons vécu une république de seigneurs de la terre. En 1930-1945, on a eu une dictature cachée et plus tard explicite sous Getúlio Vargas. Entre 1945 et 1964, la « démocratie » libérale comportait de fortes restrictions aux libertés fondamentales en ce qui concerne les syndicats, les partis et la libre manifestation électorale. Entre 1964 et 1985, nous avons connu la dictature militaire. Ce n’est qu’à partir de 1989 que la majorité du peuple a acquis le droit de participer aux processus électoraux, même s’il y avait des contraintes de l’influence de l’argent, de l’oligopole des médias et des règles électorales qui tordent de système de représentation proportionnelle.
La dépendance extérieure, les inégalités sociales et la démocratie oligarchique sont à l’origine des principales caractéristiques, contrastes et contradictions de la société brésilienne.
Ces caractéristiques incluent un modèle de développement qui est par défaut prisonnier de ces trois marques que nous venons de décrire. Ayant une nature limitée, il n’arrive pas à passer la barrière, il semble toujours progresser peu si l’on considère les possibilités et potentialités du pays. Il nous semble aussi qu’il s’agit d’un phénomène cyclique, c’est-à-dire qu’il retourne toujours au point de départ, plus précisément à cause des certains enjeux et obstacles. Au cours de 517 années nous avons crû beaucoup mais, par contre, développé peu.
En deux moments de l’histoire récente, la société brésilienne semblait commencer à surmonter son modèle standard de développement : depuis les années 1930 et 2003.
Depuis 1930, l’urbanisation, l’industrialisation, le renforcement de l’État, les transformations sociales, politiques et culturelles ont pris des dimensions importantes. Cependant, le cycle de développement démarré par la Révolution de 1930 a atteint son point culminant autour des années 1980. À la fin de cette décennie, la classe dominante du pays a choisi le chemin des réformes néolibérales entraînant, dans les années 1990, la fin d’une partie importante du progrès accompli dans les décennies précédentes et renforçant les grandes caractéristiques de l’histoire nationale.
Dès le début, la classe dominante brésilienne a été un partenaire minoritaire des classes dominantes des métropoles, qu’elles soient ibériques, anglaise ou américaine. Il est important de noter que choisir de faire face aux métropoles demanderait de sa part une alliance solide avec les autres couches de la population. En contrepartie, cette alliance devrait se traduire en réforme agraire, en salaires plus élevés, en politiques sociales effectivement universelles avec la participation démocratique des habitants aux affaires du pays. La conséquence de ces mesures, mises en place, ensemble ou séparément, serait la réduction des profits et du statut de la classe dominante. Voilà pourquoi elle a non seulement un rapport de complaisance, mais aussi de protection et reproduction de la dépendance extérieure, des inégalités sociales, de la démocratie oligarchique et d’adhésion à des politiques de développement limité.
C’est quand Luís Inácio Lula da Silva (Lula) entre en fonction, le 1er janvier 2003, qu’a lieu la deuxième tentative de surmonter le développement limité standard. Parmi les partis et les mouvements de la gauche brésilienne, le débat est intense sur les réussites et les contraintes de cette tentative conduite par Lula et le Parti des travailleurs (PT). De toute façon, quelles que soient les réussites et les erreurs de cette tentative sous les gouvernements du PT, la crise financière internationale de 2008, ou, plus précisément, les effets des démarches des États-Unis pour surmonter la crise, ont provoqué un changement d’attitude de la classe dominante brésilienne face au PT et à ses gouvernements. Finalement, en 2016, après le coup d’État contre la présidente Dilma Rousseff, les forces adeptes des politiques néolibérales ont mis en place une reconquête totale du gouvernement et, depuis lors, elles ont détruit tout qui a été construit depuis 2003 en démolissant des aspects positifs de la Constitution fédérale de 1988 et notamment en remettant en cause des conquêtes des années 1950 (comme la compagnie pétrolière nationale Petrobras) et des années 1930 (comme la Consolidation des lois du travail).
Un nombre croissant de défavorisés errant dans les centres-villes, la violence policière contre les jeunes noirs « périphériques », les explosions du système carcéral, la croissance du machisme et de l’homophobie, le discours fasciste sur les réseaux sociaux, ce sont des effets collatéraux du renforcement du néolibéralisme et, parallèlement, il y a l’approfondissement de la dépendance extérieure, des inégalités sociales et des restrictions aux libertés démocratiques.
Dans un pays marqué par des inégalités importantes comme le Brésil, la possibilité d’occuper des terres en friche – même si elles sont situées loin des grandes villes –, les hauts taux de croissance économique, les politiques sociales et la participation démocratique – même limités – ont constitué une soupape pour les tensions sociales accumulées. L’action du néolibéralisme dans les années 1990 et la reprise néolibérale à présent, depuis 2016, associés à un cadre international croissant de crise et polarisation, instaurent un environnement politique et social explosif.
En arrière-plan de la défaite de la gauche brésilienne, notamment du PT, face au coup d’État de 2016 et depuis lors, on trouve trois déplacements de classe importants :
a. Entre 2003 et 2005, la gauche a perdu le soutien et voit monter l’opposition progressive d’une grande partie des classes moyennes. Jusqu’à 2002, elles ont eu une trajectoire de soutien croissant au PT et ses candidatures. Quelle est la cause de ce changement de position ? L’une des causes de fond est que la politique du parti visant à améliorer les conditions de vie des pauvres sans toucher aux profits des riches les a affectées du point de vue matériel et idéologique.
b. Entre 2011 et 2014, on voit la poussée de l’opposition totale du secteur des plus grands capitalistes contre la gauche brésilienne. Entre 2003 et 2010 le grand capital a adopté une combinaison de tactiques : stimuler certaines politiques du gouvernement, s’opposant au piétisme et soutenant principalement les candidatures du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB, droite) et d’autres partis similaires. Pourquoi ce changement de position ? L’une des causes de fond est la suivante : l’un des effets collatéraux de la crise de 2008 a été la disparition des possibilités offertes par les affaires internationales, qui a poussé la classe capitaliste brésilienne à revenir à son fonctionnement normal consistant à surexploiter la classe ouvrière et à livrer les ressources nationales à des intérêts étrangers. C’était incompatible avec la présence du PT à la tête du gouvernement d’État.
c. Notamment en 2015, la gauche brésilienne a perdu le soutien d’une partie importante de la classe ouvrière, recevant plutôt son indifférence. Le tournant s’est produit vers la fin 2014-début 2015 quand la présidente Dilma Rousseff a mis en place un projet d’ajustement fiscal occasionnant des dégâts matériels immédiats pour la classe ouvrière.
Dans les élections présidentielles de 2006, 2010 et 2014, la gauche brésilienne avait réussi à affronter et à vaincre l’alliance entre les classes moyennes et le grand capital. Cela n’a pas été possible en 2015-2016 essentiellement en raison de la perte du soutien de la majorité de la classe ouvrière.
La classe dominante et ses alliés étaient impliqués dans le coup d’État parlementaire, médiatique et judiciaire de 2016, qui visait les objectifs suivants :
a. Réduire les salaires et les cotisations sociales, ainsi que supprimer des libertés démocratiques de la classe ouvrière.
b. Aligner notre politique extérieure sur celle des États-Unis et leurs alliés.
c. Rétablir la position de la gauche brésilienne en tant que force minoritaire ou équipe de soutien d’une partie de la classe capitaliste contre l’autre, comme avant 1980, rendant toute alternative de gauche au gouvernement et toute transformation en alternative de pouvoir impossible.
Depuis le coup d’État de 2016, plusieurs mesures ont été prises pour mettre en œuvre ces objectifs, parmi lesquels la réforme du Code du travail, qui supprime les droits de la classe ouvrière ; la révision de la politique nationale pétrolière, afin de servir les intérêts des multinationales de ce secteur.
Pour réussir ces objectifs à moyen terme, les putschistes doivent remporter les élections qui auront lieu en octobre 2018.
Dans les premiers mois de 2016, le coup d’État a obtenu un certain succès et un soutien populaire, constaté non seulement sur la base de sondages d’opinion, mais aussi sur les résultats obtenus par les partis putschistes aux élections municipales. Cependant, aujourd’hui la popularité du gouvernement putschiste est anémique, contaminant la plupart des candidatures présidentielles liées au coup d’État.
En ce moment il y a 13 candidatures à la présidence de la République. De ce nombre, quatre demandes ont été formulées par les partis qui se sont opposés au coup d’État de 2016. Les autres 9 précandidatures ont été lancées par les partis qui ont soutenu le coup d’État de 2016.
Jusqu’à présent, le capitaine Jair Bolsonaro – défenseur de positions d’extrême droite – est le seul candidat putschiste qui révèle un stock suffisant de voix pour passer au deuxième tour.
Lula était en tête de tous les candidats dans tous les sondages, avec plus d’intention de vote que tous les autres candidats ensemble mais sa candidature a été bloquée par voie judiciaire le 11 septembre. Fernando Haddad a été désigné à sa place comme candidat du PT avec comme colistière Manuela D’Avila du Parti communiste du Brésil (PCdoB). Depuis cette date, deux évolutions majeures se sont produites. La première est le report en faveur de Haddad des intentions de votes précédemment favorables à Lula. La deuxième évolution est une consolidation des intentions de vote pour Bolsonaro. La tendance actuelle fait envisager un deuxième tour entre Bolsonaro et Haddad, dont Haddad sortirait victorieux.
Ce serait une catastrophe pour les putschistes car leur problème, ce n’est pas Lula, c’est le PT et la gauche. Que peuvent-ils faire pour l’empêcher ? En ce qui concerne les alternatives électorales (étant donné qu’une partie d’entre eux n’exclut pas des alternatives non électorales, c’est-à-dire un coup d’État militaire), il existe trois possibilités : a) écarter Bolsonaro du deuxième tour (par quelque conspiration) et mettre en avant un candidat plus acceptable ; b) soutenir Bolsonaro à fond, en négociant des garanties telles que l’autonomie de la Banque centrale et le parlementarisme ; c) effectuer des opérations extraordinaires pour essayer d’empêcher Haddad et le PT d’atteindre le deuxième tour en faisant émerger un candidat « modéré », ce qui semble difficile au vu des sondages actuels.
En outre, actuellement un grand pourcentage d’électeurs n’ont pas encore pris leur décision. Mais il y a des signes qui nous indiquent qu’un bon nombre d’entre eux doit pencher pour les votes blancs, nuls et l’abstention. Les autres doivent se répartir entre les candidatures principales. Par conséquent, la polarisation entre Lula et Bolsonaro peut se maintenir dominante jusqu’à la fin de la campagne électorale.
Ce n’est pas en se rapprochant du centre que la gauche peut réussir à faire barrage à l’extrême droite mais en démasquant le programme socio-économique de Bolsonaro et en mettant en avant son propre programme et les mesures d’urgence qu’elle propose pour gagner au vote Haddad l’électorat populaire.
La profondeur de la crise brésilienne indique deux possibilités : une rupture conservatrice et une rupture populaire.
Les forces putschistes s’orientent vers une rupture conservatrice, dont l’expression extrême serait la dictature. Les actions des putschistes sont déjà à la limite de la légalité, comme l’a démontré un épisode récent où Lula a été maintenu en détention malgré l’octroi de la demande d’habeas corpus ; les aspects démocratiques et sociaux de la Constitution de 1988 ont été supprimés ; les militaires sont déjà convoqués pour prendre des postes et des tâches autrefois réservés aux civils.
Cependant, une rupture conservatrice demanderait une intervention militaire explicite, ce qui jusqu’à présent n’est pas souhaitable pour les dirigeants militaires. À cause des possibles effets collatéraux dans le cadre international et national, le grand capital hésite à toucher à cette question.
D’ailleurs, une rupture populaire demanderait une lutte populaire à croissance exponentielle, associée à une victoire électorale massive de la gauche en 2018, permettant au gouvernement élu d’annuler les mesures adoptées par les putschistes depuis la destitution de la présidente Dilma ; de mettre en place un « plan d’urgence » ; convoquer une Assemblée constituante ; faire débuter un cycle de réformes structurelles. En même temps, il faut réunir des forces pour défaire la réaction des capitalistes et de leurs alliés.
Les conditions pour un tournant dans notre conjoncture ne sont pas encore visibles, mais elles pourraient éventuellement se produire. Ainsi, on estime que la situation politique brésilienne continuera d’être instable en dépit des résultats des élections, en octobre 2018, à la présidence, des gouverneurs des États, du Congrès national, des Chambres de députés des États.
Dans ce contexte, les forces de gauche visent à :
a. Retrouver la capacité de mobilisation et de soutien organisé auprès de la classe ouvrière.
b. Garder la classe ouvrière et la gauche comme pôles protagonistes indépendants, empêchant qu’elles retournent au poste d’équipe de soutien dans la dispute entre deux secteurs de la bourgeoisie, tout en gardant les groupes démocratiques et populaires comme alternatives au gouvernement, cherchant sa conversion en alternative de pouvoir.
De ce point de vue, il paraît important de penser que le futur de 2018 c’est aussi le futur du PT.
Depuis 1989 il y a des secteurs qui ont rompu les liens avec le parti pour construire des alternatives de gauche. Toutes leurs tentatives de supplanter le PT ont finalement échoué. Le PT risque d’être détruit à cause de ses erreurs, combinées aux attaques de la droite. Si cette situation se concrétise, on aura pour des décennies le retour d’une gauche du modèle que l’on avait principalement avant les années 1980 : marginale et subordonnée à un secteur de la classe dominante, sans constituer une alternative de gouvernement ou sans accéder au pouvoir.
Ainsi, la survie et le renforcement du PT sont de l’intérêt de l’ensemble de la gauche. Il y a plusieurs signes indiquant la survie du parti, parmi lesquels le résultat des sondages : le PT est le parti le plus populaire du pays ayant un soutien cinq fois supérieur à celui de son concurrent.
Néanmoins, il y a aussi des indices défavorables. Parmi eux, le principal est la difficulté d’une grande partie du PT de traduire en mesures concrètes le fait que la lutte des classes est passée à un autre niveau, à cause des actions du grand capital.
Désormais, l’ensemble de la gauche devrait surmonter des défis extrêmes comparables à ceux de la période 1990-2002. Parmi eux, élaborer et soutenir un nouveau projet de développement – orienté vers la fin de la dépendance extérieure, des inégalités sociales, de la démocratie oligarchique et impliquant non seulement des réformes structurelles combinées à des politiques publiques, mais aussi avec la lutte directe pour le socialisme.
Ces reformes incluent : la réforme fiscale, la réforme financière, la réforme agraire, la souveraineté énergétique, la constitution de l’État-providence, la garantie et l’élargissement des droits civils, la réforme politique, la démocratisation des médias, la réforme du système juridique et du système de sécurité.
L’ensemble de ces réformes doit se traduire, fusionner et se matérialiser dans un ensemble de politiques publiques. Du coup, la réussite de ces réformes et des politiques publiques dépend du moteur économique du Brésil, principalement en ce qui concerne les points suivants :
a. L’adaptation de la production de biens et services à la demande sociale actuelle et à la croissance de la population tout en tenant en compte ses besoins.
b. L’objectif d’avoir des taux de croissance et de productivité capables d’absorber la masse de chômeurs et de nouveaux entrants sur le marché de travail.
c. La rémunération pécuniaire directe (salaires et pensions) et la rémunération pécuniaire indirecte (l’offre de services publics) permettant aux personnes en activité et en retraite d’avoir une meilleure qualité de vie de façon continue.
d. Une capacité de production qui, au fil du temps, soit analogue aux niveaux des moyens de production des pays les plus développés.
Le Brésil n’est pas condamné pour toujours à être exportateur des produits du secteur primaire et importateur de produits industriels. Pour changer ce cadre, il nous faut un nouveau processus de « substitution d’importations » basé sur l’association de l’élargissement du marché des produits de consommation de masse avec le développement d’un grand marché de biens d’équipement.
Il sera également nécessaire de mettre en place un ensemble d’actions afin d’articuler : a) la dévaluation du real face au dollar ; b) la réduction des taux d’intérêt en adéquation avec l’investissement productif ; c) la taxation du capital spéculatif et d’autres mesures pour garantir la qualité de l’investissement étranger ; d) la taxation des importations ; e) la réduction du service de la dette pour garantir l’extension de la capacité d’investissement de l’État ; f) l’élaboration d’un programme d’investissement public dans les infrastructures.
Il s’agit d’investir lourdement dans le transport collectif en zone urbaine ; dans l’infrastructure urbaine ; dans le transport ferroviaire ; dans les transports par voie navigable ; dans le logement social et tous les services publics qui touchent cette question, notamment l’assainissement .
Ces investissements publics constituent un investissement social, l’extension de l’offre et de la qualité des biens publics tout en ayant comme grand objectif la reconstruction d’une industrie solide et technologiquement avancée.
Ainsi, le but principal de la réindustrialisation n’est pas l’offre des biens de consommation individuelle, mais plutôt l’extension de l’offre et de la qualité des biens d’usage collectifs, comme les navires, les trains, les métros, les autobus, et pas majoritairement en faveur du transport individuel.
Il faut souligner que l’extension de la capacité de consommation de la population étendra aussi le marché de consommation de masse des biens privés. L’ensemble des millions de Brésiliens et Brésiliennes a le droit de consommer plus. Il faut donc associer l’offre des biens de consommation publics à celle des biens privés.
Évidemment, ces mesures se heurtent aux intérêts des oligopoles privés, dont beaucoup sont des entreprises transnationales ayant le contrôle sur les chaînes de productions. Ce sont de grands importateurs et des producteurs de biens de consommation de masse qui ne sont pas intéressés à l’expansion de la production nationale.
Cela veut dire aussi un choc contre les idées préconçues d’une partie de la population, qui confond systématiquement le bien-être avec l’extension de la consommation des biens privés.
Pour réussir ce développement en tenant compte des dimensions qu’on vient de présenter, il nous faut une autre organisation politique et un État fort, capable de concevoir et faire prévaloir les intérêts collectifs sur des intérêts individuels, les intérêts de la majorité de la population sur ceux de la minorité, les intérêts nationaux sur les intérêts internationaux. Un État capable de construire un secteur financier national qui atteigne l’objectif d’être 100 % public, conjugué à un grand nombre de banques des États, municipalités, et aussi des banques privées et/ou coopératives. Une telle dynamique ne sera pas le résultat de la « libre concurrence » entre les entreprises privées ou du « libre marché » international, surtout dans la conjoncture mondiale.
Bref, c’est à la gauche de développer au niveau pratique et théorique une alternative d’avenir visant à affronter et surmonter les trois grandes caractéristiques de la trajectoire du pays.
Il nous faut une tentative dont le résultat soit un pays souverain au plan national, avec la démocratie politique, l’égalité sociale et le développement durable.
Il nous faut un projet de développement intégrant les divers aspects de la société brésilienne tout en s’orientant vers la construction d’un pays où l’ensemble de la classe ouvrière obtient un niveau élevé de vie matérielle, culturelle et politique. Les conditions historiques effectives du Brésil indiquent que pour atteindre ces objectifs il faut une organisation économiquement, socialement et politiquement socialiste.
La quête de ces objectifs aura plus de chances de réussite si cette organisation est mise en place de façon intégrée avec les autres pays de l’Amérique latine et les Caraïbes, tout en conservant un certain degré de coopération entre les pays des BRICS.
L’Amérique latine et les Caraïbes ont été victimes au cours des années 1960 et 90 des gouvernements dictatoriaux et néolibéraux. Depuis 1998 un cycle de gouvernements progressistes à gauche a été enclenché. Malgré leurs faiblesses et différences, ce changement a présenté des résultats positifs : expansion du bien-être social et de l’égalité sociale, des libertés démocratiques, de la souveraineté nationale et de l’intégration régionale.
C’est depuis la crise de 2008 et à cause de ses effets, de l’action du gouvernement des États-Unis, de l’opposition de la droite, ajoutée aux erreurs et contraintes des expériences « progressistes de gauche », que s’et engagé ce cycle d’attaques réactionnaires. Ils ont vaincu les gouvernements progressistes de gauche de la région ou les ont mis en garde, ainsi que les forces sociales et partisanes liées aux ouvriers.
Jusqu’à la crise internationale de 2008 les gouvernements progressistes à gauche ont réussi à gérer leurs limites, contradictions et fautes. Cependant, depuis la crise de 2008, la dégradation des prix des produits de base, la dépendance financière et commerciale, la force des oligopoles – surtout étrangers – et la faiblesse de l’État rendent la situation très difficile. En outre, un ensemble de problèmes accumulés s’est aggravé, soit le rejet, la limitation du plan d’action politique, des politiques d’intégration trop timides, les politiques macro-économiques privilégiant l’agro-exportation et le secteur financier, etc.
Le retour de la droite aux gouvernements a donné lieu à des revers en matière sociale, économique et politique, comme des revers dans la politique étrangère, soumise à nouveau aux intérêts des États-Unis.
Le fait que plusieurs gouvernements progressistes existent et se soutiennent mutuellement a été un élément important pour avancer collectivement. L’offensive réactionnaire s’oriente en sens inverse.
Aujourd’hui, les classes ouvrières de la région sont appelées à arrêter les attaques réactionnaires, à récupérer les espaces qu’on occupait autrefois, à assurer de nouvelles victoires, à créer des conditions pour redonner la prépondérance à l’Union des nations sud-américaines (UNASUL) et à la Communauté d’États latino-américains et caraïbes sur la scène internationale, tout en visant la paix, un nouvel ordre économique et une nouvelle politique internationale.
Face à une nouvelle situation, la gauche est appelée à créer une nouvelle stratégie. L’une de ses composantes, aujourd’hui comme hier, demeure l’intégration de l’Amérique latine et des Caraïbes.
Dans ce contexte d’hégémonie capitaliste, de crise du capitalisme, de développement des contradictions intercapitalistes, de conflits des États-Unis contre les BRICS, d’instabilité, de crise et de la croissante menace de guerre, l’alternative est de construire un fort mouvement international ancré dans les classes ouvrières et dans les secteurs populaires, non seulement pour faire de la résistance, mais aussi pour rallier d’autres gouvernements, réorientant ainsi l’économie et la politique vers un monde socialiste. zzz
* Responsable des relations internationales du Parti des travailleurs.
Par Pomar Valter, le 30 June 2018

Ce texte est divisé en trois parties : la première présente les grandes lignes de la société brésilienne ; la deuxième traite de l’élection présidentielle ; la troisième présente quelques enjeux à moyen terme de la gauche brésilienne.
Le territoire, la population, l’économie, la société, la politique et la culture de ce que l’on appelle à présent Brésil se sont constitués au cours des siècles, dans un processus marqué par trois grandes caractéristiques : la dépendance extérieure, les inégalités sociales et la démocratie oligarchique.
La dépendance extérieure a pris plusieurs formes tout au long de l’histoire du Brésil, mais il y a une composante permanente : la tendance à déplacer son centre de gravité vers l’extérieur. Jusqu’à présent, les échecs de toutes les tentatives de changer cette tendance sont attribués au renforcement des mécanismes de dépendance, qui ont réaffirmé – même si c’est sous une autre forme – par une alliance entre des forces de l’intérieur et de l’extérieur.
Depuis l’arrivée des colonisateurs portugais en 1500, l’inégalité sociale a aussi pris de nouvelles formes. Extrême, toujours présente, elle comporte des variables, y compris des variables raciales, générationnelles et de genre. Le niveau d’inégalité dans le pays est parfois supérieur à celui des pays plus défavorisés, soit en matière de ressources naturelles soit en matière de capacités de production.
La démocratie oligarchique est la troisième marque séculaire du Brésil. Depuis l’arrivée des Portugais au territoire jusqu’à 1888-1889 le pays vit sous un régime à la fois monarchique et esclavagiste. Entre 1889-1930, période connue sous le nom de « Vieille République », nous avons vécu une république de seigneurs de la terre. En 1930-1945, on a eu une dictature cachée et plus tard explicite sous Getúlio Vargas. Entre 1945 et 1964, la « démocratie » libérale comportait de fortes restrictions aux libertés fondamentales en ce qui concerne les syndicats, les partis et la libre manifestation électorale. Entre 1964 et 1985, nous avons connu la dictature militaire. Ce n’est qu’à partir de 1989 que la majorité du peuple a acquis le droit de participer aux processus électoraux, même s’il y avait des contraintes de l’influence de l’argent, de l’oligopole des médias et des règles électorales qui tordent de système de représentation proportionnelle.
La dépendance extérieure, les inégalités sociales et la démocratie oligarchique sont à l’origine des principales caractéristiques, contrastes et contradictions de la société brésilienne.
Ces caractéristiques incluent un modèle de développement qui est par défaut prisonnier de ces trois marques que nous venons de décrire. Ayant une nature limitée, il n’arrive pas à passer la barrière, il semble toujours progresser peu si l’on considère les possibilités et potentialités du pays. Il nous semble aussi qu’il s’agit d’un phénomène cyclique, c’est-à-dire qu’il retourne toujours au point de départ, plus précisément à cause des certains enjeux et obstacles. Au cours de 517 années nous avons crû beaucoup mais, par contre, développé peu.
En deux moments de l’histoire récente, la société brésilienne semblait commencer à surmonter son modèle standard de développement : depuis les années 1930 et 2003.
Depuis 1930, l’urbanisation, l’industrialisation, le renforcement de l’État, les transformations sociales, politiques et culturelles ont pris des dimensions importantes. Cependant, le cycle de développement démarré par la Révolution de 1930 a atteint son point culminant autour des années 1980. À la fin de cette décennie, la classe dominante du pays a choisi le chemin des réformes néolibérales entraînant, dans les années 1990, la fin d’une partie importante du progrès accompli dans les décennies précédentes et renforçant les grandes caractéristiques de l’histoire nationale.
Dès le début, la classe dominante brésilienne a été un partenaire minoritaire des classes dominantes des métropoles, qu’elles soient ibériques, anglaise ou américaine. Il est important de noter que choisir de faire face aux métropoles demanderait de sa part une alliance solide avec les autres couches de la population. En contrepartie, cette alliance devrait se traduire en réforme agraire, en salaires plus élevés, en politiques sociales effectivement universelles avec la participation démocratique des habitants aux affaires du pays. La conséquence de ces mesures, mises en place, ensemble ou séparément, serait la réduction des profits et du statut de la classe dominante. Voilà pourquoi elle a non seulement un rapport de complaisance, mais aussi de protection et reproduction de la dépendance extérieure, des inégalités sociales, de la démocratie oligarchique et d’adhésion à des politiques de développement limité.
C’est quand Luís Inácio Lula da Silva (Lula) entre en fonction, le 1er janvier 2003, qu’a lieu la deuxième tentative de surmonter le développement limité standard. Parmi les partis et les mouvements de la gauche brésilienne, le débat est intense sur les réussites et les contraintes de cette tentative conduite par Lula et le Parti des travailleurs (PT). De toute façon, quelles que soient les réussites et les erreurs de cette tentative sous les gouvernements du PT, la crise financière internationale de 2008, ou, plus précisément, les effets des démarches des États-Unis pour surmonter la crise, ont provoqué un changement d’attitude de la classe dominante brésilienne face au PT et à ses gouvernements. Finalement, en 2016, après le coup d’État contre la présidente Dilma Rousseff, les forces adeptes des politiques néolibérales ont mis en place une reconquête totale du gouvernement et, depuis lors, elles ont détruit tout qui a été construit depuis 2003 en démolissant des aspects positifs de la Constitution fédérale de 1988 et notamment en remettant en cause des conquêtes des années 1950 (comme la compagnie pétrolière nationale Petrobras) et des années 1930 (comme la Consolidation des lois du travail).
Un nombre croissant de défavorisés errant dans les centres-villes, la violence policière contre les jeunes noirs « périphériques », les explosions du système carcéral, la croissance du machisme et de l’homophobie, le discours fasciste sur les réseaux sociaux, ce sont des effets collatéraux du renforcement du néolibéralisme et, parallèlement, il y a l’approfondissement de la dépendance extérieure, des inégalités sociales et des restrictions aux libertés démocratiques.
Dans un pays marqué par des inégalités importantes comme le Brésil, la possibilité d’occuper des terres en friche – même si elles sont situées loin des grandes villes –, les hauts taux de croissance économique, les politiques sociales et la participation démocratique – même limités – ont constitué une soupape pour les tensions sociales accumulées. L’action du néolibéralisme dans les années 1990 et la reprise néolibérale à présent, depuis 2016, associés à un cadre international croissant de crise et polarisation, instaurent un environnement politique et social explosif.
En arrière-plan de la défaite de la gauche brésilienne, notamment du PT, face au coup d’État de 2016 et depuis lors, on trouve trois déplacements de classe importants :
a. Entre 2003 et 2005, la gauche a perdu le soutien et voit monter l’opposition progressive d’une grande partie des classes moyennes. Jusqu’à 2002, elles ont eu une trajectoire de soutien croissant au PT et ses candidatures. Quelle est la cause de ce changement de position ? L’une des causes de fond est que la politique du parti visant à améliorer les conditions de vie des pauvres sans toucher aux profits des riches les a affectées du point de vue matériel et idéologique.
b. Entre 2011 et 2014, on voit la poussée de l’opposition totale du secteur des plus grands capitalistes contre la gauche brésilienne. Entre 2003 et 2010 le grand capital a adopté une combinaison de tactiques : stimuler certaines politiques du gouvernement, s’opposant au piétisme et soutenant principalement les candidatures du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB, droite) et d’autres partis similaires. Pourquoi ce changement de position ? L’une des causes de fond est la suivante : l’un des effets collatéraux de la crise de 2008 a été la disparition des possibilités offertes par les affaires internationales, qui a poussé la classe capitaliste brésilienne à revenir à son fonctionnement normal consistant à surexploiter la classe ouvrière et à livrer les ressources nationales à des intérêts étrangers. C’était incompatible avec la présence du PT à la tête du gouvernement d’État.
c. Notamment en 2015, la gauche brésilienne a perdu le soutien d’une partie importante de la classe ouvrière, recevant plutôt son indifférence. Le tournant s’est produit vers la fin 2014-début 2015 quand la présidente Dilma Rousseff a mis en place un projet d’ajustement fiscal occasionnant des dégâts matériels immédiats pour la classe ouvrière.
Dans les élections présidentielles de 2006, 2010 et 2014, la gauche brésilienne avait réussi à affronter et à vaincre l’alliance entre les classes moyennes et le grand capital. Cela n’a pas été possible en 2015-2016 essentiellement en raison de la perte du soutien de la majorité de la classe ouvrière.
La classe dominante et ses alliés étaient impliqués dans le coup d’État parlementaire, médiatique et judiciaire de 2016, qui visait les objectifs suivants :
a. Réduire les salaires et les cotisations sociales, ainsi que supprimer des libertés démocratiques de la classe ouvrière.
b. Aligner notre politique extérieure sur celle des États-Unis et leurs alliés.
c. Rétablir la position de la gauche brésilienne en tant que force minoritaire ou équipe de soutien d’une partie de la classe capitaliste contre l’autre, comme avant 1980, rendant toute alternative de gauche au gouvernement et toute transformation en alternative de pouvoir impossible.
Depuis le coup d’État de 2016, plusieurs mesures ont été prises pour mettre en œuvre ces objectifs, parmi lesquels la réforme du Code du travail, qui supprime les droits de la classe ouvrière ; la révision de la politique nationale pétrolière, afin de servir les intérêts des multinationales de ce secteur.
Pour réussir ces objectifs à moyen terme, les putschistes doivent remporter les élections qui auront lieu en octobre 2018.
Dans les premiers mois de 2016, le coup d’État a obtenu un certain succès et un soutien populaire, constaté non seulement sur la base de sondages d’opinion, mais aussi sur les résultats obtenus par les partis putschistes aux élections municipales. Cependant, aujourd’hui la popularité du gouvernement putschiste est anémique, contaminant la plupart des candidatures présidentielles liées au coup d’État.
En ce moment il y a 13 candidatures à la présidence de la République. De ce nombre, quatre demandes ont été formulées par les partis qui se sont opposés au coup d’État de 2016. Les autres 9 précandidatures ont été lancées par les partis qui ont soutenu le coup d’État de 2016.
Jusqu’à présent, le capitaine Jair Bolsonaro – défenseur de positions d’extrême droite – est le seul candidat putschiste qui révèle un stock suffisant de voix pour passer au deuxième tour.
Lula était en tête de tous les candidats dans tous les sondages, avec plus d’intention de vote que tous les autres candidats ensemble mais sa candidature a été bloquée par voie judiciaire le 11 septembre. Fernando Haddad a été désigné à sa place comme candidat du PT avec comme colistière Manuela D’Avila du Parti communiste du Brésil (PCdoB). Depuis cette date, deux évolutions majeures se sont produites. La première est le report en faveur de Haddad des intentions de votes précédemment favorables à Lula. La deuxième évolution est une consolidation des intentions de vote pour Bolsonaro. La tendance actuelle fait envisager un deuxième tour entre Bolsonaro et Haddad, dont Haddad sortirait victorieux.
Ce serait une catastrophe pour les putschistes car leur problème, ce n’est pas Lula, c’est le PT et la gauche. Que peuvent-ils faire pour l’empêcher ? En ce qui concerne les alternatives électorales (étant donné qu’une partie d’entre eux n’exclut pas des alternatives non électorales, c’est-à-dire un coup d’État militaire), il existe trois possibilités : a) écarter Bolsonaro du deuxième tour (par quelque conspiration) et mettre en avant un candidat plus acceptable ; b) soutenir Bolsonaro à fond, en négociant des garanties telles que l’autonomie de la Banque centrale et le parlementarisme ; c) effectuer des opérations extraordinaires pour essayer d’empêcher Haddad et le PT d’atteindre le deuxième tour en faisant émerger un candidat « modéré », ce qui semble difficile au vu des sondages actuels.
En outre, actuellement un grand pourcentage d’électeurs n’ont pas encore pris leur décision. Mais il y a des signes qui nous indiquent qu’un bon nombre d’entre eux doit pencher pour les votes blancs, nuls et l’abstention. Les autres doivent se répartir entre les candidatures principales. Par conséquent, la polarisation entre Lula et Bolsonaro peut se maintenir dominante jusqu’à la fin de la campagne électorale.
Ce n’est pas en se rapprochant du centre que la gauche peut réussir à faire barrage à l’extrême droite mais en démasquant le programme socio-économique de Bolsonaro et en mettant en avant son propre programme et les mesures d’urgence qu’elle propose pour gagner au vote Haddad l’électorat populaire.
La profondeur de la crise brésilienne indique deux possibilités : une rupture conservatrice et une rupture populaire.
Les forces putschistes s’orientent vers une rupture conservatrice, dont l’expression extrême serait la dictature. Les actions des putschistes sont déjà à la limite de la légalité, comme l’a démontré un épisode récent où Lula a été maintenu en détention malgré l’octroi de la demande d’habeas corpus ; les aspects démocratiques et sociaux de la Constitution de 1988 ont été supprimés ; les militaires sont déjà convoqués pour prendre des postes et des tâches autrefois réservés aux civils.
Cependant, une rupture conservatrice demanderait une intervention militaire explicite, ce qui jusqu’à présent n’est pas souhaitable pour les dirigeants militaires. À cause des possibles effets collatéraux dans le cadre international et national, le grand capital hésite à toucher à cette question.
D’ailleurs, une rupture populaire demanderait une lutte populaire à croissance exponentielle, associée à une victoire électorale massive de la gauche en 2018, permettant au gouvernement élu d’annuler les mesures adoptées par les putschistes depuis la destitution de la présidente Dilma ; de mettre en place un « plan d’urgence » ; convoquer une Assemblée constituante ; faire débuter un cycle de réformes structurelles. En même temps, il faut réunir des forces pour défaire la réaction des capitalistes et de leurs alliés.
Les conditions pour un tournant dans notre conjoncture ne sont pas encore visibles, mais elles pourraient éventuellement se produire. Ainsi, on estime que la situation politique brésilienne continuera d’être instable en dépit des résultats des élections, en octobre 2018, à la présidence, des gouverneurs des États, du Congrès national, des Chambres de députés des États.
Dans ce contexte, les forces de gauche visent à :
a. Retrouver la capacité de mobilisation et de soutien organisé auprès de la classe ouvrière.
b. Garder la classe ouvrière et la gauche comme pôles protagonistes indépendants, empêchant qu’elles retournent au poste d’équipe de soutien dans la dispute entre deux secteurs de la bourgeoisie, tout en gardant les groupes démocratiques et populaires comme alternatives au gouvernement, cherchant sa conversion en alternative de pouvoir.
De ce point de vue, il paraît important de penser que le futur de 2018 c’est aussi le futur du PT.
Depuis 1989 il y a des secteurs qui ont rompu les liens avec le parti pour construire des alternatives de gauche. Toutes leurs tentatives de supplanter le PT ont finalement échoué. Le PT risque d’être détruit à cause de ses erreurs, combinées aux attaques de la droite. Si cette situation se concrétise, on aura pour des décennies le retour d’une gauche du modèle que l’on avait principalement avant les années 1980 : marginale et subordonnée à un secteur de la classe dominante, sans constituer une alternative de gouvernement ou sans accéder au pouvoir.
Ainsi, la survie et le renforcement du PT sont de l’intérêt de l’ensemble de la gauche. Il y a plusieurs signes indiquant la survie du parti, parmi lesquels le résultat des sondages : le PT est le parti le plus populaire du pays ayant un soutien cinq fois supérieur à celui de son concurrent.
Néanmoins, il y a aussi des indices défavorables. Parmi eux, le principal est la difficulté d’une grande partie du PT de traduire en mesures concrètes le fait que la lutte des classes est passée à un autre niveau, à cause des actions du grand capital.
Désormais, l’ensemble de la gauche devrait surmonter des défis extrêmes comparables à ceux de la période 1990-2002. Parmi eux, élaborer et soutenir un nouveau projet de développement – orienté vers la fin de la dépendance extérieure, des inégalités sociales, de la démocratie oligarchique et impliquant non seulement des réformes structurelles combinées à des politiques publiques, mais aussi avec la lutte directe pour le socialisme.
Ces reformes incluent : la réforme fiscale, la réforme financière, la réforme agraire, la souveraineté énergétique, la constitution de l’État-providence, la garantie et l’élargissement des droits civils, la réforme politique, la démocratisation des médias, la réforme du système juridique et du système de sécurité.
L’ensemble de ces réformes doit se traduire, fusionner et se matérialiser dans un ensemble de politiques publiques. Du coup, la réussite de ces réformes et des politiques publiques dépend du moteur économique du Brésil, principalement en ce qui concerne les points suivants :
a. L’adaptation de la production de biens et services à la demande sociale actuelle et à la croissance de la population tout en tenant en compte ses besoins.
b. L’objectif d’avoir des taux de croissance et de productivité capables d’absorber la masse de chômeurs et de nouveaux entrants sur le marché de travail.
c. La rémunération pécuniaire directe (salaires et pensions) et la rémunération pécuniaire indirecte (l’offre de services publics) permettant aux personnes en activité et en retraite d’avoir une meilleure qualité de vie de façon continue.
d. Une capacité de production qui, au fil du temps, soit analogue aux niveaux des moyens de production des pays les plus développés.
Le Brésil n’est pas condamné pour toujours à être exportateur des produits du secteur primaire et importateur de produits industriels. Pour changer ce cadre, il nous faut un nouveau processus de « substitution d’importations » basé sur l’association de l’élargissement du marché des produits de consommation de masse avec le développement d’un grand marché de biens d’équipement.
Il sera également nécessaire de mettre en place un ensemble d’actions afin d’articuler : a) la dévaluation du real face au dollar ; b) la réduction des taux d’intérêt en adéquation avec l’investissement productif ; c) la taxation du capital spéculatif et d’autres mesures pour garantir la qualité de l’investissement étranger ; d) la taxation des importations ; e) la réduction du service de la dette pour garantir l’extension de la capacité d’investissement de l’État ; f) l’élaboration d’un programme d’investissement public dans les infrastructures.
Il s’agit d’investir lourdement dans le transport collectif en zone urbaine ; dans l’infrastructure urbaine ; dans le transport ferroviaire ; dans les transports par voie navigable ; dans le logement social et tous les services publics qui touchent cette question, notamment l’assainissement .
Ces investissements publics constituent un investissement social, l’extension de l’offre et de la qualité des biens publics tout en ayant comme grand objectif la reconstruction d’une industrie solide et technologiquement avancée.
Ainsi, le but principal de la réindustrialisation n’est pas l’offre des biens de consommation individuelle, mais plutôt l’extension de l’offre et de la qualité des biens d’usage collectifs, comme les navires, les trains, les métros, les autobus, et pas majoritairement en faveur du transport individuel.
Il faut souligner que l’extension de la capacité de consommation de la population étendra aussi le marché de consommation de masse des biens privés. L’ensemble des millions de Brésiliens et Brésiliennes a le droit de consommer plus. Il faut donc associer l’offre des biens de consommation publics à celle des biens privés.
Évidemment, ces mesures se heurtent aux intérêts des oligopoles privés, dont beaucoup sont des entreprises transnationales ayant le contrôle sur les chaînes de productions. Ce sont de grands importateurs et des producteurs de biens de consommation de masse qui ne sont pas intéressés à l’expansion de la production nationale.
Cela veut dire aussi un choc contre les idées préconçues d’une partie de la population, qui confond systématiquement le bien-être avec l’extension de la consommation des biens privés.
Pour réussir ce développement en tenant compte des dimensions qu’on vient de présenter, il nous faut une autre organisation politique et un État fort, capable de concevoir et faire prévaloir les intérêts collectifs sur des intérêts individuels, les intérêts de la majorité de la population sur ceux de la minorité, les intérêts nationaux sur les intérêts internationaux. Un État capable de construire un secteur financier national qui atteigne l’objectif d’être 100 % public, conjugué à un grand nombre de banques des États, municipalités, et aussi des banques privées et/ou coopératives. Une telle dynamique ne sera pas le résultat de la « libre concurrence » entre les entreprises privées ou du « libre marché » international, surtout dans la conjoncture mondiale.
Bref, c’est à la gauche de développer au niveau pratique et théorique une alternative d’avenir visant à affronter et surmonter les trois grandes caractéristiques de la trajectoire du pays.
Il nous faut une tentative dont le résultat soit un pays souverain au plan national, avec la démocratie politique, l’égalité sociale et le développement durable.
Il nous faut un projet de développement intégrant les divers aspects de la société brésilienne tout en s’orientant vers la construction d’un pays où l’ensemble de la classe ouvrière obtient un niveau élevé de vie matérielle, culturelle et politique. Les conditions historiques effectives du Brésil indiquent que pour atteindre ces objectifs il faut une organisation économiquement, socialement et politiquement socialiste.
La quête de ces objectifs aura plus de chances de réussite si cette organisation est mise en place de façon intégrée avec les autres pays de l’Amérique latine et les Caraïbes, tout en conservant un certain degré de coopération entre les pays des BRICS.
L’Amérique latine et les Caraïbes ont été victimes au cours des années 1960 et 90 des gouvernements dictatoriaux et néolibéraux. Depuis 1998 un cycle de gouvernements progressistes à gauche a été enclenché. Malgré leurs faiblesses et différences, ce changement a présenté des résultats positifs : expansion du bien-être social et de l’égalité sociale, des libertés démocratiques, de la souveraineté nationale et de l’intégration régionale.
C’est depuis la crise de 2008 et à cause de ses effets, de l’action du gouvernement des États-Unis, de l’opposition de la droite, ajoutée aux erreurs et contraintes des expériences « progressistes de gauche », que s’et engagé ce cycle d’attaques réactionnaires. Ils ont vaincu les gouvernements progressistes de gauche de la région ou les ont mis en garde, ainsi que les forces sociales et partisanes liées aux ouvriers.
Jusqu’à la crise internationale de 2008 les gouvernements progressistes à gauche ont réussi à gérer leurs limites, contradictions et fautes. Cependant, depuis la crise de 2008, la dégradation des prix des produits de base, la dépendance financière et commerciale, la force des oligopoles – surtout étrangers – et la faiblesse de l’État rendent la situation très difficile. En outre, un ensemble de problèmes accumulés s’est aggravé, soit le rejet, la limitation du plan d’action politique, des politiques d’intégration trop timides, les politiques macro-économiques privilégiant l’agro-exportation et le secteur financier, etc.
Le retour de la droite aux gouvernements a donné lieu à des revers en matière sociale, économique et politique, comme des revers dans la politique étrangère, soumise à nouveau aux intérêts des États-Unis.
Le fait que plusieurs gouvernements progressistes existent et se soutiennent mutuellement a été un élément important pour avancer collectivement. L’offensive réactionnaire s’oriente en sens inverse.
Aujourd’hui, les classes ouvrières de la région sont appelées à arrêter les attaques réactionnaires, à récupérer les espaces qu’on occupait autrefois, à assurer de nouvelles victoires, à créer des conditions pour redonner la prépondérance à l’Union des nations sud-américaines (UNASUL) et à la Communauté d’États latino-américains et caraïbes sur la scène internationale, tout en visant la paix, un nouvel ordre économique et une nouvelle politique internationale.
Face à une nouvelle situation, la gauche est appelée à créer une nouvelle stratégie. L’une de ses composantes, aujourd’hui comme hier, demeure l’intégration de l’Amérique latine et des Caraïbes.
Dans ce contexte d’hégémonie capitaliste, de crise du capitalisme, de développement des contradictions intercapitalistes, de conflits des États-Unis contre les BRICS, d’instabilité, de crise et de la croissante menace de guerre, l’alternative est de construire un fort mouvement international ancré dans les classes ouvrières et dans les secteurs populaires, non seulement pour faire de la résistance, mais aussi pour rallier d’autres gouvernements, réorientant ainsi l’économie et la politique vers un monde socialiste. zzz
* Responsable des relations internationales du Parti des travailleurs.
Par Durand Denis , le 30 June 2018
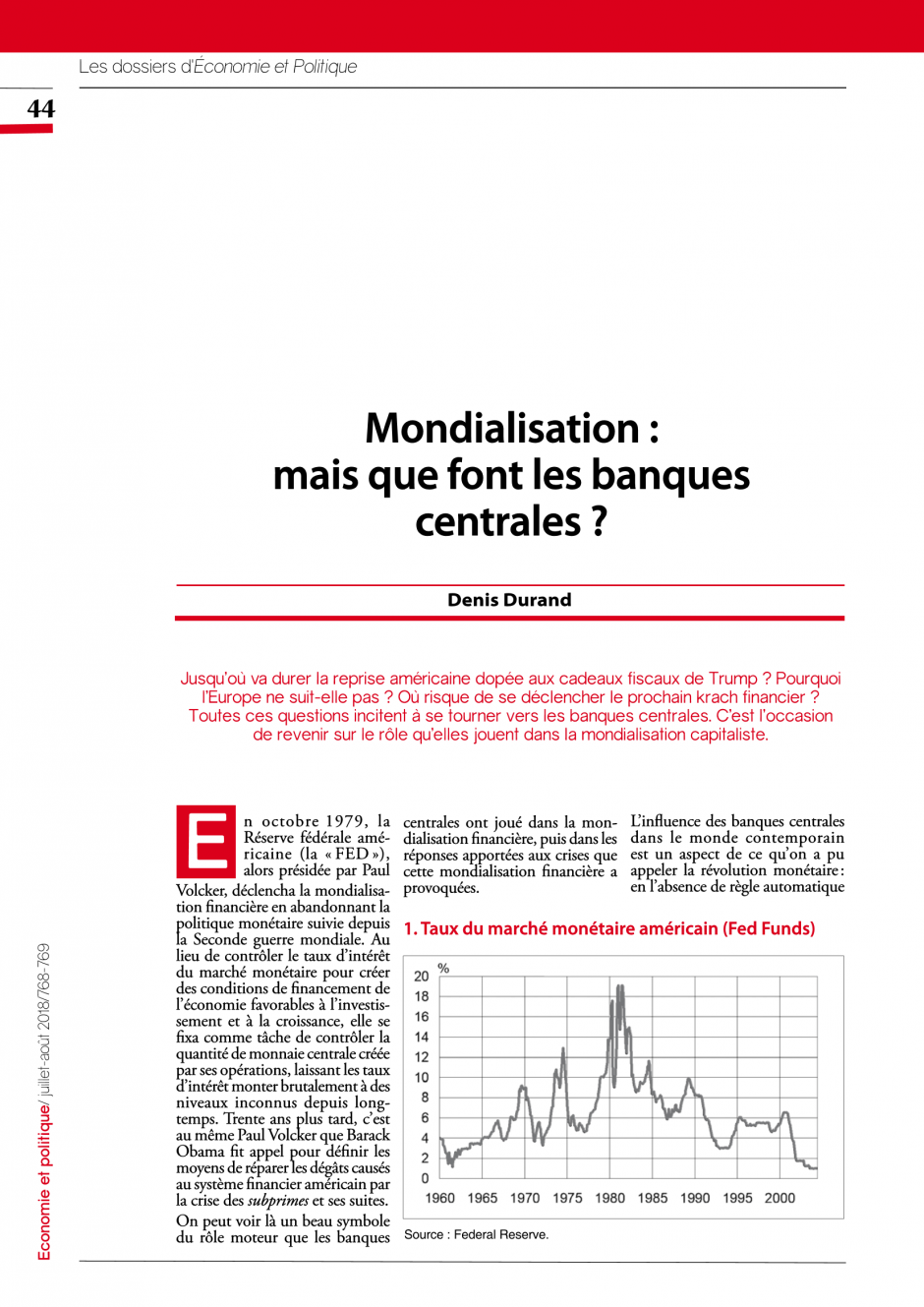
En octobre 1979, la Réserve fédérale américaine (la « FED »), alors présidée par Paul Volcker, déclencha la mondialisation financière en abandonnant la politique monétaire suivie depuis la Seconde guerre mondiale. Au lieu de contrôler le taux d’intérêt du marché monétaire pour créer des conditions de financement de l’économie favorables à l’investissement et à la croissance, elle se fixa comme tâche de contrôler la quantité de monnaie centrale créée par ses opérations, laissant les taux d’intérêt monter brutalement à des niveaux inconnus depuis longtemps. Trente ans plus tard, c’est au même Paul Volcker que Barack Obama fit appel pour définir les moyens de réparer les dégâts causés au système financier américain par la crise des subprimes et ses suites.
On peut voir là un beau symbole du rôle moteur que les banques centrales ont joué dans la mondialisation financière, puis dans les réponses apportées aux crises que cette mondialisation financière a provoquées.
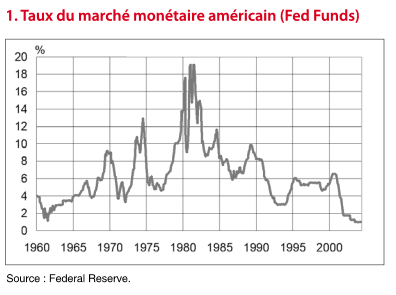
L’influence des banques centrales dans le monde contemporain est un aspect de ce qu’on a pu appeler la révolution monétaire : en l’absence de règle automatique destinée à justifier la confiance dans la monnaie par sa convertibilité en or (règle abandonnée depuis la Première guerre mondiale) ou dans une monnaie, le dollar, elle-même convertible en or (base du système de Bretton Woods jusqu’à la fin de la convertibilité du dollar en 1971), toute l’économie repose sur la capacité des banques centrales à persuader en permanence le public – et les marchés – que la monnaie émise par les banques correspond bien à la création de richesses réelles par le travail humain.
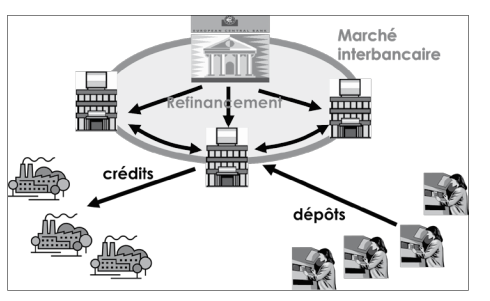
Les moyens dont elles disposent pour cela sont très puissants puisque les banques ordinaires ne peuvent exercer leur activité que si elles disposent de réserves déposées sur leur compte auprès de leur banque centrale (c’est ce qu’on appelle la monnaie centrale). La principale source de réserves sont les prêts que les banques centrales leur accordent pour refinancer les crédits que les banques accordent aux entreprises, aux collectivités publiques et aux États. Les banques centrales ont donc le pouvoir de fixer les conditions auxquelles elles prêtent ces réserves aux banques ordinaires (par exemple les taux d’intérêt, dits « taux directeurs » dont sont assortis ces prêts).
Elles peuvent aussi refuser de prêter à une banque en manque de réserves. Dans ce cas, elles provoquent sa disparition immédiate : c’est le sort que la Réserve fédérale américaine a infligé le 25 septembre 2008, avec l’assentiment du Trésor américain, à l’une des grandes institutions de Wall Street, Lehman Brothers.
Or, l’inflation financière que les banques centrales ont elles-mêmes déclenchée il y a quarante ans mine la capacité de création de richesses dans l’économie mondiale, ce qui rend plus fragile la confiance dans la monnaie et rend la tâche des banques centrales de plus en plus difficile.
Le « coup d’État monétaire » d’octobre 1979, au moment où des gouvernements inspirés des préceptes néolibéraux prenaient le pouvoir, avec Margaret Thatcher, en Grande-Bretagne et s’apprêtaient à le faire avec Ronald Reagan aux États-Unis, a été immédiatement compris comme une mise en œuvre des théories « monétaristes » de Milton Friedman, recommandant de tenir sous contrôle la quantité de monnaie en circulation et de laisser le marché assurer l’équilibre entre l’épargne et l’investissement. Plus profondément, ce tournant dans la politique monétaire a fait entrer l’économie américaine, et avec elle l’économie mondiale, dans un régime de fonctionnement tout à fait nouveau1. C’est ce que montre le graphique 2.
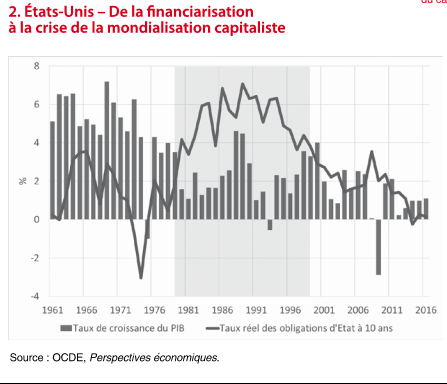
Jusqu’en 1979, le rendement « réel », c’est-à-dire corrigé de l’inflation, des emprunts d’État américains, qui guide le coût du crédit à l’investissement dans le pays, est constamment resté inférieur au taux de croissance de l’économie. Il a même été négatif (la hausse des prix étant supérieure au taux d’intérêt) pendant la récession de 1974-1975. En revanche, au cours des 17 années qui ont suivi (zone en grisé sur le graphique 2), il lui a constamment été supérieur. Cela signifie que la richesse des détenteurs de titres financiers s’est accrue plus vite, chaque année, que la valeur ajoutée créée par le travail des habitants du territoire américain. Les financiers ont pu en profiter pour développer leur activité et les innombrables innovations (marchés à terme, options, swaps et toutes les combinaisons imaginables de ces techniques) qui ont facilité les opérations spéculatives. Mais cela signifie aussi que ce prélèvement croissant de la finance sur la valeur ajoutée s’est fait au détriment des entreprises et, plus précisément, de leurs salariés. Il n’a été possible que parce que les gestions d’entreprises ont été, plus directement et plus brutalement qu’auparavant, dictées par l’obsession de rentabiliser le capital (les actionnaires et les créanciers : banques, fonds de placement, fonds de pension, compagnies d’assurances…) et de baisser, pour y parvenir, le coût du travail. Les choix technologiques, les choix d’investissement et de financement, la gestion du personnel (licenciements, externalisations, précarisation) ont traduit cette obsession, sous le regard permanent des marchés financiers sanctionnant instantanément tout écart par rapport à la norme de rentabilité capitaliste. La gestion des collectivités publiques a obéi aux mêmes impératifs, à la faveur des doctrines néolibérales recommandant la baisse des dépenses publiques et l’austérité budgétaire.
Le graphique 2 montre qu’à partir de 1997 le taux d’intérêt réel cesse d’être systématiquement supérieur au taux de croissance car ce régime est devenu intenable en raison de l’instabilité financière qu’il provoque (krach boursier de 1987, « krach obligataire » de 1994). En décembre 1996, le successeur de Paul Volcker à la FED, Alan Greenspan, a beau dénoncer l’« exubérance irrationnelle » des marchés financiers, il n’a plus les moyens de réprimer cette exubérance. Il faudrait en effet rendre plus cher l’accès des spéculateurs au crédit bancaire mais il ne peut plus se le permettre : le risque de provoquer un krach serait trop grand.
Un gros effort est néanmoins tenté, à l’échelle internationale et à l’initiative des autorités monétaires britanniques et américaines, pour discipliner l’action des banques par d’autres moyens que le seul usage des taux de marchés. La réglementation internationale dit de Bâle I est adoptée en 1988 à l’issue de longues négociations motivées par les frayeurs consécutives à la faillite de la banque Herstatt en 1974. Entrée en vigueur à partir de 1992, elle se révèle vite insuffisante et fait place à des réglementations (Bâle II puis Bâle III) rendues plus restrictives au lendemain des crises financières… puis affaiblies par le lobbying des financiers dès que l’appât de nouveaux gains fait oublier les craintes de la veille. La bride sur le cou laissée aux financiers qui entourent Donald Trump pour défaire les restrictions mises en place par son prédécesseur (et par Paul Volcker) est une nouvelle manifestation de l’« aveuglement au désastre » qui frappe symptomatiquement les financiers, mais aussi les meilleurs économistes, en période d’euphorie financière.
Plus fondamentalement, on voit mal comment ces règles dites de solvabilité pourraient dissuader les banques de prendre des risques inconsidérés puisqu’elles sont fondées sur une norme de rentabilité (l’accroissement des fonds propres des banques) qui ne peut être respectée que par la prise de risques supplémentaires…
De fait, des krachs se produisent bel et bien, et celui de 2007-2008 a placé le système financier occidental au bord de l’effondrement. Depuis la « grande récession » qui l’a suivie, les taux d’intérêt réels sont systématiquement inférieurs au taux de croissance et la FED manifeste une extrême prudence dans le processus de remontée des taux d’intérêt qu’elle a amorcé depuis deux ans et demi. Elle se souvient que c’est la crainte d’un petit durcissement des politiques monétaires des deux côtés de l’Atlantique qui a semé la panique sur les marchés, en août 2007, et déclenché la crise dite des subprimes.
Significativement, la Banque centrale européenne, quant à elle, ne peut même pas se permettre d’amorcer une hausse des taux d’intérêt aujourd’hui, alors qu’elle avait dû suivre la FED dans leur réduction dès 2008, puis dans l’adoption de politiques monétaires « non conventionnelles », sur lesquelles nous allons revenir. Un aspect important de la mondialisation financière est en effet qu’elle a réaffirmé la hiérarchie des monnaies, et donc la dépendance des politiques monétaires du monde entier vis-à-vis de la monnaie de l’impérialisme le plus puissant, le dollar.
En octobre 1979, une multitude de facteurs économiques, financiers, politiques menaçaient d’ébranler la confiance dans la monnaie américaine et le cours du dollar contre les monnaies rivales (yen, deutsche Mark) était au plus bas. Il remonte en flèche avec la remontée des taux aux États-Unis, jusqu’à ce que les accords du Plaza, en 1985, et du Louvre, en 1987, prennent acte du retour incontesté de l’« exorbitant privilège » qui permet aux États-Unis de s’endetter dans leur propre monnaie, et d’user de ce pouvoir au mieux des intérêts des groupes capitalistes américains et de Wall Street. Cela alors même que les autorités américaines ne peuvent plus se prévaloir d’une convertibilité du dollar en or, comme c’était le cas jusqu’en août 1971.
Le projet de monnaie unique européenne exprime une velléité de rivaliser avec la finance américaine dans le cadre de l’hégémonie du dollar et de la domination des marchés financiers.
La révolution financière américaine s’est en effet répandue dans tous les pays développés, sous le puissant effet de l’attrait exercé par Wall Street sur les capitaux en provenance du monde entier. En France, comme aux États-Unis, les taux d’intérêt réels deviennent durablement supérieurs au taux de croissance de l’économie à partir de 1980, jusqu’à l’époque de plus en plus troublée qui commence le xxie siècle.
Comme dans l’ensemble des pays développés, ce régime de croissance a pour condition des gestions d’entreprises visant à faire baisser la part des salaires dans la valeur ajoutée. Le phénomène, et sa corrélation avec la financiarisation, est particulièrement net en France.
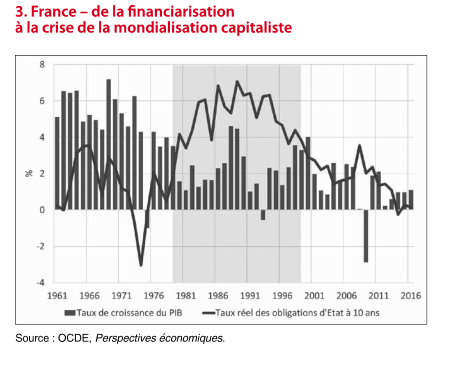
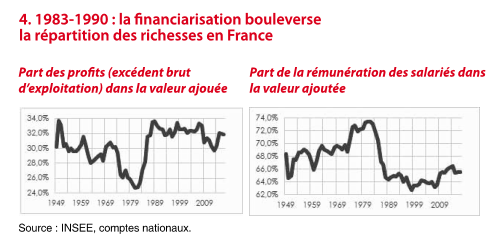
C’est par cet enchaînement que la mondialisation capitaliste, loin de constituer une « bulle » déconnectée de l’économie réelle, a imposé le pouvoir des marchés financiers à toutes les décisions portant sur l’utilisation de l’argent dans les entreprises et dans les États, et a modifié par-là les conditions d’emploi, la répartition des revenus, affectant la vie de tous les habitants de la planète.
Impuissantes à maîtriser les divagations de la finance qu’elles avaient elles-mêmes déchaînées par leurs politiques monétaristes, les banques centrales n’ont pas pu empêcher les catastrophes causées par la suraccumulation chronique de capitaux financiers libres de se déplacer instantanément d’un point à l’autre de la planète. Lorsque ces catastrophes se sont produites, elles ont été contraintes de revoir leur doctrine et de recourir à des moyens d’action auxquels elles répugnaient pourtant profondément.
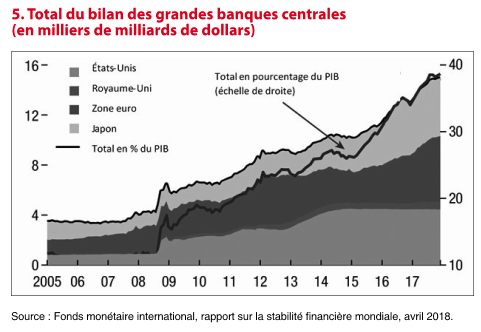
La première à se trouver dans cette situation a été la Banque du Japon. Par son dynamisme industriel, son avance technologique, et par la taille de ses banques, le Japon semblait, dans les années quatre-vingt, en mesure de rivaliser avec succès avec la puissance américaine. Il était aussi le siège d’une spéculation financière et immobilière effrénée. Placée sous la pression américaine (les accords de Bâle I sont très défavorables aux banques japonaises), la Banque du Japon crut possible, en 1990, de maîtriser la spéculation en durcissant sa politique monétaire. Le résultat fut non seulement de provoquer un krach retentissant mais surtout de briser pour les trente ans qui ont suivi l’élan de la croissance japonaise. Confrontée à une tendance durable à la déflation (spirale destructrice de baisse des prix et de la demande), la Banque du Japon a été contrainte dès 1999 de ramener ses taux d’intérêt à zéro, puis de mener une politique de quantitative easing (création de monnaie centrale sous forme d’achats massifs de titres publics et privés pour maintenir le plus haut possible leurs cours sur le marché financier). Cette politique, dans le contexte particulier de l’économie japonaise (taux d’épargne très élevé, excédent commercial structurel) lui permet de supporter – jusqu’à quand ? – un endettement public de 253 % du PIB mais elle est devenue une des moins dynamiques du monde.
C’est à partir de la crise des subprimes, en 2007, que les grandes banques centrales occidentales se sont trouvées contraintes d’adopter des politiques analogues, dites « non conventionnelles ». À côté de l’intervention directe des gouvernements (plans de relance, nationalisation partielle ou totale de banques en difficultés, comme en Grande-Bretagne), l’action des banques centrales a pris une intensité extraordinaire pour sauver le système financier d’un effondrement systémique. L’obligation d’agir avait pour partie une cause technique. Après la faillite de Lehman en septembre 2008, les grandes banques refusaient de se prêter entre elles, paralysant le marché interbancaire. Or ce marché remplit une fonction vitale pour les banques : assurer pour chacune d’elle, à chaque instant, l’équilibre de ses créances et de ses dettes. Les banques centrales ont donc été contraintes de se substituer au marché pour remplir cette fonction : elles ont dû prêter massivement aux banques en déficit temporaire de trésorerie, tandis que celles qui étaient en excédent conservaient leurs avoirs en comptes auprès de la banque centrale. Sans cette énorme création monétaire, les banques se seraient retrouvées les unes après les autres en cessation de paiement.
Les banques centrales sont allées plus loin. Non seulement ces prêts au secteur bancaire ont été assortis de taux d’intérêts de plus en plus faibles mais lorsque ceux-ci sont descendus à 0 % voire en-dessous, les banques centrales ont continué d’injecter de la monnaie centrale sur les marchés, cette fois-ci en achetant directement des titres (obligations publiques, privées, titres du marché monétaire, voire actions). En inondant les marchés de ces liquidités, elles espéraient faciliter la reprise après la « grande récession » de 2008-2009. C’est ce qu’on a appelé l’« assouplissement quantitatif » (quantitative easing) de la politique monétaire2.
Au total, les grandes banques centrales du monde ont quadruplé la taille de leur bilan depuis 2005.
Dans le cas de la Banque centrale européenne – ou, plus exactement, de l’Eurosystème, constitué de la BCE et des banques centrales nationales de la zone euro, comme la Banque de France – l’augmentation de la taille de son bilan a pris deux formes : l’achat de titres sur le marché financier et la mise en place d’opérations de refinancement à long terme (voir graphique 6).
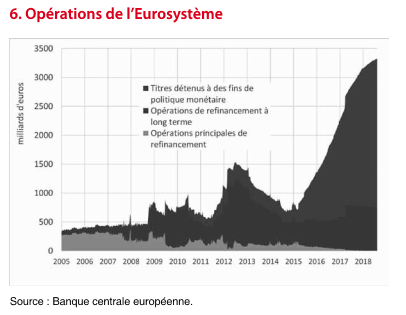
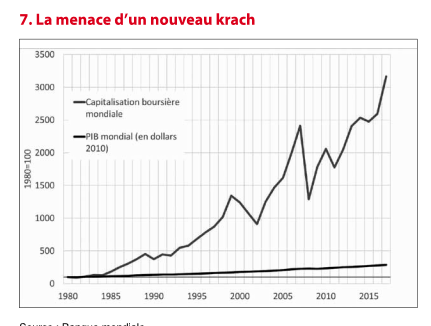
Les opérations de refinancement à long terme ont fini par remplacer entièrement, dans le bilan de l’Eurosystème, les opérations principales de refinancement hebdomadaires (qui représentaient l’essentiel de l’activité de la BCE jusqu’en 2008). Il s’agit de prêts accordés aux banques à une échéance de quatre ans (au lieu d’une semaine) et assortis d’un taux d’intérêt nul, qui peuvent même être négatifs (jusqu’à -0,4 %) pour les banques qui prouvent que leurs crédits financent les entreprises. Il s’agit en effet d’opérations « ciblées » (Targeted Long Term Refinancing Operations). La BCE reconnaît ainsi elle-même qu’en période de suraccumulation financière les refinancements doivent être sélectifs, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas se contenter de laisser le marché déterminer l’affectation des fonds qu’elle met en abondance à la disposition aux financiers. C’est un changement de doctrine majeur par rapport aux conceptions néolibérales et monétaristes qui ont prévalu jusqu’en 2008. Mais de quelle sélectivité doit-il s’agir ? De celle que pratique aujourd’hui la BCE, fondée sur le verdict des agences de notation, c’est-à-dire sur la recherche de la rentabilité financière à l’exclusion de toute autre considération ? Ou d’une nouvelle sélectivité, fondée sur des critères économiques (création de valeur ajoutée dans les territoires), sociaux (emploi, formation, salaires, conditions de travail) et écologiques (économies d’énergies et de matières premières) ? C’est un enjeu politique qui appelle à la prise en compte d’une cohérence portée par les mobilisations sociales.
Les banques centrales, des deux côtés de l’Atlantique, souhaitent vivement tourner la page des politiques monétaires « non conventionnelles ». Elles n’y sont pas seulement portées pour des raisons de principe mais parce qu’elles savent à quoi ont servi les énormes quantités de monnaie centrale qu’elles ont créées depuis dix ans : pour une part essentielle, à gonfler les prix des actifs financiers, alimentant la menace d’une prochaine crise financière.
Le consensus est quasi total chez les économistes comme chez les financiers pour juger qu’une telle crise est inévitable. Nul ne peut prédire où et quand la déflagration se produira mais le graphique 7 – corroborant bien d’autres indices – donne à penser que les masses financières en jeu la rendront encore bien plus violente que celle de 2007. S’attaquer à l’inflation financière est donc peut-être vital pour le système financier mondial, et pour toutes les économies de la planète.
Les données du problème ne sont pas tout à fait les mêmes pour la Réserve fédérale et pour la BCE3. Comme on l’a déjà indiqué, l’hégémonie monétaire américaine donne à la FED une capacité d’action supérieure à celle des autres banques centrales ; mais l’état de l’économie américaine rend une action urgente. La reprise, amorcée dès 2010 aux États-Unis, a déjà inauguré un des cycles les plus longs que l’économie américaine ait connus. La stimulation de la demande orchestrée par Trump (mesures fiscales en faveur des groupes multinationaux et des financiers) a vraisemblablement pour effet de prolonger ce cycle jusqu’à un point où la chute en récession sera particulièrement brutale ; en attendant, cette politique propulse les profits, les dividendes distribués et les cours de Bourse à des hauteurs qui donnent le vertige aux financiers eux-mêmes. Le Conseil de la Réserve fédérale a donc mis en œuvre un resserrement progressif de la politique monétaire. Il a agi sur les deux leviers dont il dispose. À partir de la fin décembre 2015, il a commencé à relever les taux d’intérêt du marché monétaire (graphique 8). Parallèlement, il a mis fin au quantitative easing : les achats de titres par la banque centrale ont été ralentis à partir de décembre 2013, le montant des titres qu’elle détient a cessé d’augmenter à partir d’octobre 2014 et depuis juin 2017 elle laisse décroître ce montant à mesure que les titres qu’elle a en portefeuille viennent en échéance. Le rythme de cette « normalisation » a été suffisamment prudent pour que l’économie américaine puisse le supporter sans dommage apparent. De façon significative, elle n’a été mise en œuvre qu’à partir du moment où la FED a considéré que la situation de l’emploi s’était suffisamment améliorée après la « grande récession » de 2009.
Il n’en a toutefois pas été de même pour les économies qui subissent l’influence de la politique des états-Unis, en particulier les marchés émergents, du Brésil à la Turquie, où les annonces de la FED ont à plusieurs reprises provoqué de sérieuses turbulences.
De son côté, la Banque centrale européenne ne s’est pas senti la force d’emboîter le pas à son homologue américaine. De fait, la reprise économique a été beaucoup plus tardive, beaucoup plus incertaine et beaucoup plus inégalement répartie dans la zone euro que de l’autre côté de l’Atlantique. Non seulement les vicissitudes politiques sont venues aggraver les vulnérabilités de l’économie italienne mais les banques européennes – jusqu’à la Deutsche Bank, clé de voûte du « capitalisme rhénan » – ont donné à plusieurs reprises des signes inquiétants de fragilité. Pour l’instant, la BCE s’est donc contentée de ralentir le rythme d’accroissement de son portefeuille de titres achetés sur le marché, et d’annoncer son intention d’en stabiliser le montant à partir de fin décembre 2018. Elle a indiqué qu’elle n’envisageait pas de remonter ses propres taux directeurs avant l’été 2019.
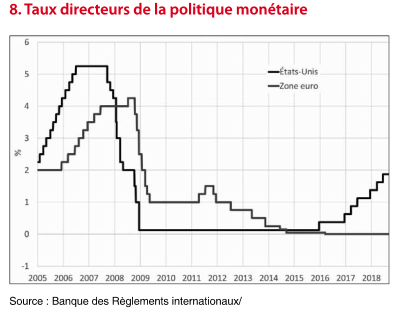
Sortir des dilemmes de la politique monétaire, c’est donc réorienter la création monétaire, et l’utilisation de l’argent ainsi mis en circulation.
Les lecteurs d’Économie et politique connaissent les critères qui devraient guider cette réorientation : le crédit devrait contribuer à l’élévation du potentiel de création de valeur ajoutée disponible pour les populations en favorisant, à cet effet, le développement de l’emploi, de la formation, des services publics.
Les moyens techniques de donner à la création monétaire une sélectivité capable de répondre à ces critères et de priver les marchés financiers de leur alimentation existent : les politiques monétaires « non conventionnelles » en ont fait un usage abondant depuis dix ans, comme on l’a vu dans les paragraphes précédents. On peut agir sur trois leviers au moins :
– une nouvelle sélectivité du refinancement des banques. Le taux pratiqué par la banque centrale serait d’autant plus réduit que les crédits refinancés contribueraient à la réalisation d’investissements répondant à des critères économiques, sociaux et écologiques ; à l’inverse, les opérations financières (achats de titres, spéculations sur les taux de change, LBO…) subiraient des taux prohibitifs ;
– le remplacement du quantitative easing par la création d’un fonds de développement économique, social et écologique européen financé par la BCE pour le développement des services publics, à partir de projets démocratiquement élaborés dans chaque pays de l’Union européenne ;
– de nouvelles normes de réglementation des banques, prenant en compte non le rendement financier de leurs opérations mais leur contribution à la création de valeur ajoutée pour la population : les banques ne peuvent pas être en bonne santé si l’économie va mal ;
– une nouvelle alliance de l'Europe avec les pays émergents pour imposer une alternative à l'hégémonie du dollar. Comme l'a préconisé le gouverneur de la Banque centrale de Chine en avril 2009, rejoignant une proposition faite par Paul Boccara dès 1983, la première étape pourrait être la création d'un nouvel instrument de réserves international à partir des drotis de tirage spéciaux du FMI.
Ce qui manque, c’est la force politique de mobiliser ces moyens au service de nouveaux objectifs sociaux et écologiques. Cette force ne peut venir que de mobilisations sociales et politiques, dans les entreprises et dans les territoires, pour peser sur le choix des investissements privés et publics.
En ce sens, mettre l’accent, pour les prochaines élections européennes, sur des solutions radicales aux dilemmes de la BCE, comme Ian Brossat, chef de file des candidats communistes, a commencé à le faire, est tout autre chose qu’un projet technocratique. C’est une réponse politique à des questions qui sont aux premiers rangs des préoccupations de nos concitoyens.
Par Chassaigne André, le 30 June 2018

Pour les internationalistes que nous sommes, la construction d’une coopération entre les peuples va de soi. Une coopération fondée sur un idéal de justice sociale, de paix partagée et de recherche du bien commun. Cet idéal est celui du mouvement ouvrier. Il est aussi celui de grands intellectuels et hommes politiques qui l’ont accompagné, à l’instar de Marx et Jaurès. Mais il est à l’opposé de ce qui est depuis 30 ans la colonne vertébrale de l’Union européenne (UE), à savoir la mise en œuvre active de toutes les exigences du capital financier et le déploiement de l’idéologie néolibérale.
De l’opposition à l’Acte unique européen de 1986, aux grandes batailles démocratiques contre le traité de Maastricht de 1992, puis contre le traité établissant une constitution pour l’Europe de 2005, les communistes ont sans aucun doute été les plus constants opposants à une construction européenne qui tournait le dos aux intérêts des peuples. Ils l’ont été en cherchant toujours à faire vivre une voie politique et sociale alternative, à l’opposé de réponses simplistes et populistes. Aujourd’hui, la dictature du marché, défendue sans relâche par les libéraux qui se sont succédés au pouvoir, n’a jamais autant produit de conséquences désastreuses sur la vie et la conscience des peuples européens comme sur ceux du Sud ou de l’Est. L’idéologie des vertus innées des marchés et des effets inclusifs supposés de la concurrence libre et non-faussée recouvre une dictature féroce du capital et de son bras armé, les marchés financiers. Dans les faits, c’est la course au moins-disant salarial, social, fiscal et écologique au sein même du cadre communautaire. Pris en défaut par la réalité économique et sociale du modèle politique qu’ils défendent, pris en flagrant délit de montée des nationalismes et de la xénophobie au sein même de l’Union européenne, les serviteurs politiques des forces d’argent, comme Emmanuel Macron, n’ont d’autre choix que de parer leur européisme de la toge de « progressistes », opposants aux replis nationalistes, pour tenter de prolonger la mise en œuvre de la doxa néolibérale dont ils sont les dévots.
Cette tentative entend imposer aux autres forces politiques un cadre déterminé et binaire pour le débat politique européen qui s’ouvre jusqu’aux prochaines élections de mai 2019 : « plus ou moins d’Europe » sans parler contenu, pouvoirs, institutions.
Quelle tromperie ! La fuite en avant dans le fédéralisme, tout autant que le repli nationaliste, entretiennent la domination du capital et s’opposent à la coopération entre peuples et nations librement associées que notre époque exigerait pourtant. Cette opération peut tétaniser les vrais progressistes refusant cette UE tout autant que les égoïsmes nationaux. Il faut la déjouer, car elle cible l’ensemble du mouvement social et progressiste européen, et plus particulièrement les communistes que nous sommes, porteurs d’une construction politique alternative permettant de contester efficacement l’hégémonie du capitalisme financier mondialisé.
Plus que jamais, il nous appartient donc de démontrer que nous ne plongerons pas dans le piège qui nous est tendu. Ne cédons pas à la tentation de replis dans le combat d’idées, quel que soit le confort politique qu’ils puissent procurer. Repli sur un combat politique « nationalisé » sur des bases populistes, sous-entendant qu’il suffirait de régler les choses « entre nous » avec « notre » patronat français, ou repli autour d’une perspective européenne fantasmée, les deux occultent d’un revers de main tout projet émancipateur européen et son adversaire : la domination du capital.
Aussi, je crois que nous devons répondre par la force de l’intelligence collective aux côtés de toutes celles et tous ceux qui luttent déjà, en s’appuyant sur leurs combats et en rassemblant leurs volontés de changer les choses au niveau européen. Pour une véritable mutualisation européenne, visant la promotion de l’emploi, des capacités humaines et des biens communs et non pour viser « la concurrence libre et non faussée ». Bref une toute autre mondialisation.
Car le plus grave risque est de déboucher demain sur une Europe néolibérale sans vision autre que les calculs égoïstes de taux de profit, une Europe tancée et corsetée en permanence par des gouvernements nationalistes et leurs appuis au sein des institutions européennes, une Europe qui dresse des murs entre tous les peuples tout en restant une vaste zone de circulation du capital et de concurrence antisociale, appuyant de fait le dollar US, une zone d’aspiration de dividendes captés sur une production en Europe ou dans des pays dominés.
Soyons exigeants dans la construction d’une vision progressiste de l’Europe. Mettons dans le débat public de véritables propositions d’action.
Pour cela, il nous faut mettre au cœur de la bataille idéologique les points d’affrontement les plus saillants avec l’Europe du capital. Car sous les « marchés » il y a le capital : dénoncer non pas le niveau des dettes mais leurs conditions antisociales illégitimes et le poids des intérêts qui vampirisent les peuples ; les méfaits de la compétition fiscale et sociale au sein de l’Union européenne ; le contresens économique d’une Banque centrale européenne (BCE) au service du capital financier, celui des banques et des multinationales ; une course aux délocalisations et exportations de capitaux, à l’évasion fiscale qui empêche toute coopération ; une Europe des monopoles sur l’utilisation de l’argent et sur les données ; le chômage de masse, la précarité, le creusement des inégalités sociales et territoriales ; l’accélération des impacts écologiques du capitalisme financier ; l’alignement sur la politique militaire de l’OTAN… Levons le voile sur cette supposée toute-puissance des « marchés » et le manque de leviers disponibles. Qui peut croire à la fable de l’impuissance quand 14 600 milliards d’euros de richesses ont été produites l’an dernier, faisant de l’UE la seconde zone économique mondiale. C’est le fruit de l’activité des travailleurs et des créateurs d’Europe, dans les services publics comme dans les entreprises. Il faut admettre que c’est à eux, comme à celles et ceux qui y vivent, et non aux marchés, de décider quelles richesses produire, avec quelles techniques, et quels financements. Révolutionnaire !
Première priorité : porter la perspective d’un développement des services publics à la hauteur des défis de notre siècle dans tous les pays d’Europe. Cette nécessité pose inévitablement deux questions : celle des ressources nouvelles à affecter et permettant d’ouvrir la porte de nouvelles dépenses financées en coopération ; celle de la nature et des objectifs de ces nouvelles dépenses.
Commençons par le scandale absolu que représentent les milliards d’euros déversés à des taux nuls, voire négatifs, par la BCE ‒ institution publique ‒ sur les marchés financiers pour être accaparés par les grandes banques et les multinationales, qui les utilisent pour spéculer, délocaliser, racheter des entreprises en supprimant des emplois, ou… pour écraser les États en les leur reprêtant plus cher. La raison en est que la BCE les accorde sans contrepartie ni fléchage sérieux sur ce qu’elles en font. Et le résultat est là : les effets de l’action de la BCE sur l’économie réelle sont quasi invisibles, sauf pour les détenteurs d’actifs qui voient la valeur de leurs portefeuilles grimper en flèche, aggravant encore les inégalités. Être innovant et audacieux sur le plan européen, ce n’est pas faire abstraction de ce problème de fond.
‒ C’est proposer que les 700 milliards de crédits bancaires refinancés par la BCE aillent à des investissements répondant à des critères précis en matière économique (création de valeur ajoutée dans les territoires), sociale (sécurisation des emplois et des revenus, formation) et environnementale (économie de matières et de capital consommés, réduction des émissions de gaz à effet de serre, des pollutions et des atteintes à la biodiversité).
‒ C’est appeler à la lutte pour créer une nouvelle institution, un Fonds européen pour le développement solidaire des services publics, afin que les 2 600 milliards déversés par la même BCE sur les marchés financiers sous forme d’achats de titres servent à financer des projets démocratiquement élaborés dans chaque pays membre, avec le soutien de la population, en faveur du développement des services publics : enseignement, formation, recherche, santé, transports, énergie, environnement, culture…
‒ Hors zone euro, il faut un mécanisme similaire pour appuyer l’élévation du niveau de protection sociale dans l’Europe de l’Est afin de calmer le jeu de la concurrence au moins-disant social.
C’est clairement une politique de rupture.
Deuxième priorité : ce Fonds européen, comme les budgets nationaux devrait être renforcé par une lutte sérieuse contre l’évasion fiscale et une taxe sur les transactions financières conséquente. La fraude fiscale concerne les plus riches Européens, actionnaires des grands groupes et héritiers des grandes familles, qui spolient les budgets publics de 510 millions d’Européens. Ce trou noir fiscal représente chaque année 1 000 milliards d’euros de recettes soustraites au bien public dans l’Europe des 28 ! C’est plus, en une seule année, que la totalité du budget actuel de l’Union sur six ans ! Poussons avec détermination la construction d’un programme d’harmonisation fiscale vers le haut et d’une vraie force européenne d’intervention contre l’évasion fiscale à l’appui de services fiscaux nationaux renforcés. Faisons sauter les verrous comme celui de Bercy, maintenu en l’état malgré les effets de manche. Que l’Europe prenne l’initiative d’une COP fiscale mondiale, associant très largement les citoyens, les syndicats, les ONG, les États. Portons ainsi jusqu’au bout une ambition fiscale fidèle aux valeurs de progrès européennes et de coopération entre les peuples.
Fonds européen, autre refinancement des banques, sérieuse lutte anti évasion fiscale et harmonisation vers le haut, permettraient ainsi d’orienter nos investissements d’avenir. Mais avec une ambition forte, dans la clarté, brisant le marbre du dogme néolibéral de l’austérité et de la rentabilité financière par une stratégie économique, sociale et écologique portée dans la durée. C’est la bataille politique autour de cette ambition qui rendra possible une remise en cause du Pacte de stabilité et son remplacement par de nouveaux traités de coopération.
Troisième priorité : répondre au défi du réchauffement climatique par une politique commune de l’énergie qui intègre la spécificité des situations des différents pays membres et qui soit puissamment contributrice à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. La maison brûle, mais les néolibéraux pointent encore et toujours le doigt vers les vertus du marché. L’énergie, à la base de toute activité et de toute perspective de développement humain durable, doit être définie comme un « bien commun » au niveau européen et être dégagée des logiques de rentabilité et de concurrence promues actuellement. Il s’agit de marcher sur deux jambes : un financement dégagé des marchés financiers avec leur dogme de rentabilité, des règles de coopération territoriale, sociale et écologique s’opposant au dogme de la concurrence. Les contraintes actuelles de la concurrence amplifient en effet les déséquilibres au sein de l’UE comme la précarité et les inégalités d’accès à ce besoin fondamental. Cette politique de l’énergie nécessite à la fois un grand plan européen d’investissement matériel, de recherche, d’embauches et de formation, en faveur de la transition énergétique et le déploiement d’infrastructures communes, notamment en matière de transport (électrique, ferroviaire…). Elle exige une coopération européenne des acteurs de l’énergie, depuis la production jusqu’à la distribution, s’appuyant sur une agence européenne de l’énergie et encourageant de grands services publics nationalisés de l’énergie, pour maîtriser aussi la demande d’énergie et être en capacité de répondre aux objectifs de réduction drastique des émissions de CO2, sinon ils ne seront jamais atteints. Seule cette politique coordonnée et solidaire sera en capacité de convaincre tous les pays de renoncer à court terme aux énergies carbonées.
Quatrième priorité : les droits des salariés. Pas seulement le droit du travail qui doit être protecteur, les salaires qui doivent être tirés vers le haut et encadrés par un salaire minimum calculé dans chaque pays de l’UE. Mais aussi de tout autres droits d’information, d’intervention et de décision des travailleurs comme des citoyens sur les décisions des entreprises de taille européenne ou mondiale.
Autre priorité enfin, à laquelle je suis très attaché, trop souvent occultée. Le volet agricole et alimentaire. Il nous faut porter la perspective d’une transformation de la PAC en Politique agricole et alimentaire commune (PAAC). Ne laissons pas filer entre nos doigts la seule politique européenne coordonnée, progressivement défaite par le fanatisme de marché. Replaçons la « souveraineté alimentaire » et la « transition écologique de l’agriculture » au cœur de cette politique. Pour cela, la rupture avec tous les accords de libre-échange ratifiés ou en cours de négociation est indispensable. Mais cela ne suffit pas. La refondation d’une PAAC doit s’appuyer sur des mesures structurelles avec une garantie des prix d’achat et de revenus pour les actifs agricoles, et une stratégie assumée de montée en gamme de toutes nos productions européennes, qui s’appuie notamment sur le développement de l’ensemble de nos productions sous signes officiels de qualité et d’origine. Voilà des bases solides pour garantir à la fois la qualité de l’alimentation de 510 millions d’Européens et changer globalement et efficacement nos pratiques culturales et modes de production.
Plus généralement, on le voit, il faut de toutes autres relations économiques de l’Europe avec le reste du monde : une politique de co-développement, de paix, d’accueil. Cela appelle deux priorités : de nouveaux types de traités visant une maîtrise des investissements et du commerce en les soumettant au co-développement de l’emploi, de la santé, des productions et des biens communs, à la place des accords actuels à abroger, et une monnaie commune mondiale alternative à l’impérialisme du dollar, en agissant pour transformer les institutions internationales (OMC, FMI…) et pour de nouvelles relations avec les BRICS et les pays du Sud.
Je mesure certes les difficultés de notre tâche dans cette bataille idéologique de grande ampleur. Mais l’enjeu est énorme. Pas seulement dans la perspective des prochaines élections européennes, mais aussi parce que c’est l’avenir des peuples européens qui est en jeu. C’est aussi, plus largement, l’avenir de la vie sur notre planète, livrée aux prédateurs sans scrupule, qu’ils soient les agents du capitalisme mondialisé ou des aventuriers de la politique.
le 27 June 2018

Face à une administration Trump qui déroule des mesures protectionnistes et unilatérales, le Conseil européen qui se tient cette semaine, au-delà d’une cession qui va être marquée par la crise migratoire sur ton de nationalisme et de protectionnisme, s’apprête à approuver, après le CETA, un nouvel accord de libre-échange avec le Japon (JEFTA), en dehors de tout jeu démocratique. Encore une fois, loin d’un cadre transparent, cet accord de libre-échange risque d’être adopté par les dignitaires européens qui sont attachés à la culture du secret.
On nous annonce que l’abaissement des droits de douane contenus dans le JEFTA doperont les exportations, favoriseront les producteurs européens dans le domaine de l’agroalimentaire et les industriels japonais dans le domaine de l’automobile. Mais surtout, on ne nous parle pas du risque, comme dans tout accord de libre-échange passé, de favoriser les groupes multinationaux les plus puissants et de ruiner les producteurs locaux européens et japonais.
Pour faire passer la pilule, on tente de rassurer en disant qu’a été rejeté partiellement le mécanisme juridique présent dans les précédents traités, à savoir celui des « tribunaux arbitraux » qui permettent aux entreprises d’attaquer les États en justice si elles se sentent lésées sur leurs profits. Mais en fait, il ne faut pas se réjouir trop vite, car la proposition est de les remplacer par des tribunaux « multilatéraux », dont le fonctionnement institutionnel précis reste encore flou. Une fois de plus, le contenu de l’accord risque de laisser le pouvoir aux transnationales et pourra être adopté par un simple vote du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen, sans consultation des parlements nationaux.
Sur le plan écologique, rien sur les garanties liées à l’environnement, pas plus sur le principe de précaution. Pire encore, par des mécanismes comme la « coopération réglementaire », rien ne pourra être décidé politiquement sans que les transnationales de droit japonais et européen n’aient en amont leur mot à dire en termes d’environnement, d’agriculture, de protection du consommateur, des données personnelles, tout comme des droits sociaux.
Concernant la France, le fait que le président Macron ne s’y oppose pas résonne comme un démenti absolu adressé à ses promesses de campagne « d’une Europe qui devrait protéger les travailleurs face à la concurrence sauvage ». Plutôt que d’être une instance de régulation de la mondialisation néolibérale en limitant la toute-puissance des grands groupes multinationaux, l’Union européenne en est l’un des principaux agents, en donnant un cadre aux multinationales à l’intérieur duquel elles peuvent exercer un pouvoir absolu. Cette politique commerciale est le contraire d’une Europe démocratique et protectrice. Loin des sentiers de la coopération, elle favorise une concurrence mortifère, mettant en péril les droits sociaux, la santé, les services publics, les droits des consommateurs, des travailleurs, des agriculteurs.
Il faut arrêter la fuite en avant des accords commerciaux négociés et adoptés par l’Union européenne. La France, qui, par son président, veut reprendre sa place à l’échelle européenne, se doit de refuser d’adopter le JEFTA lors du vote à venir au Conseil de l’Union européenne. Elle doit également engager de vrais débats démocratiques sur ces enjeux et la tenue d’un référendum sur le CETA, premier accord de cette longue série.
Laurent Péréa
membre du Conseil national du PCF
chargé des questions de libre-échange
article paru dans Communistes du 27 juin 2018
le 22 June 2018

LA DR NORD DE MIDI PYRENES DEPUIS LUNDI
La convergence des luttes s'enracine dans leur multiplicité et à l'entreprise. 280 sites ENEDIS bloqués ou occupés dont celui d'Albi. Comme pour le service public ferroviaire, actifs, retraités, usagers,..... soutien aux blocages, coupures, dans le Tarn et la Tarn et Garonne.
le 21 June 2018

Des prix délirants sont imposés au nom de l’innovation même si celle-ci n’est pas synonyme de progrès thérapeutiques. Tel est le constat de huit associations qui refusent de voir l’Assurance maladie sombrer dans cette dérive qui ne sert que l’intérêt des firmes. Elles exigent de la transparence et un autre système de fixation des prix.
Le « Glivec » est un médicament qui a révolutionné le traitement de cancers rares du sang et de la moelle osseuse. Commercialisé depuis 2001, c’est un cas d’école. Malgré sa rentabilité croissance suite à une utilisation toujours plus large, son prix n’a pas baissé. Il coûte jusqu’à 40.000 euros par an. Le « Keytruda » est, lui, indiqué dans le traitement de certains mélanomes. Il coûte 72.000 euros par an alors que la Haute Autorité de Santé (HAS) a estimé que « l’amélioration du service médical rendu (ASMR) » était « mineure par rapport aux traitements existants ».
Ces deux exemples sont tirés du libre blanc qu’ont publié hier huit associations(*). Ensemble, elles dénoncent « l’inflation continue, injustifiée et injustifiable » des prix des nouveaux médicaments. « Nous avons conscience de l’importance de nouveaux traitements et de l’apport de l’industrie grâce à sa recherche, nous ne nions pas cette réalité », précise en préambule Marc Paris, responsable de communication de France Assos Santé qui fédère 80 structures s’occupant de patients. « Mais le système manque de régulation et de transparence », pointe-t-il.
De nombreuses étapes sont certes prévues par la loi pour la fixation des prix médicaments mais, au final, « on ne sait pas grand chose », explique Marc Paris. En cause, la négociation « opaque » des prix entre gouvernements et industriels du secteur; les « pressions » exercées par les laboratoires et leur « manque de transparence », concernant les coûts de production et de recherche ou encore l’évaluation des médicaments. D’où l’exigence de « transparence ».
Insoutenable pour l’Assurance maladie
Une exigence d’autant plus nécessaire que le blocage est proche assurent les auteurs du livre blanc. « Si on ne change rien, il y aura toujours plus de médicaments toujours plus chers. Cela va devenir insoutenable pour le système solidaire qu’est l’Assurance maladie », analyse Marc Paris. « On est dans une sorte d’impasse si on ne trouve pas le moyen de faire évoluer le système, de ne financer que ce qui doit être financé. Ce sera problématique pour les patients qui risquent de ne plus avoir accès à l’innovation si ce n’est ceux qui auront les moyens de se la payer. Mais aussi pour l’industrie car le secteur est rentable grâce à son volume ».
Ce livre blanc est publié à la veille du Conseil stratégique des industries de santé qui se déroulera début juillet. Le gouvernement y réunit tous les industriels du secteur. Problème : si l’innovation a bien été mise au menu, c’est pour parler de développement économique, pas de coût ni de la fixation des prix. « Les règles consenties par l’État sont inefficientes et les instruments utilisés par les pouvoirs publics sont inflationnistes », explique Olivier Maguet de Médecins du Monde. Aussi les associations plaident-elles pour un nouveau système de fixation des prix.
Angélique Schaller (La Marseillaise, le 21 juin 2018)
(*) UFC Que Choisir, Médecins du monde, Médecins sans frontière, la Ligue nationale contre le cancer, France assos santé, Aides, Prescrire et l’association de chercheurs Universités Alliées pour les Médicaments essentiels.
En 20 ans, les prix des médicaments anti-cancéreux ont explosé. « Selon l’assurance-maladie, le coût moyen d’une année de vie gagnée est passé de 15.877 euros en 1996, à 175.968 euros en 2016 », rappelle la ligue contre le Cancer dans le livre blanc. L’oncologie est particulièrement concernée par les tarifs délirants des médicament innovants. Et le problème va très prochainement s’aggraver prévient l’association. Une nouvelle génération de traitement -CART-T- arrive. « Ils consistent en une modification génétique du système immunitaire de la personne malade afin de le programmer pour qu’il reconnaisse et détruise les cellules cancéreuses », explique la Ligue. Deux d’entre eux ont été approuvés aux Etats-Unis et sont en cours d’évaluation auprès de l’Agence Européenne du Médicament : le « Kymriah » de Novartis et le « Yescarta » de Kite Pharma/Gilead Science. Le premier coûte 475.000 dollars par patient, le second 373.000. « A de tels niveaux de prix, combien de temps sera-t-il possible de donner un accès aux meilleurs traitements pour toutes les personnes en ayant besoin ? » s’interroge l’association, « Des critères d’accès, par exemple sur l’âge ou le mode de vie, devront-ils être définis ? »
Angélique Schaller (La Marseillaise, le 21 juin 2018)
le 20 June 2018

L’intervention des élus locaux, Michel Loussouarn en tête, a permis de reporter la fermeture annoncée de la Trésorerie au 1er janvier 2019 mais, pour le premier magistrat de la commune, la vigilance reste de mise.
Le maire, Michel Loussouarn, a rencontré, lundi, les représentants de la Direction départementale des finances publiques qui l’ont informé renoncer à la fermeture de la Trésorerie de Rosporden au 1er janvier 2019. « Les arguments des élus locaux ont été partiellement entendus, indique Michel Loussouarn. Partiellement seulement puisque la DGFIP (Direction générales des finances publiques) maintient son projet de ne conserver, à l’horizon 2021, qu’un centre des finances publiques par intercommunalité dans le Finistère. Durement touché par la réduction des effectifs du ministère des Finances, le département pourrait en effet subir une perte comprise en 40 et 50 agents en 2019. Dans ces conditions, ce sont malheureusement les Trésoreries des communes rurales et périurbaines - celles qui pourtant ont déjà moins de services publics - qui devraient payer la note. J’ai rappelé les arguments en faveur du maintien de la Trésorerie de Rosporden : assurer un niveau de service de qualité pour tous les contribuables, notamment les plus éloignés des usages numériques ; garantir en proximité les missions d’expertise et de conseils pour les collectivités ; contribuer à l’aménagement durable du territoire. En effet, il serait dommageable que le second pôle de l’agglomération soit privé d’un tel service alors que son dynamisme démographique comme celui des communes voisines n’est plus à démontrer. J’ai proposé à la DGFIP qu’un groupe de travail puisse réunir ses représentants et les élus locaux afin de trouver des solutions qui garantissent ces objectifs malgré les contraintes imposées par Bercy ». « Nous demeurons vigilants et mobilisés », conclut le maire.