le 04 juillet 2018

L'institut annonce la plus forte hausse de créations d’emplois depuis 2007 et la plus forte baisse annuelle du chômage depuis 2008. 2017 signe-t-elle un retour massif vers l'emploi ? Pas sûr. Les indicateurs de précarité sont eux, au vert.
« L’emploi accélère et le chômage baisse davantage ». Voici le ton étonnamment positif de la « vue d’ensemble du marché du travail en 2017 » publiée, hier, par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Emploi et chômage sont un sujet majeur. « Je veux être le président du travail, je n’ai pas d’autres promesses », avait clamé Macron, dès décembre 2016, devant un parterre d’entrepreneurs. C’est ce qui justifie toutes ses mesures destinées à « assouplir le marché du travail », « favoriser l’investissement » et « transformer le droit du travail ».
Affirmant que 27,8 millions de personnes sont en emploi en France et que le taux de chômage est à 9,4%, cette « vue d’ensemble » reprend les données publiées en avril dernier par l’Insee dans sa « photographie du marché de l’emploi 2017 ». La nouveauté est dans les commentaires mis en avant : « la plus forte hausse de création d’emploi depuis 2007 », la « plus forte baisse en moyenne annuelle du chômage depuis 2008 » et un « halo autour du chômage » -personnes prétendant à un emploi, mais qui ne répondent pas aux critères pour être enregistrées comme chômeur- qui arrête enfin de progresser. A noter que 2017 signe un léger retour de la croissance, déjà revue à la baisse pour ce début 2018.
Pour autant, la situation invite-t-elle à l’optimisme ? Dans l’emploi salarié qui constitue 90% des cas, la part des CDI a encore diminué passant de 90 à 88%. Et pour cause. La part des CDD dans les embauches de 2017 était de 87% et parmi eux, 30% ne durent qu’un jour… L’intérim continue sa course folle : il a été multiplié par 5 en trente ans. Les temps partiels subis sont toujours aussi importants, frappant majoritairement les femmes (9,4%). Quant au sort réservé aux jeunes, la précarité reste la norme : moins d’un jeune sur deux est en CDI et le chômage des 15-24 ans a certes reculé entre 2016 et 2017 mais il reste bien au-dessus des 20%.
Les seniors ne sont guère mieux lotis. Ce sont eux qui portent la hausse du taux d’activité, une « hausse est imputable aux réformes des retraites successives et aux restrictions d’accès aux dispositifs de cessation anticipée d’activité », commente explicitement le document détaillé.
L’Insee attire également l’attention sur des « salaires qui accélèrent ». Elle souligne que c’est via l’accord d’entreprise que les hausses sont les plus importantes. Plus qu’avec les augmentations des minima conventionnels discutés au niveau de la branche ou de la revalorisation du Smic décidée au niveau de l’État. Cependant, cette « accélération » est pour le moins poussive : 0,30% de hausse moyenne. (L'inflation dépasse 1,4%). Si la France est la 6e puissance économique mondiale, cela ne se retrouve pas dans l’échelle des salaires. Une récente étude de l’OCDE montre qu’avec 38.513 euros de salaire moyen en 2017, Paris est loin derrière la Norvège (48.149 euros ), le Danemark (47.056 euros) ou l’Allemagne (41.802 euros). Pire, elle se retrouve à la 26e place quant aux perspectives d’augmentation des salaires en 2018. Entre précarité et faiblesse des salaires, on est encore très loin du « travail c’est ce qui paie, c’est ce qui émancipe » promis par le candidat Macron.
Angélique Schaller (La Marseillaise, le 4 juillet 2018)
La Marseillaise, le 4 juillet 2018
L’analyse de Camille Signoretto, économiste spécialisée dans le domaine du travail.
Maître de conférences à l’université d’Aix-Marseille, Camille Signoretto est membre du Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail (LEST).
La Marseillaise. Plus de créations d’emploi et le taux de chômage le plus bas depuis 10 ans : l’année 2017 signe un tournant ?
Camille Signoretto. Ces deux éléments sont très fluctuants sur le long terme. Cela fait 25 ans que le chômage est supérieur à 7% pourtant il y a eu deux périodes où il est redescendu, entre 1997 et 2001, puis entre 2006 et 2008, avant de repartir à la hausse. Il en va de même pour les créations d’emploi qui sont très liées à la croissance, très fluctuante. Tout ceci est donc à prendre avec précautions.
La Marseillaise. L’important recours au CDD ne montre-t-il pas une précarisation du marché du travail plus qu’une reprise ?
Camille Signoretto. Oui et non. On voit, certes, une très forte hausse des CDD dans les embauches. Néanmoins, le CDI reste la norme. Ce qui est très inquiétant c'est le recours à des CDD de plus en plus courts. Mais c’est un phénomène mal connu et la Dares [centre statistique du ministère de l’Emploi] a lancé des projets de recherche pour en comprendre les ressorts et les effets sur les salariés. D’autant qu’il semblerait que ces CDD très courts concernent souvent les mêmes individus, y compris chez un même employeur. Cela correspondrait à une segmentation de plus en plus forte plutôt qu’une précarisation. Elle touche les personnes peu diplômées et les femmes majoritairement. Ce serait en fait les mêmes inégalités qui s’accentuent sur un certain nombre de personnes. C’est cela qu’il faudrait examiner et cibler.
La Marseillaise. Idem pour les temps partiels ?
Camille Signoretto. Le recours au temps partiel est plutôt stable depuis 15 ans. Ce qui augmente, c’est le temps partiel subi, qui touche d’abord les femmes et les jeunes. Et il ne concerne pas que les CDD, mais également les CDI. C’est important à préciser car il faut se garder d’opposer des groupes de salariés, avec les CDI qui seraient privilégiés par rapport aux autres. La Dares a montré que des CDI « fragilisés » -la peur de perdre son emploi- et en « sous-emploi » -temps partiel subi- existent.
La Marseillaise. Cette segmentarisation de l’emploi est-elle favorisée par Macron ?
Camille Signoretto. La flexibilité qu’il a voulu passe d’abord par la possibilité de licencier et s’attaque aux CDI présentés comme privilégiés. Son hypothèse est que la réglementation est un obstacle à l’embauche. Rien ne le prouve. Une autre option est de regarder la financiarisation des entreprises amenant un court-termisme qui se retrouve jusque dans la gestion de la main d’œuvre. De plus, toutes les entreprises n’ont pas ce type de comportements. Seul un groupe particulier les cumule. Il faudrait donc réfléchir à qui ils sont et comment modifier leur comportement. Ce n’est pas le cas.
Entretien réalisé par Angélique Schaller (La Marseillaise, le 4 juillet 2018)
2,3 millions de travailleurs souhaitent changer d’emploi. Les raisons sont diverses et dépendent souvent du statut du salarié. Une envie de changement qui aboutit peu. Explications.
Triste constat : près d’un actif sur dix, soit 2,3 millions de travailleurs en France, voudraient changer d’emploi en 2017 selon l’Insee. Le dossier publié par l’institut revient notamment sur les raisons qui poussent les employés à se reconvertir.
Plus d’une personne sur quatre souhaitant changer d’emploi recherche de meilleures conditions de travail. Les personnes âgées et les femmes sont les premières à invoquer cette raison comme motif de changement.
Changer d’emploi pour de meilleurs revenus est la seconde raison pointée du doigt par l’Insee. C’est le cas « d’un peu moins d’un quart des personnes souhaitant changer d’emploi », note le rapport. Ce qui est particulièrement vrai pour les ouvriers, les employés et les non-salariés, comprendre notamment les agriculteurs et les artisans entre autres.
La troisième raison à cette volonté de changement d’emploi est la stabilité. Un cinquième des personnes concernées veulent un emploi plus stable par crainte de perdre le leur. C’est surtout le cas pour les 15-24 ans, premiers touchés par les emplois précaires, tels que l’intérim ou les CDD de moins de 20 jours.
Des raisons qui difèrent principalement selon le type de contrat
Le type de contrat influe sur les raisons pour lesquelles les salariés veulent changer d’emploi. Les CDD sont deux fois plus nombreux que les CDI à espérer une alternative. Alors que les CDD représentent 87% des embauches en 2017, 30% de ces contrats durent 1 jour. D’où la nécessité pour 50% des actifs en CDD de rechercher un nouvel emploi plus stable. Alors que seulement 10% des actifs en CDI évoquent ce motif comme les poussant au changement.
En revanche, les CDI sont plus de 30% à rechercher des meilleures conditions de travail. Autre donnée étonnante de l’Insee, seulement 5% des actifs en CDD souhaitent changer d’emploi pour cette même raison.
Les non-salariés recherchent en priorité des emplois mieux rémunérés. Ils sont également les plus attirés par d’autres secteurs et d’autres métiers que les leurs.
Des envies d’ailleurs peu viables sur le court terme
Pourtant, dans les faits, très peu de personnes réussissent à changer de travail. En effet, 40% d'entre elles ont recherché activement un nouvel emploi au cours du mois précédant l’étude. Plus de trois mois plus tard, près de 78% n’avaient pas changé de poste, contre seulement 9%.
Le manque de temps est le frein majeur à la recherche active d’emploi. C’est le cas pour la moitié des actifs affirmant vouloir changer. Il est donc très compliqué de trouver des alternatives viables sur le court terme, selon l’Insee. À tel point que les actifs réussissent à trouver un autre travail « moins souvent que les sans-emploi souhaitant travailler », selon l’institut. De même que 12% de ces actifs souhaitant changer d’emploi, et qui sont en recherche, s’en retrouvent finalement privés.
Amaury Baqué (La Marseillaise, le 4 juillet 2018)
Par Durand Jean Marc, le 01 juillet 2018

Budget réduit tel est l’objectif du projet de loi finances pour 2019 que le gouvernement s’apprête à proposer. Pour cela il va falloir tailler dans les dépenses de certains ministères. Une cure d’amaigrissement des dépenses publiques est au menu. Les lettres de cadrage budgétaire pour l’année 2019 envoyées aux divers ministères le confirment. La première présentation du projet global qu’en a fait le Premier ministre en cette rentrée donne une forme plus concrète à ces choix.
Fort des résultats obtenus en 2017, le gouvernement veut accélérer sa marche vers l’équilibre budgétaire au sens maastrichtien du terme. En effet en 2017 le solde des administrations publiques centrales a atteint -65,3 Md€ contre -76,8 Md€ en 2016, traduisant dans les faits le passage du solde de l’État de -73,8 Md€ à -64,3 Md€ ainsi que de celui des organismes divers d’administration centrale.
Quant au solde des administrations de sécurité sociale il est redevenu positif (+5,0 Md€ contre -2,2 Md€ en 2016). Cela est la traduction de l’application stricte de l’objectif national de dépenses d’assurance-maladie (Ondam) fixé pour 2017. Même le solde du régime général et du fonds de solidarité vieillesse a réalisé des prouesses en n’enregistrant qu’un déficit de -5,1 Md€, niveau jamais atteint depuis les années 2000.
S’agissant du solde des administrations publiques locales, celui-ci demeure excédentaire en 2017, comme en 2016, bien que cet excédent se soit réduit (+0,8Mds€ en 2017 contre +3,0 Mds€ en 2017). Cela tient à la reprise des investissements dans les collectivités territoriales, besoins urgents et approche des élections produisant leurs effets.
Pour le gouvernement, la croissance devrait rester solide, à +2,0 % en 2018 et +1,9 % en 2019 se bornant aux prévisions du Programme de stabilité. Il analyse en effet le fléchissement de la croissance de ce début d’année à un contrecoup d’une fin d’année 2017 très dynamique. Toujours selon les prévisionnistes gouvernementaux, entre 2020 et 2022, l’économie française continuerait de croître à un rythme de +1,7 %, c’est-à-dire à un rythme plus soutenu que l’estimation potentielle de +1,3 % en moyenne sur la période. Un tel résultat contribuerait au redressement de l’écart de production1.
Dans le même temps, le contexte économique serait marqué par le redémarrage de l’inflation, tirée notamment par l’augmentation des prix de l’énergie. L’inflation totale atteindrait +1,4 % en 2018, après +1,0 % en 2017, du fait de la hausse du prix du pétrole et de l’augmentation de la fiscalité indirecte particulièrement de celle qui y est attachée. Elle pourrait diminuer quelque peu en 2019 dans l’hypothèse d’une stabilisation des cours du pétrole et en raison d’une moindre hausse de la fiscalité indirecte.
Les grandes lignes de l’objectif budgétaire 2018-2019 se résument ainsi :
‒ un ajustement articulant maîtrise de la dépense et baisse de prélèvements obligatoires (une reprise en somme des objectifs de la mission CAP 2022, voir article par ailleurs) ;
‒ l’ajustement structurel atteindrait 0,1 puis 0,3 % de PIB. Une telle trajectoire repose sur un ralentissement de la croissance de la dépense publique en volume, ramenée à +0,7 % en 2018 puis +0,4 % en 2019 ;
‒ à partir de 2020 la politique gouvernementale devrait s’inscrire dans la continuité de la logique des années précédentes pour en arriver à freiner en volume la croissance de la dépense publique. C’est ainsi que les comptes publics seraient rétablis et que seraient regagnées des marges de manœuvre jugées utiles en cas de crise. Le solde public se redresserait ainsi de 2,6 points entre 2017 et 2022, pour revenir à l’équilibre en 2022, porté par une baisse du ratio de dépenses publiques de plus de 3 points de PIB qui permettrait en même temps de faire baisser le ratio de prélèvements obligatoires de plus d’un point.
Pour cela le gouvernement compte énormément sur les résultats que produira le programme de transformation engagée sous les auspices de la commission CAP 2022 qui poursuit trois objectifs principaux selon les auteurs : améliorer la qualité du service aux usagers, offrir un environnement de travail modernisé aux agents publics et accompagner une baisse de la dépense publique de plus de 3 points. Ces objectifs sont portés au plus haut niveau par le président de la république lui-même et son Premier ministre. Un premier comité interministériel s’est réuni sur cette question le 1er février de cette année.
L’année 2019 sera également celle de l’entrée en application d’une réforme globale touchant l’apprentissage, la formation professionnelle et le chômage. Il s’agit pour M. Macron et son gouvernement de placer politiquement les négociations UNEDIC entre partenaires sociaux dans un cadre financier prédéfini, de rendre l’apprentissage plus accessible et moins contraignant pour les entreprises, de proposer par la formation des passerelles pour s’adapter aux besoins des entreprises.
Le suivi de l’exécution budgétaire 2018 s’inscrit totalement dans les préconisations de la LPFP (2018/2022)2 définissant un système de normes à deux niveaux : une norme sur les dépenses pilotables de l’État et un objectif de dépenses totales de l’État (ODETE). Ces normes remplacent les « norme en valeur » et « norme en volume ». Elles fixent une trajectoire des dépenses de l’État sur la durée du quinquennat avec l’objectif principal d’en assurer la maîtrise.
Le périmètre de la norme de dépenses pilotables se recentre sur les dépenses sur lesquelles il est possible d’agir. Elle intègre donc en plus des crédits ouverts sur le budget général, des comptes spéciaux et budgets annexes dont les dépenses sont assimilables à de la dépense budgétaire. Par contre elle n’intègre plus certaines dépenses contraintes comme les prélèvements sur recettes à destination de l’Union européenne ou des collectivités locales, précédemment décomptés au sein de l’ancienne norme en valeur.
Au total, le périmètre de l’ODETE comptabilise non seulement les prélèvements sur recettes ci-dessus mentionnés mais également la charge de la dette, les pensions, les concours financiers en faveur des collectivités locales, les dépenses d’investissement d’avenir et les dépenses de certains comptes d’affectation spéciale. Le périmètre des administrations publiques centrales est ainsi de facto intégré.
Jusqu’en 2022, les niveaux de la norme de dépenses pilotables et de l’ODETE sont fixés par l’article 9 de la LPFP qui implique qu’à compter de 2020 le taux d’évolution en volume de la norme de dépenses pilotables soit de -1 %. Naturellement la tenue de cet objectif nécessitera la mise en œuvre de réformes qui seront issues du processus en cours de transformation de l’action publique.
Si Bruno Le Maire a tout d’abord maintenu la prévision de croissance de 2 % de l’économie française pour 2018 et 2019, il a été contraint de reconnaître que l’économie avait enregistré un « fléchissement conjoncturel » en début d’année. Il a ensuite indiqué que les enquêtes sur le climat des affaires restaient à un niveau élevé et que Bercy attendrait la présentation du projet de loi de finances 2019, fin septembre, pour amender éventuellement son scénario.
Il est pourtant évident que cette prévision ne pourra pas être maintenue. Les deux premiers trimestres de l’année ont enregistré respectivement une croissance de +0,2 %. Dans la meilleure des hypothèses la Banque de France fixe une prévision globale pour 2018 de 1,7 %, ce qui est sans doute encore très optimiste, le chiffre de 1,4 % serait indéniablement plus réaliste.
Et ce ne sont pas les propos de Gérald Darmanin promettant que le gouvernement poursuivrait « la dynamique vertueuse, moins de dépenses, moins de déficit et moins de dette en [se] donnant les moyens d’y parvenir » et indiquant que le rythme de progression des dépenses publiques devrait être l’an prochain entre 0,4 % et 0,5 % hors inflation, soit moitié moins qu’en 2018 et trois fois moins qu’en 2017, qui sont de nature à nous rassurer quant à l’évolution de la dépense publique et aux besoins urgents des populations auxquelles celle-ci doit répondre. Des coups de rabots massifs sont prévisibles ainsi que les catastrophes qui risquent de les accompagner.
L’ambition gouvernementale traduite par Bercy est de viser l’équilibre du budget en 2022, ce que le Premier ministre Édouard Philippe affiche déjà comme un prochain succès : « Cela fait 43 ans que la France vote des budgets en déficit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c’est dingue », a-t-il lancé. Ce qui est dingue, n’est-ce pas plutôt une politique au service des marchés financiers, mettant à genoux les populations et les territoires en laminant les services publics et faisant courir des risques énormes en termes de cohésion nationale et de sécurité des personnes ? En fait nous avançons doucement mais sûrement vers une politique de plus en plus antisociale aux accents de plus en plus totalitaires. Puisque M. le Premier ministre se lance dans les références historiques, rappelons-lui que 43 ans en arrière cela nous ramène à 1975, c’est-à-dire juste au moment où sous l’impulsion de Giscard d’Estaing, l’État n’a plus pu se financer auprès de la Banque de France mais a dû emprunter sur les marchés financiers et commencer à payer des intérêts.
Parmi les ministères perdants, celui de la Cohésion des territoires (-7 %). Il se déleste de 1,16 milliard d’euros en 2019 et percevra donc un peu plus de 16 milliards d’euros au lieu des 17,22 de 2018. Le logement (avec les APL) sera à nouveau fortement mis à contribution pour faire les économies attendues l’an prochain censées lui rapporter 1,3 milliard d’économies, celles dites de la « contemporanéité ». En effet, à partir de l’an prochain, le calcul des APL sera basé sur les revenus de l’année en cours, et non plus sur ceux d’il y a 2 ans, ce qui va réduire les sommes engagées. Autre ministère concerné, celui des Relations avec les collectivités territoriales : 3,43 en 2019 contre 3,66 en 2018 soit 230 millions d’euros en moins.
La baisse la plus remarquable est celle du ministère du Travail et de l’emploi qui perd plus de 2 milliards d’euros entre 2018 et 2019 soit -13,5 % pour toucher l’année prochaine un peu plus de 13 milliards d’euros. Une baisse qui s’explique, entre autres, par la suppression des contrats aidés qui pourraient être ramenés de 200 000 à 100 000 ; ce qui va commencer par poser de sérieux problèmes pour beaucoup de territoires et notamment pour les petites collectivités et associations qui rendent néanmoins d’importants services aux populations qui auraient d’ailleurs dû être dotées pour cela d’emplois stables, formés et bien rémunérés.
Au titre des budgets malmenés figure aussi celui de l’Agriculture qui devrait lui aussi être réduit de 9 %. La FNSEA, principal syndicat de la profession, dénonce cette réduction : « L’agriculture française a tellement de défis à relever que ce n’est vraiment pas le moment de lui retirer du budget » ont déclaré les responsables de cette organisation.
Parmi les ministères qui connaîtront une augmentation de leur enveloppe, on retrouve celui de la Défense qui percevra 35,9 milliards d’euros en 2019 contre 34,2 en 2018, soit 1,7 milliard de plus (+5 %). Idem pour celui de l’Éducation qui touchera en 2019, 52,23 milliards d’euros soit 750 millions de plus qu’en 2018. De son côté le ministère de la Recherche et de l’enseignement supérieur recevra 500 millions d’euros de plus qu’en 2018, pour atteindre 27,9 milliards. À noter également, celui de la Solidarité, de l’insertion et de l’égalité des chances qui touchera 20,7 milliards d’euros contre 19,4 en 2018 soit 1,3 milliard de plus (+7%). Ou encore celui de la Justice qui bénéficiera d’une hausse de 310 000 euros en 2019 pour atteindre 7,3 milliards d’euros (+ 4%). Il faut remarquer que si ces ministères connaissent une certaine embellie, le montant des augmentations qui leur sont proposées, sont loin de répondre aux besoins criants, particulièrement de l’Éducation nationale et de la recherche. La limitation de leurs besoins est notamment la conséquence de réformes structurelles impactant le contenu des enseignements et l’organisation de leur transmission.
Enfin les ministères des Sports et de la Santé bien qu’ils doivent percevoir une petite obole supplémentaire recevront moins qu’initialement prévu dans la loi de programmation des finances, faisant les frais d’un réajustement de certains crédits.
Au global, en 2019, l’État veut parvenir à limiter la hausse des dépenses publiques à 0,4 % hors inflation des dépenses dites pilotables contre 0,7 % prévus en 2018. Et Laurent Saint-Martin, vice-président LREM de la commission des Finances de préciser que : « L’an dernier, l’accent n’avait été mis que partiellement sur la dépense publique pour éviter de procéder par rabot, mais le budget de 2019 est en effet essentiel pour enclencher l’effort que nous avons promis. »
Seule véritable variable d’ajustement lorsqu’on parle de la dépense publique et des crédits de fonctionnement des administrations publiques, l’emploi public s’apprête à subir des tailles profondes même si le gouvernement reste assez évasif sur la question. De sérieuses indications ont néanmoins filtré laissant augurer les pires scénarios.
Les choix gouvernementaux en matière de suppressions de postes dans la Fonction publique sont la clé de voute de la LPFP 2018-2022. Pour 2018, il avait été décidé de ne pas prendre à bras-le-corps cette question ce qui n’avait pas empêché E. Macron d’annoncer son ambition de supprimer 50 000 emplois dans la Fonction publique d’État. Au global toutes fonctions et agences publiques confondues, l’objectif est de 120 000 suppressions d’emplois d’agents publics.
Au titre des dossiers sensibles, les suppressions de postes dans l’administration fiscale et une possible réforme de la présence de l’État en région.
« Mon objectif, c’est l’efficacité de la dépense publique. C’est qu’un euro pris dans la poche des Français soit bien utilisé », plaide le Premier ministre. Si certaines politiques publiques qui « fonctionnent bien » seront « préservées et développées », d’autres seront « corrigées », affirme-t-il. « Qu’il faille diminuer l’emploi public dans certains domaines, ça me semble évident », poursuit-il, même s’il ne se « pose pas la question tous les matins de savoir si ça doit être 120 000 emplois en moins dans les trois Fonctions publiques » […] Notre objectif c’est de faire en sorte que les agents publics restent au niveau le plus proche possible des gens. […] Ça exige des efforts de réorganisation de l’ensemble de l’organisation territoriale de lÉtat », conclut-il. On peut difficilement être plus clair !
Selon diverses sources d’information, l’administration fiscale pourrait se préparer à perdre 20 000 postes sur l’ensemble du quinquennat. Une régression inouïe de l’administration fiscale est en cours faisant dire à V. Drezet, syndicaliste dans ce secteur : « Ce qui va se passer est inédit. Certaines missions vont être abandonnées. On est à l’aube d’un big-bang, d’une attaque frontale contre l’action publique. »
Un plan choc est en effet en préparation. Il pourrait consister en la fermeture de près d’un centre des impôts sur trois pouvant aller jusqu’à supprimer 30 000 postes à la Direction générale des finances publiques d’ici 2022. Ce n’est ni plus ni moins que le procureur général auprès de la Cour des comptes qui souhaite un tel traitement de choc. Cela reviendrait à passer de 2 000 suppressions de postes par an actuellement à 7 500. Si, dans son rapport final, la Cour des comptes ne reprend pas ces chiffres, le constat est rude. Les Sages évoquent « une gestion des ressources humaines lourde et sans anticipation » et la « nécessité d’une stratégie de transformation ». Cela veut tout dire !
Le développement de l’informatique sert à justifier les suppressions d’emplois. Sont évoqués les déclarations informatiques sur internet, les échanges par mails avec le fisc. Tout cela fait chuter la fréquentation aux guichets estimée à -20 % depuis 2012 selon la Cour. Il faudrait que ces sages viennent visiter les centres des impôts les jours de réception des contribuables pour constater l’ineptie de tels propos. Et au moins qu’ils aient l’honnêteté de mettre leur estimation en regard des suppressions d’emplois déjà subies par cette administration (30 000 sur 170 000, soit -18 %).
Quelque peu gêné aux entournures le gouvernement par la voix de Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, refuse de confirmer l’ampleur de la baisse des effectifs. Il prend cependant soin de préciser que la fin de la taxe d’habitation, le prélèvement à la source et la dématérialisation des feuilles d’impôts conduisent le pouvoir exécutif à alléger les effectifs. Sauf que pour atteindre de tels objectifs de suppression d’emplois, il oublie de dire que les coupes ne concerneraient pas que les services gestionnaires de la TH et de l’IR, mais qu’elles iraient bien au-delà s’attaquant au cœur même de l’administration fiscale qu’est le contrôle fiscal et notamment le contrôle des entreprises. Pas étonnant lorsqu’on connaît l’appétence gouvernementale pour la reconnaissance du droit à l’erreur et le développement de relations de confiance avec le milieu des affaires. Et c’est tout naturellement que le gouvernement estime que la numérisation doit permettre aux finances publiques de travailler avec moins de personnel. Un plan d’ailleurs en parfaite adéquation avec l’objectif affiché par E. Macron de suppression d’emplois dans la Fonction publique d’État. Peut-être pas un hasard total si un consensus a été aussi vite trouvé avec le groupe LREM pour faire sauter le verrou de Bercy. À la clé sans doute y a-t-il une nouvelle pépite de suppressions d’emplois au sein de la CIF3 et un nouveau moyen de contourner le suivi de certains fraudeurs en renvoyant la balle à une sphère judiciaire déjà surchargée.
Installation d’un nouveau système informatique dans un ministère, supervision de la création d’une piscine municipale, d’un lycée, d’un collège, d’une école, d’un gymnase, aménagement urbain, réorganisation de services, d’administrations… De telles tâches de la Fonction publique réalisées par des fonctionnaires pourraient bientôt être effectuées avec des contrats de mission. Largement usités dans l’industrie du BTP, ils permettraient l’embauche de personnels, avec ou sans le statut de fonctionnaire, le temps d’un projet. Ces contrats pourraient durer jusqu’à 6 ans. Ils seraient ouverts aux contractuels comme aux fonctionnaires. Ils pourraient également s’appliquer dans tous les secteurs de la Fonction publique, allant de l’État aux hôpitaux. Une conception aux antipodes du rôle du fonctionnaire responsable, citoyen et sécurisé dans son emploi, qui rompt avec l’objectif d’un travail sur le long terme réalisé dans un collectif.
Le gouvernement a décidé de geler le point d’indice des fonctionnaires ce qui revient à geler leurs salaires. Une décision de gel qui s’inscrit dans une logique des politiques salariales dans la Fonction publique remontant à 2010 même si une légère augmentation de 0,6 % a eu lieu en 2016 et 2017. Certes l’effet GVT a permis de limiter la baisse du pouvoir d’achat des fonctionnaires qui demeurent malgré tout inférieure à l’augmentation perçue dans le privé.
L’État ferait cependant un geste de 840 millions d’euros l’an prochain. Cela consisterait en une revalorisation des carrières promise par F. Hollande et bénéficiant à tous les fonctionnaires même si certains toucheront plus que d’autres (travailleurs sociaux, gardiens de la paix, professeurs certifiés). En fait une aumône !
Autre cible, les services déconcentrés de l’État. « Il y a 37 000 points de contacts de l’État dans les régions. Cela aboutit à empiler les dispositifs avec les réseaux des collectivités locales, et les Français ne s’y retrouvent plus », souligne Amélie de Montchalin, coordinatrice de la délégation LREM en commission des Finances. Le thème de l’empilage des dispositifs est maintenant bien connu et on sait à quoi il conduit… Toujours est-il que ce sujet a été étudié dans le cadre des travaux du comité CAP 2022 dont le rapport officiellement destiné à ne jamais voir la lumière du jour est disponible sur tous les réseaux gouvernementaux et va servir à alimenter toute la réflexion gouvernementale. C’est d’ailleurs notamment sur la capacité de chaque ministre à mettre en musique ces réformes de l’action publique que le Premier ministre, Edouard Philippe, évaluera chacun d’eux. Au titre des réjouissances pourrait d’ailleurs figurer la disparition du ministère des Sports.
Au-delà des coupes dans les emplois publics dans les ministères, le gouvernement se propose aussi d’insister sur la numérisation de l’administration. Dans un récent rapport, l’Inspection générale des finances a chiffré que des économies de l’ordre de 600 millions sont possibles sur les 3 milliards dépensés chaque année en informatisation. Il s’agirait pour cela de mieux mutualiser les moyens. On sait ce qui se trame derrière ce type de discours. Au-delà des dépenses d’équipements, il y a aussi la question des emplois et du matériel mis à disposition des personnels, ordinateurs mais aussi qualité et convivialité des applications.
Enfin une autre piste d’économie serait dans les tuyaux. Il s’agit de relancer la chasse aux niches fiscales, et aux aides jugées inefficaces. Est tout particulièrement ciblé le taux réduit de TVA dans le bâtiment et la restauration ainsi que pour les aides à la transition énergétique. Quant aux ministères, ils pourraient ne plus être chargés que de la conception des politiques publiques. L’application de ces dernières serait confiée à des agences. Un vieux rêve de la LOLF4 et de la Commission européenne verrait ainsi le jour. C’est dans une telle épure que le ministère des Sports pourrait en arriver à disparaître.
Le gouvernement pourtant si prévoyant, n’avait visiblement pas prévu certaines dépenses. Par exemple que la suppression de la taxe d’habitation pour tous les ménages allait constituer à terme un manque à gagner de 8 milliards d›euros pour l’État. Et puis il devra également prendre en charge une partie de la dette de la SNCF (2 milliards d’euros par an), sauf si tout cela n’était en fait qu’un effet d’annonce pour faire passer la pilule de sa réforme rétrograde. Et le gouvernement qui continue à tabler sur une reprise de l’économie alors que tous les indicateurs se retournent, croissance, aggravation du déficit commercial, crise commerciale états-Unis/Europe, devra sans doute revoir à la baisse ses prévisions. Un autre manque à gagner en perspective !
Dans le rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques (DOFP 2019), la commission des Finances du Sénat pointe outre une augmentation plus forte que prévu de la baisse des crédits alloués aux « relations avec les collectivités locales », 230 millions d’euros au lieu de 150, une plus faible hausse du fonds de compensation TVA (FCTVA) qu’initialement anticipée dénotant au final un redémarrage modéré de l’investissement local. Enfin il est à craindre de nouvelles baisses sur les dotations forfaitaires aux collectivités locales.
Quant au coût de la suppression de la taxe d’habitation estimé au total à 10,5 milliards d’euros, montant ramené à 8 milliards si cette taxe est maintenue pour les résidences secondaires, celui-ci pourrait être finalement compensé par de l’emprunt qui se traduirait par une augmentation du déficit de 0,2 point de PIB en moyenne entre 2020 et 2022.
Est en préparation au plan gouvernemental le transfert vers le budget de l’État des futurs excédents de la Sécurité sociale. Cette question a été mise en débat à l’assemblée nationale avant le départ en congé lors du débat d’orientation des finances publiques pour 2019.
C’est M. Olivier Véran, rapporteur général de la commission des Affaires sociales à l’Assemblée qui a abordé le sujet en ces termes : « Lorsque les finances sociales s’améliorent de façon générale, on peut légitimement s’interroger sur une participation de cet excédent des finances sociales à la vie générale du budget de l’État. »
Et c’est ainsi que la Loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2019 ébauche le scénario d’une protection sociale « très excédentaire ». Le surplus servirait à « la réduction du déficit de l’État, sous forme de transfert, dès 2019 ». Un excédent qui, selon la Cour des comptes, pourrait atteindre « approximativement » 24 milliards d’euros en 2022. Cette dernière épingle cependant les actuels procédés de transferts entre les budgets de la Sécu et de l’État qu’elle juge « pas toujours d’une grande clarté ».
Voilà sans doute pourquoi entre autres, au plan institutionnel, les articles 6 et 7 de la réforme constitutionnelle prévoient de réduire les délais des assemblées pour adopter le budget de l’État et celui de la Sécu. Il s’agit de dégager du temps pour examiner des textes non budgétaires et d’amener les députés à débattre dans un cadre commun des articles portant sur les recettes des deux projets de loi de financement.
Ces évolutions confirment l’engagement d’une réforme beaucoup plus vaste du financement de la protection sociale, dont les retraites. L’objectif est de poursuivre jusqu’à son terme ultime le désengagement des entreprises du financement de la protection sociale, non seulement retraite mais aussi santé, en ne faisant relever de la Sécurité sociale qu’un socle commun minimum et en transférant tout le reste à des assurances privées. Là encore un vieux rêve du Medef est en passe de devenir réalité !
Le projet de budget 2019 est une nouvelle charge contre l’ensemble des services publics. Il confirme l’inscription totale de la politique de Macron et de son gouvernement dans la plus pure veine ultralibérale au service du Medef et des marchés financiers. Le projet de budget 2019, partie intégrante de la LPFP 2018-2022, est le premier qui caractérise vraiment le fond idéologique des choix « macronistes ». Le budget 2018 n’a constitué de ce point de vue qu’une simple entrée en matière.
Pour se déployer, ce projet de budget prend appui sur les projets gouvernementaux initiés depuis 2017 (réforme du Code du travail, réforme de la SNCF…). E. Macron et son équipe veulent entériner totalement le changement de paradigme auquel aspirent le Medef et les milieux financiers. Il s’agit de réduire sans cesse la dépense publique pour laisser à la disposition des marchés le plus d’argent public frais possible afin de venir alimenter le rendement des dividendes servis aux actionnaires et les opérations spéculatives de toute espèce. Dans le même temps il s’agit de transférer au privé toutes les missions publiques jugées comme pouvant être lucratives pour ce dernier. Peu importe si cela crée du chômage en mettant sur le carreau des milliers d’emplois publics, peu importe si de nombreux métiers sont totalement déqualifiés, peu importe si des missions sont saccagées voire purement abandonnées, peu importe si tout un pan de la population ne pourra plus avoir accès à de multiples services dont certains peuvent s’avérer vitaux au sens propre comme au sens figuré.
Cette politique est une véritable politique d’enfoncement dans la crise. Jugeons-en plutôt. Le Premier ministre vient d’annoncer que l’objectif de réduction du déficit à 2,3 % en 2018 devrait être relevé à 2,6 %. Il devrait atteindre 3 % en 2019, conséquence de la transformation du CICE en suppression de cotisations sociales des entreprises ainsi que d’une croissance estimée à 1,7 % au lieu de 1,9 %. On mesure ici la pleine réussite des politiques gouvernementales de cadeaux fiscaux et sociaux aux entreprises en faveur du capital. Ainsi, les milliards qui leurs sont distribués à l’aveugle représentent au total quelque 220 milliards d’euros. L’inexistence de critères d’incitation assortis de dispositifs de contrôles et de suivis visant des objectifs sociaux de créations d’emplois et de formation pour les entreprises comme pour les banques, minent la croissance en asséchant la création de richesses. Le déficit de la balance commerciale qui a atteint 33,5 milliards au cours du premier semestre, un record, tient comme le souligne Patrick Artus dans le journal Les Échos du 08/08/2018 au fait que la France est le seul pays développé à continuer à se désindustrialiser. Cela atteste de l’inefficacité d’une politique de l’offre entièrement tournée vers la reconstitution des profits des entreprises et du choix délibéré du grand patronat français d’utiliser l’argent reçu à tout autre chose qu’à se soucier de faire croître la valeur ajoutée produite sur le territoire national.
Les choix répétés de réduction de la dépense publique et sociale participent dans les faits à tarir les investissements tant matériels qu’humains, tant publics que privés, et au lieu de réduire le déficit, l’accroissent. Sans redémarrage d’une croissance saine, donc sans création de richesses nouvelles permettant d’alimenter les budgets publics et sociaux, l’État, qui se doit d’assurer un minimum vital aux citoyens comme aux territoires, n’a d’autres solutions que de se tourner vers l’emprunt sur les marchés pour boucher les trous et ainsi d’accroître son déficit. Le premier poste budgétaire du budget est celui du remboursement des intérêts de la dette 42 milliards d’euros servis aux marchés financiers alors que les banques reçoivent de l’argent à 0 %, voire à un taux inférieur et l’utilisent pour tout autre chose que des investissements utiles (services publics, industrie…).
Qu’à cela ne tienne ! C’est sans sourciller que M. Philippe annonce pour 2019 une nouvelle cure d’austérité. Ainsi 4 500 emplois de fonctionnaires devraient être supprimés, les aides sociales devraient baisser de 3 milliards et des mesures structurelles concernant l’assurance chômage, les collectivités territoriales et les retraites devraient être engagées. À nouveau autant de choix qui ne feront qu’alimenter le cercle vicieux des déficits et précipiter un nombre toujours plus grand de nos concitoyens dans la précarité et la pauvreté. Une véritable descente aux enfers se prépare.
L’heure est à passer à la contre-offensive avec des propositions précises et radicales constituant un socle sur lequel les salariés et les populations pourront prendre appui pour engager les luttes nécessaires face à cette entreprise gouvernementale de casse généralisée et pour construire un nouveau pacte social. Et c’est ainsi et non en commençant par le contraire que se créeront les conditions d’un rassemblement fiable, pérenne et efficace du peuple de gauche et de ses représentants alliant luttes de terrain et bulletin de vote.
Au cœur de cette stratégie de rassemblement est la question centrale de l’argent et de son utilisation, de la lutte entre coût du travail et coût du capital. Voilà pourquoi il nous faut faire monter plus que jamais le débat et les actions pour un autre euro et une autre utilisation de la BCE et du crédit bancaire afin de financer le développement des services publics et donc de soutenir la dépense publique. Celle-ci doit absolument être relancée pour répondre aux défis économiques, sociaux et écologiques de notre temps. Voilà pourquoi il est également urgent de travailler à une grande réforme de la fiscalité mettant à contribution à leur juste niveau les entreprises, le capital et la fortune avec une modulation de leur contribution en fonction de critères sociaux et écologiques (formation, emplois et respect de normes environnementales). Il n’y a pas de temps à perdre. C’est sur l’ensemble de ces questions que notre prochain congrès aura à se prononcer clairement.
1. Écart de production : Différence de niveau entre la production effective et la production potentielle.
2. LPFP : Loi de programmation des finances publiques.
3. CIF : commission des infractions fiscales.
4. LOLF) Loi organique relative aux lois de finances.
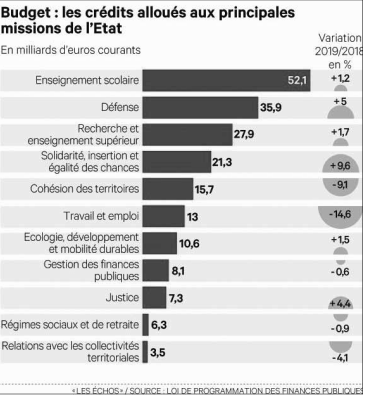
|
SOLDE DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT en milliards d’euros (1) |
|||||
|
Comptabilité budgétaire |
Exécution 2015 |
Exécution 2016 |
LFI 2017 |
Révisé 2017 |
PLF 2018 |
|
Dépenses nettes* |
366,7 |
376,2 |
381,6 |
384,8 |
386,3 |
|
Ù à dont dépenses du budget général |
296,5 |
310,7 |
318,5 |
322,4 |
325,8 |
|
Ù à dont prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales |
50,5 |
46,5 |
44,4 |
44,5 |
40,3 |
|
Ù à dont prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne |
19,7 |
19,0 |
18,7 |
17,9 |
20,2 |
|
Recettes nettes |
294,5 |
300,3 |
306,9 |
303,1 |
302,0 |
|
Ù à dont impôt sur le revenu |
69,3 |
71,8 |
73,4 |
72,6 |
72,7 |
|
Ù à dont impôt sur les sociétés |
33,5 |
30,0 |
29,1 |
28,4 |
25,3 |
|
Ù à dont taxe sur la valeur ajoutée** |
141,8 |
144,4 |
149,3 |
150,5 |
152,8 |
|
Ù à dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13,8 |
15,9 |
10,6 |
10,4 |
13,3 |
|
Ù à dont autres recettes fiscales |
21,7 |
22,0 |
30,0 |
28,2 |
24,6 |
|
Ù à dont recettes non fiscales |
14,4 |
16,2 |
14,5 |
13,0 |
13,2 |
|
Solde du budget général |
-72,1 |
-75,9 |
-74,7 |
-81,7 |
-84,3 |
|
Solde des comptes spéciaux |
1,6 |
6,8 |
5,4 |
5,2 |
1,4 |
|
SOLDE GÉNÉRAL |
-70,5 |
-69,1 |
-69,3 |
-76,5 |
- 82,9 |
* Par conversion les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’union européenne sont inclus sur la ligne dépenses.
** Pour la première fois en 2018, les régions bénéficieront d’une affectation d’une fraction de la TVA.
(1) Source : comptes publics, ministère de l’économie et des Finances. zzz
Budget réduit tel est l’objectif du projet de loi finances pour 2019 que le gouvernement s’apprête à proposer. Pour cela il va falloir tailler dans les dépenses de certains ministères. Une cure d’amaigrissement des dépenses publiques est au menu. Les lettres de cadrage budgétaire pour l’année 2019 envoyées aux divers ministères le confirment. La première présentation du projet global qu’en a fait le Premier ministre en cette rentrée donne une forme plus concrète à ces choix.
Attendus et contexte de la préparation du budget 2019
Bilan
Fort des résultats obtenus en 2017, le gouvernement veut accélérer sa marche vers l’équilibre budgétaire au sens maastrichtien du terme. En effet en 2017 le solde des administrations publiques centrales a atteint -65,3 Md€ contre -76,8 Md€ en 2016, traduisant dans les faits le passage du solde de l’État de -73,8 Md€ à -64,3 Md€ ainsi que de celui des organismes divers d’administration centrale.
Quant au solde des administrations de sécurité sociale il est redevenu positif (+5,0 Md€ contre -2,2 Md€ en 2016). Cela est la traduction de l’application stricte de l’objectif national de dépenses d’assurance-maladie (Ondam) fixé pour 2017. Même le solde du régime général et du fonds de solidarité vieillesse a réalisé des prouesses en n’enregistrant qu’un déficit de -5,1 Md€, niveau jamais atteint depuis les années 2000.
S’agissant du solde des administrations publiques locales, celui-ci demeure excédentaire en 2017, comme en 2016, bien que cet excédent se soit réduit (+0,8Mds€ en 2017 contre +3,0 Mds€ en 2017). Cela tient à la reprise des investissements dans les collectivités territoriales, besoins urgents et approche des élections produisant leurs effets.
Perspectives
Pour le gouvernement, la croissance devrait rester solide, à +2,0 % en 2018 et +1,9 % en 2019 se bornant aux prévisions du Programme de stabilité. Il analyse en effet le fléchissement de la croissance de ce début d’année à un contrecoup d’une fin d’année 2017 très dynamique. Toujours selon les prévisionnistes gouvernementaux, entre 2020 et 2022, l’économie française continuerait de croître à un rythme de +1,7 %, c’est-à-dire à un rythme plus soutenu que l’estimation potentielle de +1,3 % en moyenne sur la période. Un tel résultat contribuerait au redressement de l’écart de production1.
Dans le même temps, le contexte économique serait marqué par le redémarrage de l’inflation, tirée notamment par l’augmentation des prix de l’énergie. L’inflation totale atteindrait +1,4 % en 2018, après +1,0 % en 2017, du fait de la hausse du prix du pétrole et de l’augmentation de la fiscalité indirecte particulièrement de celle qui y est attachée. Elle pourrait diminuer quelque peu en 2019 dans l’hypothèse d’une stabilisation des cours du pétrole et en raison d’une moindre hausse de la fiscalité indirecte.
Les grandes lignes de l’objectif budgétaire 2018-2019 se résument ainsi :
‒ un ajustement articulant maîtrise de la dépense et baisse de prélèvements obligatoires (une reprise en somme des objectifs de la mission CAP 2022, voir article par ailleurs) ;
‒ l’ajustement structurel atteindrait 0,1 puis 0,3 % de PIB. Une telle trajectoire repose sur un ralentissement de la croissance de la dépense publique en volume, ramenée à +0,7 % en 2018 puis +0,4 % en 2019 ;
‒ à partir de 2020 la politique gouvernementale devrait s’inscrire dans la continuité de la logique des années précédentes pour en arriver à freiner en volume la croissance de la dépense publique. C’est ainsi que les comptes publics seraient rétablis et que seraient regagnées des marges de manœuvre jugées utiles en cas de crise. Le solde public se redresserait ainsi de 2,6 points entre 2017 et 2022, pour revenir à l’équilibre en 2022, porté par une baisse du ratio de dépenses publiques de plus de 3 points de PIB qui permettrait en même temps de faire baisser le ratio de prélèvements obligatoires de plus d’un point.
Pour cela le gouvernement compte énormément sur les résultats que produira le programme de transformation engagée sous les auspices de la commission CAP 2022 qui poursuit trois objectifs principaux selon les auteurs : améliorer la qualité du service aux usagers, offrir un environnement de travail modernisé aux agents publics et accompagner une baisse de la dépense publique de plus de 3 points. Ces objectifs sont portés au plus haut niveau par le président de la république lui-même et son Premier ministre. Un premier comité interministériel s’est réuni sur cette question le 1er février de cette année.
L’année 2019 sera également celle de l’entrée en application d’une réforme globale touchant l’apprentissage, la formation professionnelle et le chômage. Il s’agit pour M. Macron et son gouvernement de placer politiquement les négociations UNEDIC entre partenaires sociaux dans un cadre financier prédéfini, de rendre l’apprentissage plus accessible et moins contraignant pour les entreprises, de proposer par la formation des passerelles pour s’adapter aux besoins des entreprises.
Suivi
Le suivi de l’exécution budgétaire 2018 s’inscrit totalement dans les préconisations de la LPFP (2018/2022)2 définissant un système de normes à deux niveaux : une norme sur les dépenses pilotables de l’État et un objectif de dépenses totales de l’État (ODETE). Ces normes remplacent les « norme en valeur » et « norme en volume ». Elles fixent une trajectoire des dépenses de l’État sur la durée du quinquennat avec l’objectif principal d’en assurer la maîtrise.
Le périmètre de la norme de dépenses pilotables se recentre sur les dépenses sur lesquelles il est possible d’agir. Elle intègre donc en plus des crédits ouverts sur le budget général, des comptes spéciaux et budgets annexes dont les dépenses sont assimilables à de la dépense budgétaire. Par contre elle n’intègre plus certaines dépenses contraintes comme les prélèvements sur recettes à destination de l’Union européenne ou des collectivités locales, précédemment décomptés au sein de l’ancienne norme en valeur.
Au total, le périmètre de l’ODETE comptabilise non seulement les prélèvements sur recettes ci-dessus mentionnés mais également la charge de la dette, les pensions, les concours financiers en faveur des collectivités locales, les dépenses d’investissement d’avenir et les dépenses de certains comptes d’affectation spéciale. Le périmètre des administrations publiques centrales est ainsi de facto intégré.
Jusqu’en 2022, les niveaux de la norme de dépenses pilotables et de l’ODETE sont fixés par l’article 9 de la LPFP qui implique qu’à compter de 2020 le taux d’évolution en volume de la norme de dépenses pilotables soit de -1 %. Naturellement la tenue de cet objectif nécessitera la mise en œuvre de réformes qui seront issues du processus en cours de transformation de l’action publique.
Traduction et analyse de ces choix de politique budgétaire pour 2019
Si Bruno Le Maire a tout d’abord maintenu la prévision de croissance de 2 % de l’économie française pour 2018 et 2019, il a été contraint de reconnaître que l’économie avait enregistré un « fléchissement conjoncturel » en début d’année. Il a ensuite indiqué que les enquêtes sur le climat des affaires restaient à un niveau élevé et que Bercy attendrait la présentation du projet de loi de finances 2019, fin septembre, pour amender éventuellement son scénario.
Il est pourtant évident que cette prévision ne pourra pas être maintenue. Les deux premiers trimestres de l’année ont enregistré respectivement une croissance de +0,2 %. Dans la meilleure des hypothèses la Banque de France fixe une prévision globale pour 2018 de 1,7 %, ce qui est sans doute encore très optimiste, le chiffre de 1,4 % serait indéniablement plus réaliste.
Et ce ne sont pas les propos de Gérald Darmanin promettant que le gouvernement poursuivrait « la dynamique vertueuse, moins de dépenses, moins de déficit et moins de dette en [se] donnant les moyens d’y parvenir » et indiquant que le rythme de progression des dépenses publiques devrait être l’an prochain entre 0,4 % et 0,5 % hors inflation, soit moitié moins qu’en 2018 et trois fois moins qu’en 2017, qui sont de nature à nous rassurer quant à l’évolution de la dépense publique et aux besoins urgents des populations auxquelles celle-ci doit répondre. Des coups de rabots massifs sont prévisibles ainsi que les catastrophes qui risquent de les accompagner.
L’ambition gouvernementale traduite par Bercy est de viser l’équilibre du budget en 2022, ce que le Premier ministre Édouard Philippe affiche déjà comme un prochain succès : « Cela fait 43 ans que la France vote des budgets en déficit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c’est dingue », a-t-il lancé. Ce qui est dingue, n’est-ce pas plutôt une politique au service des marchés financiers, mettant à genoux les populations et les territoires en laminant les services publics et faisant courir des risques énormes en termes de cohésion nationale et de sécurité des personnes ? En fait nous avançons doucement mais sûrement vers une politique de plus en plus antisociale aux accents de plus en plus totalitaires. Puisque M. le Premier ministre se lance dans les références historiques, rappelons-lui que 43 ans en arrière cela nous ramène à 1975, c’est-à-dire juste au moment où sous l’impulsion de Giscard d’Estaing, l’État n’a plus pu se financer auprès de la Banque de France mais a dû emprunter sur les marchés financiers et commencer à payer des intérêts.
Les ministères mis au régime sec, seuls trois tirent leur épingle du jeu…
Parmi les ministères perdants, celui de la Cohésion des territoires (-7 %). Il se déleste de 1,16 milliard d’euros en 2019 et percevra donc un peu plus de 16 milliards d’euros au lieu des 17,22 de 2018. Le logement (avec les APL) sera à nouveau fortement mis à contribution pour faire les économies attendues l’an prochain censées lui rapporter 1,3 milliard d’économies, celles dites de la « contemporanéité ». En effet, à partir de l’an prochain, le calcul des APL sera basé sur les revenus de l’année en cours, et non plus sur ceux d’il y a 2 ans, ce qui va réduire les sommes engagées. Autre ministère concerné, celui des Relations avec les collectivités territoriales : 3,43 en 2019 contre 3,66 en 2018 soit 230 millions d’euros en moins.
La baisse la plus remarquable est celle du ministère du Travail et de l’emploi qui perd plus de 2 milliards d’euros entre 2018 et 2019 soit -13,5 % pour toucher l’année prochaine un peu plus de 13 milliards d’euros. Une baisse qui s’explique, entre autres, par la suppression des contrats aidés qui pourraient être ramenés de 200 000 à 100 000 ; ce qui va commencer par poser de sérieux problèmes pour beaucoup de territoires et notamment pour les petites collectivités et associations qui rendent néanmoins d’importants services aux populations qui auraient d’ailleurs dû être dotées pour cela d’emplois stables, formés et bien rémunérés.
Au titre des budgets malmenés figure aussi celui de l’Agriculture qui devrait lui aussi être réduit de 9 %. La FNSEA, principal syndicat de la profession, dénonce cette réduction : « L’agriculture française a tellement de défis à relever que ce n’est vraiment pas le moment de lui retirer du budget » ont déclaré les responsables de cette organisation.
… La Défense, l’Éducation, et les solidarités mieux lotis
Parmi les ministères qui connaîtront une augmentation de leur enveloppe, on retrouve celui de la Défense qui percevra 35,9 milliards d’euros en 2019 contre 34,2 en 2018, soit 1,7 milliard de plus (+5 %). Idem pour celui de l’Éducation qui touchera en 2019, 52,23 milliards d’euros soit 750 millions de plus qu’en 2018. De son côté le ministère de la Recherche et de l’enseignement supérieur recevra 500 millions d’euros de plus qu’en 2018, pour atteindre 27,9 milliards. À noter également, celui de la Solidarité, de l’insertion et de l’égalité des chances qui touchera 20,7 milliards d’euros contre 19,4 en 2018 soit 1,3 milliard de plus (+7%). Ou encore celui de la Justice qui bénéficiera d’une hausse de 310 000 euros en 2019 pour atteindre 7,3 milliards d’euros (+ 4%). Il faut remarquer que si ces ministères connaissent une certaine embellie, le montant des augmentations qui leur sont proposées, sont loin de répondre aux besoins criants, particulièrement de l’Éducation nationale et de la recherche. La limitation de leurs besoins est notamment la conséquence de réformes structurelles impactant le contenu des enseignements et l’organisation de leur transmission.
Enfin les ministères des Sports et de la Santé bien qu’ils doivent percevoir une petite obole supplémentaire recevront moins qu’initialement prévu dans la loi de programmation des finances, faisant les frais d’un réajustement de certains crédits.
Au global, en 2019, l’État veut parvenir à limiter la hausse des dépenses publiques à 0,4 % hors inflation des dépenses dites pilotables contre 0,7 % prévus en 2018. Et Laurent Saint-Martin, vice-président LREM de la commission des Finances de préciser que : « L’an dernier, l’accent n’avait été mis que partiellement sur la dépense publique pour éviter de procéder par rabot, mais le budget de 2019 est en effet essentiel pour enclencher l’effort que nous avons promis. »
Le cœur du dispositif de réduction de la dépense publique : la suppression des emplois publics
Seule véritable variable d’ajustement lorsqu’on parle de la dépense publique et des crédits de fonctionnement des administrations publiques, l’emploi public s’apprête à subir des tailles profondes même si le gouvernement reste assez évasif sur la question. De sérieuses indications ont néanmoins filtré laissant augurer les pires scénarios.
Les choix gouvernementaux en matière de suppressions de postes dans la Fonction publique sont la clé de voute de la LPFP 2018-2022. Pour 2018, il avait été décidé de ne pas prendre à bras-le-corps cette question ce qui n’avait pas empêché E. Macron d’annoncer son ambition de supprimer 50 000 emplois dans la Fonction publique d’État. Au global toutes fonctions et agences publiques confondues, l’objectif est de 120 000 suppressions d’emplois d’agents publics.
Au titre des dossiers sensibles, les suppressions de postes dans l’administration fiscale et une possible réforme de la présence de l’État en région.
« Mon objectif, c’est l’efficacité de la dépense publique. C’est qu’un euro pris dans la poche des Français soit bien utilisé », plaide le Premier ministre. Si certaines politiques publiques qui « fonctionnent bien » seront « préservées et développées », d’autres seront « corrigées », affirme-t-il. « Qu’il faille diminuer l’emploi public dans certains domaines, ça me semble évident », poursuit-il, même s’il ne se « pose pas la question tous les matins de savoir si ça doit être 120 000 emplois en moins dans les trois Fonctions publiques » […] Notre objectif c’est de faire en sorte que les agents publics restent au niveau le plus proche possible des gens. […] Ça exige des efforts de réorganisation de l’ensemble de l’organisation territoriale de lÉtat », conclut-il. On peut difficilement être plus clair !
Bercy subirait un véritable sevrage…
Selon diverses sources d’information, l’administration fiscale pourrait se préparer à perdre 20 000 postes sur l’ensemble du quinquennat. Une régression inouïe de l’administration fiscale est en cours faisant dire à V. Drezet, syndicaliste dans ce secteur : « Ce qui va se passer est inédit. Certaines missions vont être abandonnées. On est à l’aube d’un big-bang, d’une attaque frontale contre l’action publique. »
Un plan choc est en effet en préparation. Il pourrait consister en la fermeture de près d’un centre des impôts sur trois pouvant aller jusqu’à supprimer 30 000 postes à la Direction générale des finances publiques d’ici 2022. Ce n’est ni plus ni moins que le procureur général auprès de la Cour des comptes qui souhaite un tel traitement de choc. Cela reviendrait à passer de 2 000 suppressions de postes par an actuellement à 7 500. Si, dans son rapport final, la Cour des comptes ne reprend pas ces chiffres, le constat est rude. Les Sages évoquent « une gestion des ressources humaines lourde et sans anticipation » et la « nécessité d’une stratégie de transformation ». Cela veut tout dire !
Le développement de l’informatique sert à justifier les suppressions d’emplois. Sont évoqués les déclarations informatiques sur internet, les échanges par mails avec le fisc. Tout cela fait chuter la fréquentation aux guichets estimée à -20 % depuis 2012 selon la Cour. Il faudrait que ces sages viennent visiter les centres des impôts les jours de réception des contribuables pour constater l’ineptie de tels propos. Et au moins qu’ils aient l’honnêteté de mettre leur estimation en regard des suppressions d’emplois déjà subies par cette administration (30 000 sur 170 000, soit -18 %).
Quelque peu gêné aux entournures le gouvernement par la voix de Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, refuse de confirmer l’ampleur de la baisse des effectifs. Il prend cependant soin de préciser que la fin de la taxe d’habitation, le prélèvement à la source et la dématérialisation des feuilles d’impôts conduisent le pouvoir exécutif à alléger les effectifs. Sauf que pour atteindre de tels objectifs de suppression d’emplois, il oublie de dire que les coupes ne concerneraient pas que les services gestionnaires de la TH et de l’IR, mais qu’elles iraient bien au-delà s’attaquant au cœur même de l’administration fiscale qu’est le contrôle fiscal et notamment le contrôle des entreprises. Pas étonnant lorsqu’on connaît l’appétence gouvernementale pour la reconnaissance du droit à l’erreur et le développement de relations de confiance avec le milieu des affaires. Et c’est tout naturellement que le gouvernement estime que la numérisation doit permettre aux finances publiques de travailler avec moins de personnel. Un plan d’ailleurs en parfaite adéquation avec l’objectif affiché par E. Macron de suppression d’emplois dans la Fonction publique d’État. Peut-être pas un hasard total si un consensus a été aussi vite trouvé avec le groupe LREM pour faire sauter le verrou de Bercy. À la clé sans doute y a-t-il une nouvelle pépite de suppressions d’emplois au sein de la CIF3 et un nouveau moyen de contourner le suivi de certains fraudeurs en renvoyant la balle à une sphère judiciaire déjà surchargée.
L’ensemble de l’emploi public dénaturé
Installation d’un nouveau système informatique dans un ministère, supervision de la création d’une piscine municipale, d’un lycée, d’un collège, d’une école, d’un gymnase, aménagement urbain, réorganisation de services, d’administrations… De telles tâches de la Fonction publique réalisées par des fonctionnaires pourraient bientôt être effectuées avec des contrats de mission. Largement usités dans l’industrie du BTP, ils permettraient l’embauche de personnels, avec ou sans le statut de fonctionnaire, le temps d’un projet. Ces contrats pourraient durer jusqu’à 6 ans. Ils seraient ouverts aux contractuels comme aux fonctionnaires. Ils pourraient également s’appliquer dans tous les secteurs de la Fonction publique, allant de l’État aux hôpitaux. Une conception aux antipodes du rôle du fonctionnaire responsable, citoyen et sécurisé dans son emploi, qui rompt avec l’objectif d’un travail sur le long terme réalisé dans un collectif.
Gel du point d’indice
Le gouvernement a décidé de geler le point d’indice des fonctionnaires ce qui revient à geler leurs salaires. Une décision de gel qui s’inscrit dans une logique des politiques salariales dans la Fonction publique remontant à 2010 même si une légère augmentation de 0,6 % a eu lieu en 2016 et 2017. Certes l’effet GVT a permis de limiter la baisse du pouvoir d’achat des fonctionnaires qui demeurent malgré tout inférieure à l’augmentation perçue dans le privé.
L’État ferait cependant un geste de 840 millions d’euros l’an prochain. Cela consisterait en une revalorisation des carrières promise par F. Hollande et bénéficiant à tous les fonctionnaires même si certains toucheront plus que d’autres (travailleurs sociaux, gardiens de la paix, professeurs certifiés). En fait une aumône !
Les services déconcentrés de l’État pas en reste
Autre cible, les services déconcentrés de l’État. « Il y a 37 000 points de contacts de l’État dans les régions. Cela aboutit à empiler les dispositifs avec les réseaux des collectivités locales, et les Français ne s’y retrouvent plus », souligne Amélie de Montchalin, coordinatrice de la délégation LREM en commission des Finances. Le thème de l’empilage des dispositifs est maintenant bien connu et on sait à quoi il conduit… Toujours est-il que ce sujet a été étudié dans le cadre des travaux du comité CAP 2022 dont le rapport officiellement destiné à ne jamais voir la lumière du jour est disponible sur tous les réseaux gouvernementaux et va servir à alimenter toute la réflexion gouvernementale. C’est d’ailleurs notamment sur la capacité de chaque ministre à mettre en musique ces réformes de l’action publique que le Premier ministre, Edouard Philippe, évaluera chacun d’eux. Au titre des réjouissances pourrait d’ailleurs figurer la disparition du ministère des Sports.
D’autres économies en vue !
Au-delà des coupes dans les emplois publics dans les ministères, le gouvernement se propose aussi d’insister sur la numérisation de l’administration. Dans un récent rapport, l’Inspection générale des finances a chiffré que des économies de l’ordre de 600 millions sont possibles sur les 3 milliards dépensés chaque année en informatisation. Il s’agirait pour cela de mieux mutualiser les moyens. On sait ce qui se trame derrière ce type de discours. Au-delà des dépenses d’équipements, il y a aussi la question des emplois et du matériel mis à disposition des personnels, ordinateurs mais aussi qualité et convivialité des applications.
Enfin une autre piste d’économie serait dans les tuyaux. Il s’agit de relancer la chasse aux niches fiscales, et aux aides jugées inefficaces. Est tout particulièrement ciblé le taux réduit de TVA dans le bâtiment et la restauration ainsi que pour les aides à la transition énergétique. Quant aux ministères, ils pourraient ne plus être chargés que de la conception des politiques publiques. L’application de ces dernières serait confiée à des agences. Un vieux rêve de la LOLF4 et de la Commission européenne verrait ainsi le jour. C’est dans une telle épure que le ministère des Sports pourrait en arriver à disparaître.
Des dépenses supplémentaires non prévues
Le gouvernement pourtant si prévoyant, n’avait visiblement pas prévu certaines dépenses. Par exemple que la suppression de la taxe d’habitation pour tous les ménages allait constituer à terme un manque à gagner de 8 milliards d›euros pour l’État. Et puis il devra également prendre en charge une partie de la dette de la SNCF (2 milliards d’euros par an), sauf si tout cela n’était en fait qu’un effet d’annonce pour faire passer la pilule de sa réforme rétrograde. Et le gouvernement qui continue à tabler sur une reprise de l’économie alors que tous les indicateurs se retournent, croissance, aggravation du déficit commercial, crise commerciale états-Unis/Europe, devra sans doute revoir à la baisse ses prévisions. Un autre manque à gagner en perspective !
Quelques autres mauvaises surprises
Dans le rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques (DOFP 2019), la commission des Finances du Sénat pointe outre une augmentation plus forte que prévu de la baisse des crédits alloués aux « relations avec les collectivités locales », 230 millions d’euros au lieu de 150, une plus faible hausse du fonds de compensation TVA (FCTVA) qu’initialement anticipée dénotant au final un redémarrage modéré de l’investissement local. Enfin il est à craindre de nouvelles baisses sur les dotations forfaitaires aux collectivités locales.
Quant au coût de la suppression de la taxe d’habitation estimé au total à 10,5 milliards d’euros, montant ramené à 8 milliards si cette taxe est maintenue pour les résidences secondaires, celui-ci pourrait être finalement compensé par de l’emprunt qui se traduirait par une augmentation du déficit de 0,2 point de PIB en moyenne entre 2020 et 2022.
La Sécurité sociale mise à contribution et en grave danger
Est en préparation au plan gouvernemental le transfert vers le budget de l’État des futurs excédents de la Sécurité sociale. Cette question a été mise en débat à l’assemblée nationale avant le départ en congé lors du débat d’orientation des finances publiques pour 2019.
C’est M. Olivier Véran, rapporteur général de la commission des Affaires sociales à l’Assemblée qui a abordé le sujet en ces termes : « Lorsque les finances sociales s’améliorent de façon générale, on peut légitimement s’interroger sur une participation de cet excédent des finances sociales à la vie générale du budget de l’État. »
Et c’est ainsi que la Loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2019 ébauche le scénario d’une protection sociale « très excédentaire ». Le surplus servirait à « la réduction du déficit de l’État, sous forme de transfert, dès 2019 ». Un excédent qui, selon la Cour des comptes, pourrait atteindre « approximativement » 24 milliards d’euros en 2022. Cette dernière épingle cependant les actuels procédés de transferts entre les budgets de la Sécu et de l’État qu’elle juge « pas toujours d’une grande clarté ».
Voilà sans doute pourquoi entre autres, au plan institutionnel, les articles 6 et 7 de la réforme constitutionnelle prévoient de réduire les délais des assemblées pour adopter le budget de l’État et celui de la Sécu. Il s’agit de dégager du temps pour examiner des textes non budgétaires et d’amener les députés à débattre dans un cadre commun des articles portant sur les recettes des deux projets de loi de financement.
Ces évolutions confirment l’engagement d’une réforme beaucoup plus vaste du financement de la protection sociale, dont les retraites. L’objectif est de poursuivre jusqu’à son terme ultime le désengagement des entreprises du financement de la protection sociale, non seulement retraite mais aussi santé, en ne faisant relever de la Sécurité sociale qu’un socle commun minimum et en transférant tout le reste à des assurances privées. Là encore un vieux rêve du Medef est en passe de devenir réalité !
Stop à la casse des services publics. Il est urgent de changer de logiciel
Le projet de budget 2019 est une nouvelle charge contre l’ensemble des services publics. Il confirme l’inscription totale de la politique de Macron et de son gouvernement dans la plus pure veine ultralibérale au service du Medef et des marchés financiers. Le projet de budget 2019, partie intégrante de la LPFP 2018-2022, est le premier qui caractérise vraiment le fond idéologique des choix « macronistes ». Le budget 2018 n’a constitué de ce point de vue qu’une simple entrée en matière.
Pour se déployer, ce projet de budget prend appui sur les projets gouvernementaux initiés depuis 2017 (réforme du Code du travail, réforme de la SNCF…). E. Macron et son équipe veulent entériner totalement le changement de paradigme auquel aspirent le Medef et les milieux financiers. Il s’agit de réduire sans cesse la dépense publique pour laisser à la disposition des marchés le plus d’argent public frais possible afin de venir alimenter le rendement des dividendes servis aux actionnaires et les opérations spéculatives de toute espèce. Dans le même temps il s’agit de transférer au privé toutes les missions publiques jugées comme pouvant être lucratives pour ce dernier. Peu importe si cela crée du chômage en mettant sur le carreau des milliers d’emplois publics, peu importe si de nombreux métiers sont totalement déqualifiés, peu importe si des missions sont saccagées voire purement abandonnées, peu importe si tout un pan de la population ne pourra plus avoir accès à de multiples services dont certains peuvent s’avérer vitaux au sens propre comme au sens figuré.
Cette politique est une véritable politique d’enfoncement dans la crise. Jugeons-en plutôt. Le Premier ministre vient d’annoncer que l’objectif de réduction du déficit à 2,3 % en 2018 devrait être relevé à 2,6 %. Il devrait atteindre 3 % en 2019, conséquence de la transformation du CICE en suppression de cotisations sociales des entreprises ainsi que d’une croissance estimée à 1,7 % au lieu de 1,9 %. On mesure ici la pleine réussite des politiques gouvernementales de cadeaux fiscaux et sociaux aux entreprises en faveur du capital. Ainsi, les milliards qui leurs sont distribués à l’aveugle représentent au total quelque 220 milliards d’euros. L’inexistence de critères d’incitation assortis de dispositifs de contrôles et de suivis visant des objectifs sociaux de créations d’emplois et de formation pour les entreprises comme pour les banques, minent la croissance en asséchant la création de richesses. Le déficit de la balance commerciale qui a atteint 33,5 milliards au cours du premier semestre, un record, tient comme le souligne Patrick Artus dans le journal Les Échos du 08/08/2018 au fait que la France est le seul pays développé à continuer à se désindustrialiser. Cela atteste de l’inefficacité d’une politique de l’offre entièrement tournée vers la reconstitution des profits des entreprises et du choix délibéré du grand patronat français d’utiliser l’argent reçu à tout autre chose qu’à se soucier de faire croître la valeur ajoutée produite sur le territoire national.
Les choix répétés de réduction de la dépense publique et sociale participent dans les faits à tarir les investissements tant matériels qu’humains, tant publics que privés, et au lieu de réduire le déficit, l’accroissent. Sans redémarrage d’une croissance saine, donc sans création de richesses nouvelles permettant d’alimenter les budgets publics et sociaux, l’État, qui se doit d’assurer un minimum vital aux citoyens comme aux territoires, n’a d’autres solutions que de se tourner vers l’emprunt sur les marchés pour boucher les trous et ainsi d’accroître son déficit. Le premier poste budgétaire du budget est celui du remboursement des intérêts de la dette 42 milliards d’euros servis aux marchés financiers alors que les banques reçoivent de l’argent à 0 %, voire à un taux inférieur et l’utilisent pour tout autre chose que des investissements utiles (services publics, industrie…).
Qu’à cela ne tienne ! C’est sans sourciller que M. Philippe annonce pour 2019 une nouvelle cure d’austérité. Ainsi 4 500 emplois de fonctionnaires devraient être supprimés, les aides sociales devraient baisser de 3 milliards et des mesures structurelles concernant l’assurance chômage, les collectivités territoriales et les retraites devraient être engagées. À nouveau autant de choix qui ne feront qu’alimenter le cercle vicieux des déficits et précipiter un nombre toujours plus grand de nos concitoyens dans la précarité et la pauvreté. Une véritable descente aux enfers se prépare.
L’heure est à passer à la contre-offensive avec des propositions précises et radicales constituant un socle sur lequel les salariés et les populations pourront prendre appui pour engager les luttes nécessaires face à cette entreprise gouvernementale de casse généralisée et pour construire un nouveau pacte social. Et c’est ainsi et non en commençant par le contraire que se créeront les conditions d’un rassemblement fiable, pérenne et efficace du peuple de gauche et de ses représentants alliant luttes de terrain et bulletin de vote.
Au cœur de cette stratégie de rassemblement est la question centrale de l’argent et de son utilisation, de la lutte entre coût du travail et coût du capital. Voilà pourquoi il nous faut faire monter plus que jamais le débat et les actions pour un autre euro et une autre utilisation de la BCE et du crédit bancaire afin de financer le développement des services publics et donc de soutenir la dépense publique. Celle-ci doit absolument être relancée pour répondre aux défis économiques, sociaux et écologiques de notre temps. Voilà pourquoi il est également urgent de travailler à une grande réforme de la fiscalité mettant à contribution à leur juste niveau les entreprises, le capital et la fortune avec une modulation de leur contribution en fonction de critères sociaux et écologiques (formation, emplois et respect de normes environnementales). Il n’y a pas de temps à perdre. C’est sur l’ensemble de ces questions que notre prochain congrès aura à se prononcer clairement.
1. Écart de production : Différence de niveau entre la production effective et la production potentielle.
2. LPFP : Loi de programmation des finances publiques.
3. CIF : commission des infractions fiscales.
4. LOLF) Loi organique relative aux lois de finances.
|
SOLDE DU BUDGET GENERAL DE L’ETAT en milliards d’euros (1) |
|||||
|
Comptabilité budgétaire |
Exécution 2015 |
Exécution 2016 |
LFI 2017 |
Révisé 2017 |
PLF 2018 |
|
Dépenses nettes* |
366,7 |
376,2 |
381,6 |
384,8 |
386,3 |
|
Ù à dont dépenses du budget général |
296,5 |
310,7 |
318,5 |
322,4 |
325,8 |
|
Ù à dont prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales |
50,5 |
46,5 |
44,4 |
44,5 |
40,3 |
|
Ù à dont prélèvements sur recettes au profit de l’Union européenne |
19,7 |
19,0 |
18,7 |
17,9 |
20,2 |
|
Recettes nettes |
294,5 |
300,3 |
306,9 |
303,1 |
302,0 |
|
Ù à dont impôt sur le revenu |
69,3 |
71,8 |
73,4 |
72,6 |
72,7 |
|
Ù à dont impôt sur les sociétés |
33,5 |
30,0 |
29,1 |
28,4 |
25,3 |
|
Ù à dont taxe sur la valeur ajoutée** |
141,8 |
144,4 |
149,3 |
150,5 |
152,8 |
|
Ù à dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
13,8 |
15,9 |
10,6 |
10,4 |
13,3 |
|
Ù à dont autres recettes fiscales |
21,7 |
22,0 |
30,0 |
28,2 |
24,6 |
|
Ù à dont recettes non fiscales |
14,4 |
16,2 |
14,5 |
13,0 |
13,2 |
|
Solde du budget général |
-72,1 |
-75,9 |
-74,7 |
-81,7 |
-84,3 |
|
Solde des comptes spéciaux |
1,6 |
6,8 |
5,4 |
5,2 |
1,4 |
|
SOLDE GÉNÉRAL |
-70,5 |
-69,1 |
-69,3 |
-76,5 |
- 82,9 |
* Par conversion les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’union européenne sont inclus sur la ligne dépenses.
** Pour la première fois en 2018, les régions bénéficieront d’une affectation d’une fraction de la TVA.
(1) Source : comptes publics, ministère de l’économie et des Finances.
le 30 June 2018

Sommaire du dossier :
- Pour une autre globalisation ! Une perspective marxiste et au-delà par Frédéric Boccara
- Lutter contre la mondialisation libérale est aussi lutter pour une autre Europe et pour la reconquête industrielle par Nasser Mansouri-Guilani
- Importations alimentaires : arme de destruction massive d’une agriculture européenne durable par Julien Brugerolles
- Le point de la situation du Brésil à mi-année 2018 par Valter Pomar
- Mondialisation : mais que font les banques centrales ? par Denis Durand
1. Sur l’état de la mondialisation capitaliste et de ses contradictions, et sur la place qu’y tient la crise de la construction européenne, on se reportera avec fruit à l’article d’Yves Dimicoli dans notre précédent numéro, « Services publics : un atout maître pour changer l’Europe et le monde », Économie et politique, n° 766-767, mai-juin 2018.
Par Boccara Frédéric, le 30 June 2018

Marx a écrit Le Capital, et non Le Travail…
En disant cela, je veux insister sur le fait qu’il a montré le rôle central du capital dans la logique du capitalisme et dans les crises. Cette logique a apporté un énorme progrès, par rapport au féodalisme comme non seulement Marx mais aussi Lénine aimait à le rappeler, mais le capital est aussi, selon les propres mots de Marx, une « barrière » à l’accumulation elle-même, et à un véritable développement social durant les crises de suraccumulation. Marx a souligné tout particulièrement le rôle du taux de profit (dans le livre III du Capital), le taux de profit étant le régulateur central du système, comme nous le désignons aujourd’hui (« nous », étant celles et ceux qui se rattachent à l’école de pensée marxiste française ouverte par Paul Boccara). Un régulateur n’est pas une personne. Un régulateur tend à imposer sa logique, son niveau, etc., à travers des institutions, des pouvoirs et une culture.
La question de la « régulation » du système, de changer cette régulation elle-même, a été bien trop négligée après Marx. La régulation capitaliste opère au cours de la vie économique « normale » aussi bien que par le biais de crises catastrophiques, crises dans lesquelles nous devons distinguer celles qui correspondent à des cycles de moyen terme et celles qui correspondent à des cycles de longue période.
La régulation comprend trois aspects : les régulateurs (la rentabilité, les taux d’intérêt…), les règles (règles de marché, de circulation des capitaux…) et les réglages (politique économique, gestion des entreprises...).
Par contraste, il a été donné trop d’importance à la question de la propriété du capital. La propriété du capital est importante, seulement dans la mesure où elle aide à imposer une autre logique que celle de la rentabilité, à changer cette logique.
Dans le même ordre d’idées, la question de la monopolisation devrait aussi être comprise comme celle d’un monopole sur l’utilisation des moyens financiers, assurant le monopole sur les décisions économiques, comme la production et l’emploi, ou encore sur les décisions technologiques, avec un niveau national et un niveau international voire mondial.
Ainsi, au cœur du message principal de Marx, il y a l’idée que le capital et la monnaie, c’est politique. Il faut bien comprendre cela. Cela implique les institutions existantes, mais aussi de possibles institutions nouvelles, à créer pour conquérir des pouvoirs communs sur les moyens financiers, et les orienter, en visant à faire dominer une autre logique et non pas à compenser la logique dominante ni à l’accompagner.
Bien sûr, dans Marx il y a aussi la dialectique, le matérialisme historique, l’aliénation et l’exploitation (couples jumeaux qui s’entretiennent), l’analyse de la marchandise et de la valeur, la force de travail comme marchandise spécifique au capitalisme, la découverte de la plus-value, etc.
Deux siècles après Le Capital de Marx, le taux de profit continue à dominer et à orienter la régulation des économies capitalistes ainsi que des firmes multinationales (FMN) dans le monde entier. Mais cette domination rencontre des conditions profondément nouvelles. Je veux insister ici sur la technologie : le contexte d’une transformation radicale dans la technologie, que nous analysons comme une révolution informationnelle, par opposition à la révolution industrielle.
Notons qu’il y a dans le même temps d’autres révolutions « objectives », dans les forces sociales productives : révolution écologique ‒ l’être humain a par son activité le pouvoir de mettre en cause l’ensemble de sa niche écologique en tant que telle ‒, révolution démographique ‒ maîtrise de la fécondité, vieillissement, etc. ‒, révolution monétaire ‒ de rupture du lien entre monnaie et or ou argent ‒ révolution parentale, etc.
Mais, face à ces révolutions « objectives », ces révolutions dans les forces productives, il n’y a pas de révolution de la structure sociale (rapports sociaux de production et de consommation) ni dans la régulation. Ceci est au cœur de la crise systémique et de sa persistance.
La révolution informationnelle peut se définir et se caractériser par contraste avec la révolution industrielle. Autant la révolution informationnelle remplace la main du travailleur.euse maniant l’outil par une machine-outil, autant avec la révolution informationnelle se développe le remplacement de certaines activités du cerveau humain (les activités informationnelles) par des machines comme les ordinateurs. Dit autrement, le transfert des informations, leur reproduction, leurs transformations, peuvent être incorporés dans les équipements matériels et en quelque sorte « séparés », ou dissociés, des êtres humains de façon nouvelle.
Une information, c’est par exemple la formule d’un médicament. Elle peut aujourd’hui prendre la forme d’un programme informatique de spécifications de la fabrication du médicament par une machine.
La nouveauté est très profonde, bien que refoulée par la domination du capital, qui récupère, utilise les débuts de cette révolution technologique et tente de lui imprimer sa logique. D’une part, l’information recèle un potentiel fondamental de partage au contraire d’un produit matériel qui se prête à une appropriation exclusive, appropriation qui structure la logique capitaliste et marchande. D’autre part, puisque l’information, sa création et son développement, son interprétation deviennent fondamentaux, les dépenses humaines deviennent décisives pour l’efficacité elle-même, contrairement à la logique capitaliste de priorité aux dépenses pour le capital. La nécessité de faire prédominer les dépenses humaines commence à se faire jour.
La logique de coûts est elle aussi différente de celle du capital et des machines. Contrairement à une machine, une information ne s’use pas quand on s’en sert. Les coûts de création des informations (R&D…) peuvent être très élevés, alors qu’une fois celles-ci mises au point, les coûts d’utilisation des informations tendent à être négligeables. Une fois les informations mises au point, les dépenses réalisées pour les créer (R&D…) tendent alors à fonctionner comme des coûts fixes à répartir. C’est une incitation très puissante au développement de nouveaux types de FMN, mondialisées et le plus étendues possibles, des FMN de partage des coûts au sein de leur réseau privatif, mais au service du capital et de ses profits.
Il ne s’agit pas d’une dématérialisation, mais d’une autre relation êtres humains/moyens matériels/information, du moins potentiellement, car il y a refoulement du nouveau, et distorsion profonde, voire perversion, avec la domination maintenue de la recherche de rentabilité maximale. C’est aussi une révolution qui touche à la culture et à la vie hors travail, pouvant tendre à bouleverser la séparation entre travail et hors travail, ainsi que le travail lui-même.
Le capitalisme saisit cette révolution technologique dans sa propre logique, la « vieille » logique capitaliste. Mais les contradictions tendent à être encore plus radicales et systémiques dans la mesure où le partage, intrinsèque à l’information, est contraire à l’essence même de la logique du capitalisme ‒ appropriation et monopoles ‒, logique qui s’est historiquement développée avec la révolution industrielle fondée sur la prédominance des moyens matériels de production.
La dite crise financière de 2008-2009 a été l’éclatement d’une sur-accumulation de capital, en ligne avec l’analyse de Marx, montrant que le taux de profit est au cœur de la régulation du capitalisme, régulation qui agit par crises de surproduction et par le chômage.
Marx montre aussi que la recherche du taux de profit le plus élevé correspond à un type de croissance de la productivité du travail total, par croissance prioritaire des dépenses pour le capital (matériel et financier).
Mais il existe une contradiction croissante entre le taux de profit (Profit/Capital) et l’efficacité du capital (Valeur ajoutée/Capital), ainsi qu’une contradiction entre la masse de profit et ce que nous appelons la « valeur ajoutée disponible » pour la population et le territoire (VAd). Ces contradictions tendent à mettre en question les conditions sociales et même la durabilité écologique de notre système économique. C’est une base potentielle fondamentale, et considérable, pour d’ambitieuses alliances d’un nouveau type (entre motifs sociaux et motifs écologiques).
La crise prend place au sein d’une longue tendance dépressive ouverte au début des années 1970. En effet, poussant l’analyse des crises par Marx, notre analyse marxiste (développée par P. Boccara) distingue les cycles de moyen terme (Juglar) et ceux de long terme (Kondratiev), dont les tournants à la baisse correspondent à des crises de suraccumulation.
Les phases de suraccumulation de longue période ont jusqu’ici été résolues et surmontées par des transformations du système. La dévalorisation systémique du capital est au cœur de celles-ci (dévalorisation signifiant mise en valeur à un taux plus faible que le taux de profit moyen, voire à taux zéro) avec de nouvelles institutions créées et imposées par les luttes sociales (par exemple après la seconde guerre mondiale : les « Public Utilities » aux états-Unis ; en Europe les entreprises publiques et la Sécurité sociale ; sans oublier la création monétaire et le rôle des banques centrales, jusqu’à la création du FMI avec Bretton-Woods) en relation dialectique avec de nouvelles conditions objectives : technologiques et démographiques.
Ainsi, après la seconde guerre mondiale, on a eu :
– D’une part, limitation de la logique du taux de profit dans les entreprises publiques (y compris des banques) et des éléments d’une autre logique dans un certain nombre de secteurs de la vie économique (santé, éduction…).
– D’autre part, la domination du taux de profit a été maintenue, en tant que régulateur central des entreprises privées et ‒ progressivement ‒ de l’activité des banques.
Et même, la domination du taux de profit a été renforcée sur toute l’économie durant la phase de globalisation financière.
Car le système réagit de l’intérieur. Il a réagi par l’accélération des transformations technologiques ‒ qui nous amène actuellement aux débuts d’une révolution informationnelle. Il a réagi par une phase de financiarisation sans précédent, par des attaques contre les dépenses publiques et sociales, ainsi que par une pression nouvelle contre les salaires. On notera cependant que dans les pays capitalistes développés on n’a pas assisté à une baisse des salaires, mais à des mouvements plus contradictoires contrairement à des analyses unilatérales parlant de « dévalorisation du travail » (voir encadré).
Après la crise de 2008-2009, la réponse dominante a été une intervention publique considérable… mais en faveur du profit et du capital. Particulièrement par les banques centrales (i) apportant aide et liquidités au secteur bancaire sans conditions (ii) mais imposant aux gouvernements des conditions anti-sociales.
Les mouvements et partis communistes dans les pays capitalistes n’ont pas réussi à mettre au centre du débat les conditions de l’intervention publique – ses critères. Dans ces conditions, les raisons de l’échec flagrant des réponses capitalistes ne sont pas claires. Les enjeux politiques non plus. C’est la responsabilité commune des partis communistes. Nous devons affronter cela pour une remontée du mouvement et des idées communistes, particulièrement dans les pays capitalistes développés, ce qui est une nécessité absolue.
à présent, en 2018, dix ans après la profonde crise de 2008-2009, après la crise de la dette publique en Europe, se manifestent les signes d’un nouvel éclatement d’une suraccumulation, relativement proche. Cette fois-ci de tels signes sont aussi observables venant des pays émergents, y compris la Chine, et le FMI a produit des graphiques très intéressants en ce sens.
Le moment doit être aussi considéré comme la recherche d’une nouvelle phase dans la globalisation par les pays impérialistes. En particulier :
1. Par les états-Unis, d’importants efforts pour attirer les capitaux, utilisant le privilège du dollar ainsi que des baisses d’impôt sur les entreprises.
2. Dans les autres pays capitalistes développés : continuation des attaques systématiques contre les dépenses sociales, les services publics, les retraites, les salaires et le statut des salariés.
3. Dans l’ensemble du monde, remise en question des traités internationaux sur le commerce et les investissements et le commerce international (comme le TAFTA, le TPP) en cherchant une configuration dépassant celle issue de la mise en place de l’OMC, et en parallèle restrictions US sur les échanges internationaux.
4. Fusions financières pour des monopoles informationnels par les firmes multinationales (FMN) afin d’obtenir des gains d’efficacité et des transferts en faveur du capital (ils conjuguent gains d’efficacité informationnels et appropriation de rente sur la nature).
5. Plus généralement, un moment d’intenses efforts des capitaux dominants, particulièrement étatsuniens et des FMN étatsuniennes, pour rétablir leur propre taux de profit et renforcer leur avance technologique afin de faire un nouveau pas en avant.
Un certain nombre de statistiques sur le Brésil, la Chine, la France et les états-Unis montrent un mouvement assez clair en ce sens. C’est-à-dire : des transferts croissants, depuis 2009-2010, de profits vers les États-Unis et en provenance des autres pays, sous forme de paiements technologiques, droits, dividendes et rapatriements de profits à travers les filiales de FMN US situées à l’étranger (cf. graphiques). Cela semble être à la fois le cas de leurs filiales situées dans les pays émergents et de celles situées dans les pays moins développés comme la Tunisie, avec pour ces derniers un double prélèvement : les FMN et la dette publique.
Ces nouveaux efforts du capital financier heurtent de plein fouet les aspirations et besoins des peuples au développement dans le monde entier. Ils incluent aussi des efforts considérables pour intégrer les pays émergents à la logique du capital financier, ou tout du moins pour amener certains des secteurs de la société à « collaborer » avec le capital financier. Ces efforts d’intégration sont aussi en cours au sein de nos pays capitalistes développés, en direction d’un certain nombre de couches sociales (cadres, indépendants, petits patrons…). Ainsi en France notre président est un ancien banquier de chez Rothschild…
Le capital financier (voir encadré) est au cœur de cette logique, interconnecté avec le dollar US et son circuit. Le capital financier constitue une sorte d’articulation avec ce qu’il est convenu d’appeler « capital productif ». C’est la forme la plus achevée (pour l’heure) du capital. Une sorte de capital « pur », l’essence du capital. Il combine une double logique : 1. celle de « l’argent pour l’argent » et 2. celle d’un pouvoir sur la production et la gestion (investissement, embauche, répartition) pouvant en outre agir à distance dans différentes localisations et différents pays.
Il apparaît aujourd’hui comme notre ennemi, ou notre adversaire, commun dans le monde entier. C’est notre adversaire commun contre l’emploi, particulièrement dans les pays du Nord, contre la sécurité sociale dans tous les pays, contre les services publics, contre la sécurité de vie, contre la santé et l’écologie, et contre les biens communs – même si la production sous-jacente, dont il tire au fond ses profits, a besoin de toutes ces dépenses.
Face à la logique du capital, notre tâche ne peut pas être simplement de la limiter ou d’en compenser les conséquences. Il faut une autre logique. Et ceci d’autant plus avec les défis des changements considérables, effectifs et potentiels, apportés par la révolution informationnelle, la révolution écologique et la révolution monétaire (d’émancipation de la monnaie par rapport à l’or).
Cela nécessite un nouveau progrès des idées, de la théorie, mais aussi du programme et des propositions, et même un dialogue international et une recherche de coordination nouvelle entre forces au niveau international.
Si on ne change pas cette logique elle-même, nous allons être affectés par l’éclatement d’une nouvelle suraccumulation, y compris cette fois-ci de l’intérieur des pays émergents (Brésil, Turquie, Argentine, voire Chine…) avec des conséquences encore plus terribles pour les peuples que la fois précédente. Venant après la précédente et ce qui avait été prétendument mis en place pour prévenir une nouvelle crise, elle pourrait faire surgir un désarroi aux conséquences politiques d’une grande gravité.
Que signifie « une autre logique » ? C’est la logique du développement des capacités humaines et d’une nouvelle efficacité économique.
Les services publics, la protection sociale et l’emploi sont au cœur de cette logique en lien étroit avec, du côté des entreprises, des critères de gestion alternatifs à ceux de la rentabilité. Et ceci à la fois pour tirer la demande et pour agir sur l’offre, pour un nouveau type de productivité.
L’abolition de la logique capitaliste n’est pas la suppression mécanique de ce qui existe dans la société capitaliste. Une abolition réussie demande de répondre aux problèmes objectifs auxquels le capitalisme lui-même tente de répondre : non pas régresser par rapport aux marchés mais dépasser les marchés.
Ainsi, nous avançons l’idée d’un dépassement « cohérent » des 4 marchés fondamentaux du capitalisme : marché du travail / marché des produits (avec les entreprises capitalistes et leurs critères de gestion) / marché financier et de la monnaie / marché international, qui est transversal aux trois précédents. Je n’entrerai pas ici dans le détail de cela.
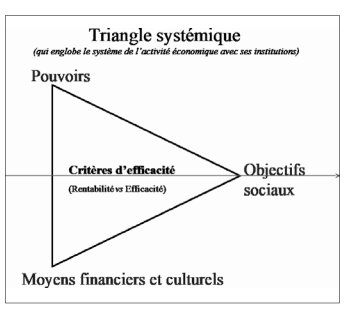
------------
Références
‒ Boccara Frédéric (2013), Firmes multinationales et balance des paiements dans la globalisation financière et la révolution technologique informationnelle - une analyse théorique et appliquée, Thèse de doctorat de l’Université de Paris 13, tomes 1 et 2, 608 p.
‒ Boccara Frédéric (2005), A la recherche de la firme globale - Localisation industrielle et globalisation financière des firmes multinationales, in L’industrie en France et la mondialisation, ministère de l’Industrie de l’économie et des finances
‒ Boccara Paul (2013), Théories sur les crises - La suraccumulation et la dévalorisation du capital, édition Delga, 557 p.
‒ Boccara Paul (2012), Le Capital de Marx, son apport, son dépassement au-delà de l’économie, Le Temps des Cerises, 174 p.
‒ Boccara Paul (2011), “We must incriminate the basic rules of capitalism”, p. 61-68, in All the Same - All Being New. Basic rules of capitalism in a world of change, Peter Herrmann editor, Europäischer Hochschulverlag, Bremen, 198 p.
‒ Boccara Paul (1985), Intervenir dans les gestions des entreprises avec de nouveaux critères, Messidor-Éditions sociales, 566 p.
‒ Dimicoli Yves (2000), « ‘Nouvelle économie’ ou nouvelle phase de la crise systémique ? », La Pensée, n° 23, p.37-51
‒ Durand Denis (2005), Un autre crédit est possible, Le Temps des Cerises, 367 p.
‒ Marx Karl (1867, 1885 et 1894), Le Capital, Editions sociales, Livres 1, 2 et 3
‒ Mills Catherine, Caudron José (2009), Protection sociale - Économie et politique, débats actuels et réformes, Gualino, 272 p. zzz
La pression sur les salaires dans les pays développésPremièrement, dans une première phase (années 1970), les salaires ont tendu à accélérer pour ralentir seulement ensuite (à partir du début des années 1980). Deuxièmement, les transformations technologiques ont exigé des qualifications accrues et des travailleurs mieux formés mais moins nombreux, d’où plus de chômeurs mais une composition du collectif de travail avec moins de salariés mais plus de techniciens ou ingénieurs/cadres, donc ayant en moyenne des salaires plus hauts, et dans le même temps explosion de la précarité qui pèse sur l’ensemble des salaires, schématiquement : 1 ingénieur + 3 techniciens à la place de 1 ingénieur, 1 agent de maîtrise et 15 ouvriers, cela fait des salaires moyens plus haut, même si le salaire de l’ingénieur est plus faible qu’auparavant ; s’y ajoutent peut-être 5 ouvriers précarisés, intérimaires ou sous-traitants, sans parler des emplois délocalisés. Ainsi, la suraccumulation croît en parallèle avec le chômage et la précarité, d’autant plus que la demande devient insuffisante mais on a des évolutions contradictoires pour le travail et l’emploi. Dans le même temps, les dépenses publiques et sociales tendent malgré tout à continuer à croître, exprimant les besoins objectifs de la société et de l’économie, exprimant aussi la pression sociale des luttes et des peuples – facteur « subjectif ». Ces dépenses publiques et sociales se sont ainsi accrues de phase en phase mais en ralentissant de plus en plus, et en tendant à être de plus en plus intoxiquées par la logique du capital. Elles n’ont cependant pas encore décru, jusqu’à la période récente ouverte par la crise 2008-2009 : c’est un défi majeur aux politiques d’austérité. Elles ont commencé à reculer dans un certain nombre de pays d’Europe du Sud, en réponse à la crise de 2008-2009. Le défi, posé au capital, de faire baisser ces dépenses devient très aigu à présent pour les pays capitalistes développés ou intermédiaires. Le capital peut de moins en moins concilier. |
Qu’est-ce que le capital financier ?
Bien entendu, le capital financier ne doit pas être confondu avec les équipements matériels, ou avec l’argent, voire simplement avec le financement. Déjà, dans l’analyse de Marx, le capital ne se réduit pas aux machines ou à l’argent. Il est les deux, et autre chose : il est une valeur cherchant à s’accroître, par du profit (A cherchant à s’accroître en A’= A + ΔA). C’est une logique. Ainsi, le capital financier s’appuie sur la forme « titre financier » pour tendre à imposer cette logique de façon encore plus pure et constitue un système d’articulation entre capital et activité productive, avec ses pouvoirs et ses institutions (banques, holdings, sociétés par action et liens de contrôle financier au sein des groupes, fonds de pension, bourse... ). C’est du capital « au carré » comme disait Paul Boccara, où la logique de l’argent pour l’argent tend à s’imposer. Mais le capital financier ne perd pas un certain lien avec l’activité dite « réelle ». Ce n’est pas « de la finance » totalement autonome de l’activité dite « réelle », productive. C’est à la fois des pouvoirs, des institutions et une logique. Le titre financier est en effet marchandisable (revente, valorisation ), porteur de dividendes ou d’intérêts, mais aussi porteur de pouvoirs de décision et d’influence sur la gestion des entreprises sous-jacentes, ou sur les États, surtout de la part des gros détenteurs. C’est très en phase avec la définition qu’en donnaient Hilferding comme Lénine : « Fusion du capital bancaire et du capital industriel, et création, sur la base de ce “capital financier”, d’une oligarchie financière » (in Lénine, L’impérialisme stade suprême du capitalisme, 1917, p. 159 de l’édition de 2001 du Temps des Cerises). Dès la préface de son ouvrage de 1909, Hilferding explique qu’on assiste à « une liaison de plus en plus étroite entre capital bancaire et industriel. Par cette liaison, le capital, nous le montrerons plus loin, prend la forme de capital financier, qui est sa manifestation la plus haute et la plus abstraite » (p. 55). Plus loin Hilferding explique ainsi le capital financier. « Par rapport aux propriétaires, il conserve toujours sa forme d’argent [...] portant intérêt et peut toujours être retiré sous forme d’argent. La plus grande partie du capital ainsi placé par les banques est transformée en capital industriel, productif [...]. Mais la disposition du capital bancaire, c’est la banque qui la possède [...]. Si l’industrie tombe ainsi sous la dépendance du capital bancaire, cela ne veut pas dire pour autant que les magnats de l’industrie dépendent eux aussi des magnats de la banque. Bien plutôt que, comme le capital lui-même devient, son niveau plus élevé capital financier » (p. 318, Le Capital Financier, 1909, éditions de Minuit, 1970). |
Par Mansouri Nasser , le 30 June 2018

Il est possible, et nécessaire, de construire une alternative à la mondialisation capitaliste, ce qui implique le dépassement de ce système pour bâtir une nouvelle civilisation fondée sur la paix, la solidarité et la fraternité entre les peuples.
La mondialisation en cours est un processus historique issu du développement du système capitaliste dans un contexte de fortes mutations technologiques que, suivant Paul Boccara, nous appelons « révolution informationnelle ».
Cette observation appelle deux remarques.
Premièrement, la mondialisation n’est pas un phénomène nouveau si on entend par là une simple multiplication des échanges, surtout de marchandises et de capitaux, ce qui est la présentation libérale de la mondialisation.
Deuxièmement, la nouveauté réside dans la nature des mutations technologiques en cours.
En effet, il y a débat sur la qualification et le contenu de ces mutations. Des notions comme « troisième » voire « quatrième révolution industrielle » ne rendent pas compte de l’essence même de ces mutations, à savoir l’information qui est un « bien commun » par excellence, et dont l’échange n’est pas synonyme de privation de celui qui le détient au profit de celui qui l’acquiert. Il y a là la possibilité de dépasser les échanges marchands, la marchandisation, et de bâtir une civilisation fondée sur le partage.
La mondialisation libérale tend au contraire à tout marchandiser, y compris l’information. Cette mondialisation se concrétise par deux phénomènes majeurs.
Une mise en concurrence des systèmes socio-productifs
C’est-à-dire à la fois une mise en concurrence des travailleurs, et une mise en concurrence des systèmes de protection sociale et de l’environnement. Dans tous les cas, l’objectif est de profiter des écarts de développement et de niveaux de vie pour tirer vers le bas les normes sociales et environnementales.
Il convient de souligner que nous ne sommes plus devant un schéma « classique » d’une simple division internationale du travail dans les processus productifs, où le Nord fournirait la tête, le cerveau, et le Sud, les bras. Certes, ce schéma persiste (cf. notamment les délocalisations des unités de production vers les pays moins développés), mais parallèlement se développent d’autres phénomènes : la « montée en gamme » des PVD, les « délocalisations en cascade », c’est à dire de certains PVD vers d’autres PVD, le développement de la sous-traitance dans les services – surtout informatiques – à destination de ces pays, la montée de la R&D dans certains PVD, le mouvement de capitaux du Sud vers le Nord (on en reparlera plus loin).
Une généralisation des normes de rentabilité des capitaux financiers
Grâce aux nouvelles technologies et aux mesures de déréglementation mises en place par les États, les capitaux financiers ont la possibilité d’imposer leur exigence de rentabilité à tous les niveaux, c’est-à-dire à toutes les entreprises, quels que soient leur taille, leur forme juridique, voire leur lieu d’implantation. Cette exigence de rentabilité s’applique également et de plus en plus dans les services publics, avec comme corollaire, la privatisation et/ou la dégradation de la qualité des services rendus aux citoyens, et plus de souffrances pour les agents de ces services.
Un exemple éloquent pour bien illustrer le cynisme de cette logique financière : alors que la moitié de la population mondiale vit avec moins de deux euros par jour, pour assurer la rentabilité des « industriels », l’Union européenne accorde aux éleveurs plus de deux euros de subvention par jour et par vache. Au Japon, le montant de cette subvention est plus grand encore.
Cette même exigence de rentabilité explique le fait scandaleux que des milliers d’individus, surtout des enfants, meurent chaque jour de faim, alors que des excédents alimentaires sont détruits précisément pour assurer la rentabilité des géants de l’industrie agro-alimentaire.
Les choix politiques opérés par les États – avec leurs incidences économiques et sociales –, de même qu’un type de gestion des entreprises fondé sur la quête de profit maximal à court terme formatent nos sociétés en fonction des exigences de rentabilité des capitaux les plus puissants, à savoir les capitaux financiers. Cela produit un phénomène de ségrégation à l’échelle planétaire, phénomène qui s’observe dans chaque région, voire chaque pays : d’un côté, une accumulation sans précédent de richesses entre les mains d’une petite minorité (les fameux 1 %), d’un autre côté, l’accumulation de souffrances pour la grande majorité de la population, les fameux 99 % : la pauvreté, les inégalités, la précarité des situations, l’insécurité sociale…
Dans cette configuration, les intérêts des 1 % priment sur le reste. C’est la fameuse « théorie du ruissellement » en vertu de laquelle si on soigne bien les riches, les « premiers de cordée », les autres en profiteraient aussi par la suite. « Théorie » qui n’a aucun fondement scientifique et qui ne s’est vérifiée nulle part.
Dans la mesure où l’on parle d’une nouvelle phase du développement du capitalisme, précisons que l’une des caractéristiques de l’impérialisme est ici modifiée par certains aspects. Il s’agit de l’exportation (nette) de capitaux qui n’est plus le fait des pays capitalistes les plus avancés. Il s’agit là de deux phénomènes :
– Transferts des sommes importantes liées à la dette et aux prix de transfert pratiqués au sein des firmes multinationales. Ces phénomènes concernent notamment les pays pauvres, mais pas uniquement.
– Exportations de capitaux par un nombre (restreint) de pays dit émergents (pays du Golfe, la Chine particulièrement) vers les pays avancés, notamment vers les États-Unis d’Amérique.
Mais le principal transfert du Sud vers le Nord est en fait celui de la plus-value extraite par le capital multinational dans les pays en développement (voir plus loin).
De ces observations, on peut tirer trois conclusions importantes :
La première conclusion est que la mondialisation « ne tombe pas du ciel ». Elle est le produit de l’action délibérée des êtres-humains (mutations technologiques et choix politiques). De ce fait, son contenu n’est pas immuable.
Autrement dit, il est possible de construire une alternative à cette mondialisation capitaliste ou libérale.
Pour la grande majorité de la population mondiale, l’enjeu est d’« humaniser » la mondialisation, pour reprendre une expression du grand économiste d’origine indienne A. Sen, de profiter des possibilités qu’offrent les avancées technologiques pour bâtir une nouvelle civilisation fondée sur le partage, la paix, la sécurité, la solidarité et la fraternité des peuples.
La deuxième conclusion est que la mondialisation en cours a ses acteurs et ses vecteurs.
Ils sont au nombre de trois:
1. les firmes multinationales. Généralement, ce sont de grandes entreprises qui pratiquent dans de nombreux pays, mais le développement de la sous-traitance conduit à ce que les firmes de taille moyenne voire petite soient amenées à suivre les grandes multinationales lorsqu’elles délocalisent leurs activités;
2. les États ;
3. les organisations internationales. Ces institutions émanent des États et sont fortement influencées par le lobbying des FMN. En effet, la déréglementation, la généralisation de la concurrence, la privatisation – ces devises du libéralisme économique - que préconisent ces institutions, réduisent les moyens d’intervention des États au profit des firmes multinationales.
La troisième conclusion est que la mondialisation n’est pas synonyme de la fin de l’État-nation. En particulier, les firmes multinationales qui sont les principaux vecteurs et acteurs de la mondialisation libérale ont, et continuent d’avoir, une base nationale sur laquelle elles s’appuient. Cela voudrait dire qu’il est possible de les affronter. Cela voudrait aussi dire que pour construire une alternative à la mondialisation libérale, il faut intervenir à plusieurs niveaux, « du local au mondial, en passant par le national et le régional ». Et ces niveaux d’intervention sont complémentaires les uns des autres.
Enfin, quatrième conclusion, contrairement à ce que prétendent les décideurs politiques et les dirigeants d’entreprise européens, l’Union européenne et en son sein la France ne sont pas victimes de la mondialisation. Elles en sont des acteurs et des vecteurs, comme en atteste la participation active de l’Union européenne dans la « troïka » vis-à-vis de la Grèce.
En résumé, lutter en France, tout comme dans l’espace européen, contre le chômage, la précarité, les inégalités, combattre les orientations libérales dominantes, de même que gagner de nouveaux droits pour construire une Europe sociale et solidaire des peuples, sont aussi autant de batailles contre la mondialisation libérale.
Soulignons d’emblée que construire une alternative à cette mondialisation nécessite une approche de classe. En effet, la segmentation des processus productifs rendue possible grâce aux nouvelles technologies (grâce aussi à l’aval des États, il faut bien le souligner) conduit à ce que les travailleurs, les salariés de différents pays, le plus souvent de différentes langues et cultures et de différents niveaux de vie se trouvent sur la même chaîne de valeur, travaillant pour un même « patron ».
Dans l’optique des travailleurs, pour construire une alternative à la mondialisation capitaliste, il est donc indispensable de partir de ce constat fondamental. En effet, contrairement à ce que prétendent les libéraux, la mondialisation ne met pas fin aux prévisions de Marx ; au contraire, elle met en exergue la pertinence de l’insistance des marxistes sur la solidarité internationale des travailleurs, car cette solidarité n’est plus simplement une solidarité affective, mais une solidarité de fait, liée aux processus productifs.
Les délocalisations et/ou l’implantation des FMN dans les PVD conduisent à l’émergence d’une classe ouvrière dans ces pays dont on peut dire (sans tomber dans le déterminisme historique) qu’elle n’est pas issue de l’évolution spontanée, « normale » de ces pays. La caractéristique majeure de cette classe ouvrière est qu’elle produit une plus-value considérable, compte tenu du faible niveau de la valeur de sa force de travail, de son salaire. Autrement dit, cette force de travail se caractérise par un taux élevé d’exploitation.
Précisons que nous assistons à présent à un aspect nouveau du développement du capitalisme, qui est une dimension du capitalisme financiarisé : cette « super plus-value » extraite de la surexploitation des travailleurs n’est pas utilisée pour accumuler le capital productif, c’est-à-dire pour développer les capacités de production, mais pour accroître les versements aux actionnaires et/ou propriétaires ; en d’autres termes, elle alimente le capital financier.
La contrepartie de cette surexploitation des travailleurs dans les pays moins développés est le chômage et la précarité dans les pays développés. Là résident les bases réelles, solides d’une solidarité internationale des travailleurs, à condition que nous soyons capables de bien l’expliquer et de mobiliser nos forces sur cette base-là.
Les capitalistes utilisent donc cette main-d’œuvre pour extraire un maximum de plus-value, et en même temps profitent de son existence pour mettre la pression sur les travailleurs des pays avancés pour tirer vers le bas les normes sociales et environnementales dans ces pays aussi.
En quelque sorte, ces implantations élargissent l’étendue de l’armée de réserve, dont parle Marx à propos du chômage.
Face à ce capitalisme avide de profits, les travailleurs ont donc plus que jamais des intérêts communs.
À l’aune de cette communauté d’intérêt des travailleurs, on peut examiner deux sujets d’actualité, pour exemple.
La restructuration des sociétés peu développées selon les exigences des FMN conduit, entre autres, à ce que toute activité économique qui n’est pas orientée vers le marché soit plus ou moins anéantie.
Par ailleurs, les implantations des FMN ont peu d’effets d’entraînement dans les pays dits d’accueil. Certes, il y a un effet spill over (ruissellement), mais il est très faible et irrigue peu le reste de la société.
Il y a là une explication majeure des mouvements migratoires. Mouvements qui sont amplifiés par les guerres et les conflits régionaux, et/ou par les désastres écologiques, souvent provoqués en lien avec les intérêts des FMN et des capitaux dominants, ou bien à cause de la pauvreté et des inégalités qui ne sont pas sans lien non plus avec les politiques libérales et impérialistes.
Dans les pays dit d’accueil, les travailleurs immigrés sont souvent moins bien payés que leurs homologues autochtones. De plus, ils se trouvent de plus en plus en situation dite irrégulière. À ce propos, il convient de rappeler la demande du patronat de la restauration pour recourir au travail des migrants récemment arrivés en France.
On retrouve là une fonction « classique » de l’immigration en tant que politique pour réduire les « coûts du travail » dans les pays développés : en rendant les immigrés socialement et politiquement vulnérables, patronat et gouvernements utilisent l’immigration pour peser sur les revendications des travailleurs dans les pays plus développés et tirer vers le bas les normes sociales.
Voici aussi une preuve incontestable de la communauté d’intérêts des travailleurs autochtones et des travailleurs immigrés, qu’ils soient régularisés ou en situation irrégulière.
Ce n’est pas un hasard si Donald Trump se présente comme le champion du protectionnisme. On voit bien le but de la manœuvre : exercer la pression sur les autres pays et en même temps imposer des sacrifices aux travailleurs américains sous prétexte qu’il veut défendre leurs intérêts.
Derrière son slogan « make America strong again », il s’agit bien de préserver les intérêts des capitalistes américains.
Si le traitement de la question de l’immigration est relativement facile pour les organisations des travailleurs (partis et syndicats de gauche essentiellement), il est plus difficile s’agissant de la « protection de l’emploi » (d’ailleurs, dans le langage courant, il y a confusion entre travail et emploi).
En effet, la compréhension, par les travailleurs, du fait que dans une économie mondialisée, les travailleurs ont des intérêts communs est difficile mais il s’agit là d’un enjeu majeur pour le monde du travail.
Deux exemples :
1. Comment expliquer aux salariés d’une entreprise qui perdent leur emploi à cause d’une délocalisation que ce ne sont pas les salariés du pays dit d’accueil qui sont en train de « voler » leur emploi, mais que les vrais voleurs, ce sont bien les propriétaires, les actionnaires de l’entreprise qui délocalisent pour gagner plus d’argent ?
2. Les profits des FMN et particulièrement celui des sociétés du CAC40.
Une revendication, qui n’est évidemment pas illégitime, des salariés et syndicats, est que les salariés français doivent aussi avoir leur part dans ces profits. Dans certains cas, on évoque aussi l’usage de ces profits pour financer la formation, la recherche, etc.
La revendication est évidemment légitime. Mais il convient aussi de poser la question de l’origine de ces profits. Nos adversaires disent, et ils n’ont pas tort : ces profits sont réalisés principalement dans les autres pays. Et ils justifient le versement des dividendes aux actionnaires par cet argument.
Dès lors, ne devons-nous pas, à partir de ce constat pertinent de nos adversaires, élargir notre revendication en y intégrant les intérêts et les droits des travailleurs des autres pays qui sont surexploités par ces entreprises ? Certes, le sujet est délicat car il ne s’agit pas de simples slogans mais de revendications concrètes, par exemple plus de salaire et de meilleures conditions de travail pour ces salariés.
Attention cependant : il ne faut pas que nous tombions dans le piège de la mise en concurrence et de la mise en opposition des salariés. Comment l’éviter ? Comment articuler les revendications légitimes des salariés français avec celles, aussi légitimes, des salariés des autres pays, voilà une question fondamentale à laquelle il faut oser réfléchir pour y répondre au-delà des slogans.
Sur un fond d’enjeux de classe, la mondialisation met aussi en évidence la nécessité de traiter, de façon systémique, un ensemble de problèmes qui concernent l’ensemble de la population, l’ensemble de la planète.
Il ressort des constats dressés plus haut que, en dépit des apparences et surtout contrairement aux idées reçues, le monde n’est pas divisé en deux blocs antagoniques homogènes : le Nord et le Sud, les pays riches et les pays pauvres, les pays développés et les pays en développement. Ces notions ne rendent pas compte de la complexité des phénomènes en présence.
Il ressort aussi de ces constats que, contrairement à ce que prétendent les libéraux, la généralisation de la concurrence ne profite pas à tout le monde, que la mondialisation libérale a des gagnants et des perdants, au Nord, tout comme au Sud.
Les premiers perdants de cette mondialisation sont certes les travailleurs en général et particulièrement les travailleurs les moins qualifiés. Mais les autres couches de la population se trouvent aussi, à des degrés divers certes, parmi les perdants, surtout si on se place dans une perspective historique et de long terme, par exemple en intégrant dans la réflexion la dimension environnementale.
À partir de là, on peut discerner un ensemble de thématiques, d’enjeux qu’il faut traiter systématiquement pour sortir de la mondialisation libérale.
L’économie politique de la mondialisation fait référence à ces problèmes à travers la notion de « biens publics mondiaux ». L’expression est galvaudée, chacun la mangeant à sa sauce. Même la Banque mondiale en fait un « cheval de bataille ».
Pour nous, le concept de biens communs mondiaux renvoie à une série d’enjeux qui concernent l’ensemble de l’Humanité et de la planète, dont le traitement nécessite de rompre avec la logique néfaste du capitalisme et de donner la priorité à la réponse aux besoins qui s’expriment dans une perspective de plus en plus globale et de long terme.
Il s’agit notamment d’un certain nombre d’enjeux majeurs qui sont au cœur de la crise de civilisation actuelle, et qu’il faut traiter d’urgence non seulement parce qu’ils sont au cœur de l’actualité, mais aussi et surtout pour se préparer face aux enjeux énormes qui se présentent dans un avenir pas très lointain.
À ce propos, il faut surtout évoquer l’enjeu démographique : à l’horizon de 2050, la moitié de la population mondiale vivra en Asie orientale, et la population va tripler en Afrique. Comment répondre aux besoins qu’engendreront ces évolutions ? Comment faire de la réponse à ces besoins un levier de progrès, de développement économique et social ? Penser que ces enjeux ne concernent que ces pays et ces peuples est un leurre dangereux, et cela d’autant plus que les autres pays, notamment les pays européens et le Japon, sont confrontés à un vieillissement voire à un déclin démographique.
Pour en revenir au sujet des biens communs mondiaux, il y a débat à la fois sur leur définition et leur étendue, et sur la façon dont il faut s’organiser pour les « produire », notamment du point de vue de leur financement.
S’agissant de l’étendue de ces biens communs mondiaux, il y a quasi-consensus au moins sur trois sujets, même si les solutions proposées divergent :
– la pauvreté et les inégalités de toute sorte (niveau de vie, femmes/hommes, etc.) ;
– les mouvements des populations ;
la préservation de l’environnement.
Pour nous, de par le rôle qu’ils jouent ou les enjeux qu’ils présentent, au moins quatre autres enjeux relèvent de la problématique de biens communs mondiaux.
La dictature des marchés financiers
C'est l’enjeu qui a été mis en exergue notamment par la crise financière de 2008.
Contrairement aux idées reçues et largement entretenues par les libéraux, les mutations en cours ne sont pas synonymes de la fin de l’industrie ; elles confirment la nécessité d’un développement industriel respectueux de l’environnement et fortement articulé aux services de qualité, notamment les services publics.
Or l’exigence de rentabilité des capitaux financiers est un obstacle majeur devant le développement d’une industrie moderne qui réponde aux enjeux écologiques. Il faut donc libérer l’industrie du carcan financier. C’est dire que lutter contre la dictature des marchés financiers est indispensable pour reconquérir l’industrie, car la financiarisation va de pair avec la désindustrialisation.
Rappelons aussi que la violence de la crise financière de 2008 a poussé en arrière-plan un certain nombre de sujets qui sont liés aussi au rôle des marchés financiers. Il s’agit surtout de la dette du Tiers monde qui demeure un handicap pour le développement de ces pays.
La monnaie
La politique agressive de la nouvelle administration américaine depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump (mesures protectionnistes, refus du traité de Paris sur l’environnement, remise en cause de l’accord nucléaire avec l’Iran, reconnaissance de Jérusalem comme capital d’Israël et la paralysie des pays européens, notamment en ce qui concerne le chantage du gouvernement américain annonçant des sanctions à l’endroit des entreprises qui poursuivraient leurs relations commerciales avec l’Iran) confirme, si besoin était, que dans une économie globalisée, la monnaie fait partie intégrante des biens communs mondiaux car, à présent, le dollar américain est de fait la monnaie mondiale et le gouvernement américain l’utilise comme une véritable arme contre les autres pays.
Pour leur part, ces « autres pays » ont une grande responsabilité dans cette hégémonie du dollar. C’est notamment le cas des pays européens qui n’ont pas pu, à cause des politiques libérales mises en place, faire de l’euro une monnaie qui facilite le développement économique et social et qui permette de mettre fin à l’hégémonie du dollar.
La paix et le désarmement
L’épisode Trump/Kim confirme la nécessité de mener la bataille, hélas un peu poussée en arrière-plan, du désarmement nucléaire.
On a toutes les raisons de s’inquiéter des conséquences du réchauffement climatique, à l’horizon de cinquante ans notamment, quoique celles-ci commencent déjà à se manifester. On a cependant tendance à oublier que l’humanité, toute la planète, sont menacées de disparition non pas à un horizon long, mais immédiatement, à l’instant même, à cause de la présence massive des armes nucléaires, de ces arsenaux d’armes de destruction massive.
Ne faut-il pas s’indigner du fait que la vente d’armes est un commerce lucratif ?
Des centaines voire des milliers de milliards de dollars dépensés chaque année dans le monde pour produire et acheter ces armes pourront, devront, être mobilisés pour lutter contre la pauvreté, pour créer de l’emploi, de la valeur ajoutée et répondre aux besoins largement non satisfaits à travers le monde.
La transformation des industries de l’armement est donc un enjeu important pour l’ensemble de l’humanité ; enjeu qui pose évidemment la question du devenir de ces activités et des salariés concernés. Question que posait déjà à sa manière Brecht dans le dialogue entre un ouvrier travaillant dans une usine de fabrication de canons et son fils.
Soulignons que la reconversion des industries militaires est une source de développement industriel, au même titre que la transition énergétique et écologique.
Le développement de la sphère non marchande (services publics, etc.)
Si, fondamentalement, le processus de mondialisation est lié à la révolution informationnelle, pour bâtir une autre mondialisation, il faut revenir à l’élément clef de cette révolution et à sa logique, à savoir l’information, bien par essence commun et public. Dès lors, le développement de la logique non marchande, le développement de la sphère non marchande, deviennent un enjeu fondamental, ce qui implique de rompre avec le libéralisme, la privatisation et la marchandisation.
Rappelons que le développement des services publics de qualité est aussi indispensable pour la reconquête industrielle et, en même temps, un levier pour y parvenir.
Les élections européennes en préparation sont un bon moment pour porter le débat sur ces enjeux majeurs, car les solutions ne peuvent pas être décrétées d’en haut. D’où l’importance de la démocratie et des débats démocratiques pour donner la parole aux citoyens.
Démocratie et droit des peuples à disposer d’eux-mêmes : la clef de voute de changements
L’humiliation infligée, après la crise financière de 2008, à certains pays européens, notamment et non uniquement la Grèce, n’est autre chose que ce que les peuples africains, asiatiques et d’Amérique latine ont subi pendant des décennies, voire des siècles. Il en est de même en ce qui concerne la plupart des peuples de l’Europe de l’Est depuis l’effondrement des systèmes soviétiques.
L’avenir de l’Humanité ne peut pas se fonder sur l’humiliation des peuples. Changer la mondialisation implique avant tout de rompre avec ces politiques qui méprisent les peuples, qui dévalorisent le travail pour le plaisir des détenteurs de capitaux.
Le choix des biens communs, les priorités et la façon dont il faut organiser nos sociétés pour « produire » ces biens, de même que leur mode de financement ne peuvent être délégués aux institutions comme le FMI, la Banque mondiale ou la Commission de Bruxelles. Cela devrait être l’affaire de tous les citoyens. La démocratie devient dès lors le facteur clef de changements.
Démocratie au sein des entreprises
Les travailleurs doivent pouvoir gagner le droit d’intervenir sur les choix stratégiques des entreprises. Il s’agit des choix d’implantation, d’investissement, de formation, de rémunération des travailleurs et des dirigeants… De ce point de vue, gagner des droits dans l’espace des firmes multinationales devient un enjeu extrêmement important.
Démocratie dans le cadre des États-nations également
Le fort mouvement populaire contre la « réforme » du Code du travail en France, tout comme la multiplication des protestations contre les programmes d’austérité dans l’espace européen, d’une part et, d’autre part, la montée de l’extrême droite mettent en exergue, entre autres, les limites de la démocratie délégataire. Il s’agit de surmonter l’écart grandissant entre les politiques décidées par les technocrates et la volonté citoyenne qui exige le progrès et la réponse aux besoins non satisfaits, alors que pour la plupart des citoyens les processus en cours sont synonymes de régression.
Créer des mécanismes obligeant les gouvernements à rendre compte aux citoyens des mandats qui leur sont confiés, organiser des lieux de rencontre, de réflexion et de débat pour faire valoir la volonté des citoyens... ce sont autant d’enjeux pour construire une alternative à la mondialisation libérale.
Démocratie au sein des institutions multilatérales
Au-delà de la revendication légitime de l’égalité des droits de vote au sein de ces institutions, il s’agit que les politiques de celles-ci soient orientées vers la satisfaction des besoins sociaux et des enjeux d’avenir (démographie, environnement…) en tenant compte des réalités et de la volonté des peuples.
Inspirée de l’Organisation internationale du travail (OIT), une solution possible consisterait à organiser une gestion quadripartite de ces institutions, composée des représentants des États, des salariés, du patronat et des autres composantes de la « société civile ».
Par Brugerolles Julien, le 30 June 2018
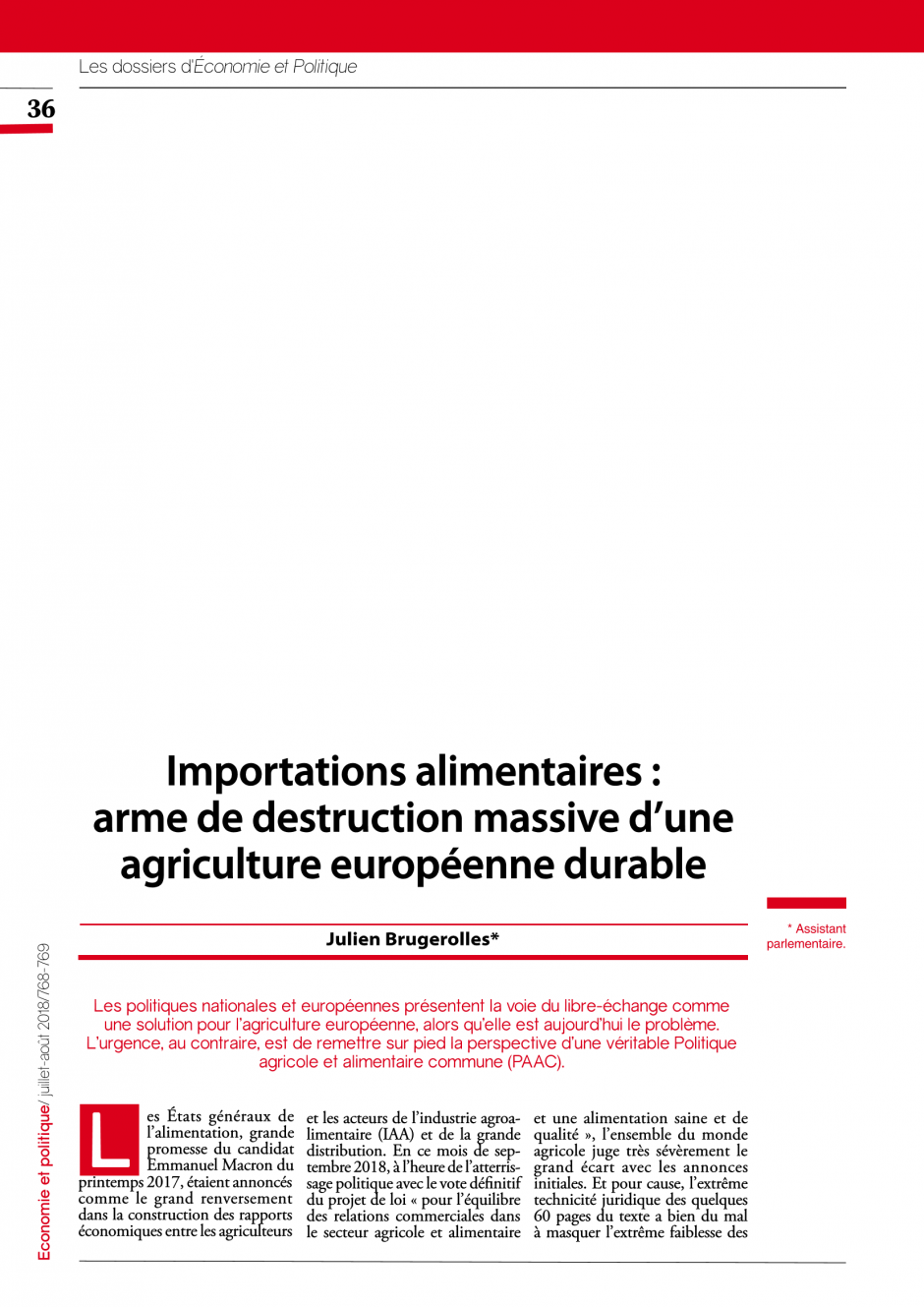
Les politiques nationales et européennes présentent la voie du libre-échange comme une solution pour l’agriculture européenne, alors qu’elle est aujourd’hui le problème.
L’urgence, au contraire, est de remettre sur pied la perspective d’une véritable Politique agricole et alimentaire commune (PAAC).
Les États généraux de l’alimentation, grande promesse du candidat Emmanuel Macron du printemps 2017, étaient annoncés comme le grand renversement dans la construction des rapports économiques entre les agriculteurs et les acteurs de l’industrie agroalimentaire (IAA) et de la grande distribution. En ce mois de septembre 2018, à l’heure de l’atterrissage politique avec le vote définitif du projet de loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et de qualité », l’ensemble du monde agricole juge très sévèrement le grand écart avec les annonces initiales. Et pour cause, l’extrême technicité juridique des quelques 60 pages du texte a bien du mal à masquer l’extrême faiblesse des outils et des moyens publics mis en place pour « renverser la logique de construction des prix ». En omettant volontairement d’agir sur les causes profondes des déséquilibres économiques et commerciaux du secteur agricole et alimentaire, il semble en effet bien difficile d’opérer la « révolution » tant promise. Car le déni de réalité porte avant tout un nom : la poursuite effrénée de l’ouverture du marché agricole européen.
L’analyse, même incomplète, des logiques de croissance des importations alimentaires qui résultent de ce choix politique assumé permet de mieux comprendre l’hypocrisie du discours politique porté par le pouvoir. Car les importations constituent aujourd’hui un des leviers majeurs – pour ne pas dire essentiel – des groupes transnationaux de l’industrie agroalimentaire et de la distribution pour assurer leurs stratégies de marges et de rentabilité financière. L’essentiel du travail de communication politique des derniers mois a ainsi consisté à entretenir l’illusion d’un volontarisme au service des producteurs qui s’opérerait sur la base d’une simple évolution du droit commercial interne, mais en occultant le fond du contenu des politiques économiques soutenues au niveau communautaire et international. Un grand écart que résumait fort bien le journaliste Gérard Le Puill dans L’Humanité du 24 mai 2018 sous la forme interrogative : « Peut-on promettre des prix rémunérateurs aux paysans et augmenter les importations ? »
Présentons donc d’abord quelques éléments de constat. Alors que la balance commerciale française poursuit sa dégradation globale (comme en témoignent les dernières données de juin 2018 des services des Douanes), le secteur agricole et agroalimentaire est toujours un moteur d’équilibre, troisième excédent commercial en valeur à 5,7 milliards d’euros en 2017. Mais le moteur tousse, et le fléchissement notable n’est pas dû à la perte de capacité exportatrice de la France (en hausse quasi constante à 60,4 milliards d’euros en 2017), mais bien à la très forte croissance parallèle des importations de produits agricoles et alimentaires à 54,8 milliards d’euros en valeur en 2017.
En 5 ans, la progression des importations en valeur approche les 9 milliards d’euros. L’analyse plus précise du contenu de ces importations permet aussi d’avoir une image assez précise des mécanismes économiques et commerciaux à l’œuvre. Cette croissance porte fortement sur les produits bruts. Non seulement la progression des importations de fruits s’accélère en particulier depuis 2010 pour atteindre les 4,5 milliards d’euros en 2015, mais le secteur des viandes et des abats, jusqu’alors plus épargné, progresse aujourd’hui aussi très fortement à 4,4 milliards d’euros en 2015 (dernières données AGRESTE). Au sein de la filière « viandes », l’exemple de l’évolution des importations de poulet, un des seuls marchés de la viande en progression en termes de consommation ces dernières années, est particulièrement démonstratif des stratégies financières de l’aval du secteur. Les volumes d’import ont quasiment triplé en 15 ans, de 188 000 tonnes par an en 2000, à près de 533 000 tonnes en 2015. Cette même année 2015, 43 % du poulet consommé n’était pas produit en France. Les viandes de volaille d’importation en restauration hors domicile représentaient 60 % de l’offre, et plus encore sur le segment du poulet standard (80 %). Pour des filières déjà historiquement très touchées comme la filière fruits et légumes, la part des importations dans la consommation annuelle est tout simplement sidérante : la France importe aujourd’hui 40 % de ses fruits et légumes.
Alors que notre pays compte tous les atouts et toutes les complémentarités agronomiques pour produire sur son propre territoire l’essentiel de ses fruits et légumes, pour élever ses poulets avec ses céréales, ces données révèlent l’ampleur de la réorientation économique à l’œuvre autour de la mise en application de stratégies très agressives d’importation par les grands opérateurs économiques nationaux et européens du secteur.
En surfant sur l’achat de produits agricoles à très bas prix, et par conséquent à très bas salaires, sans aucune exigence quant aux conditions sociales, environnementales et sanitaires, la guerre de « profitabilité » que mènent les grands groupes transnationaux s’appuie sur la conquête permanente de marges sur la transformation et la distribution. Et cette stratégie d’importation se construit sur deux pieds : une concurrence communautaire en l’absence d’harmonisation des conditions sociales et environnementales de production au sein de l’UE, et une concurrence extra communautaire avec le déploiement récent de nouveaux accords de libre-échange. Les taux de marge élevés sur ces produits importés, permettent également le déploiement de toute une panoplie d’outils marketing, depuis la simple promotion ponctuelle jusqu’à la construction d’allégations qualitatives trompeuses. Qui n’a pas été au moins une fois dupé par ces linéaires de conserves de haricots verts « extra-fins » et « rangés à la main », mais tous produits et transformés à Madagascar ou au Kenya ? Qui n’achète pas au quotidien ces cornichons « tendres » et « extra-fins » dont la production a été quasiment intégralement délocalisée en Chine et en Inde au début des années 2000 ?
L’extension de cette seule logique de rentabilité dans le secteur alimentaire a été encouragée par des choix politiques nationaux et européens très forts ces 15 dernières années. En France, la loi « Chatel » et la loi de modernisation de l’économie (dite LME) de 2008, directement inspirée des travaux de la Commission Attali « pour le libération de la croissance française » dont un des rapporteurs n’était autre qu’Emmanuel Macron, ont servi d’appui pour accentuer la pression sur les fournisseurs dans les négociations commerciales. Réforme de la PAC après réforme de la PAC, l’ouverture aux marchés mondiaux de toutes les productions avec l’abandon progressif de l’ensemble des outils de gestion des volumes et d’intervention sur le marché européen a clairement fait le lit de rapports de force toujours plus déséquilibrés pour les producteurs nationaux.
Aujourd’hui, la conduite de négociations d’accords de libre-échange bilatéraux de l’UE avec près d’une douzaine de pays dans le monde est une nouvelle étape dans l’ouverture aux importations au service des transnationales des IAA et de la distribution. En tant qu’accords globaux, le secteur agricole y est clairement marginalisé, et utilisé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne (DG Commerce), en charge des négociations, prioritairement comme une monnaie d’échange permettant l’ouverture commerciale aux autres secteurs. Le Commissaire européen à l’agriculture, Phil Hogan, auditionné le 10 octobre 2017 par l’Assemblée nationale sur les conséquences du traité de libre-échange avec le Canada (CETA), en convenait d’ailleurs très librement en ces termes : « il faut faire des compromis et des concessions en matière agricole pour que les secteurs financiers et industriels, créateurs d’emplois en France comme ailleurs en Europe, bénéficient également de ces accords. » De quoi justifier sans rechigner l’arrivée sans droits de douanes de 50 000 tonnes supplémentaires de viandes bovines canadiennes d’animaux engraissées aux farines animales et aux antibiotiques et de 100 000 tonnes supplémentaires, essentiellement d’origine brésilienne, dans le cadre de l’accord avec les pays du MERCOSUR à l’heure des scandales sanitaires sur des viandes avariées écoulées sur le marché mondial. Et que dire de l’ouverture des négociations avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande, deux pays qui ont déjà inondé le marché de la viande ovine en Europe ces vingt dernières années, mais qui ne manqueront pas de faire valoir leurs nouveaux intérêts.
L’ouverture tous azimuts aux importations d’un secteur qui répond à un besoin fondamental de l’humanité est révélatrice de la pression accrue du capital sur l’ensemble de l’économie européenne. Cette pression se fait au mépris de toutes les conséquences alimentaires, sociales, territoriales, économiques, écologiques et climatiques de ces orientations. L’essentiel des « coûts » réels de cette fuite en avant vers la dépendance alimentaire européenne sont cachés. Qu’il s’agisse de la dégradation de la qualité gustative, nutritionnelle et sanitaire des produits, du glissement vers des modes de consommation défavorables à la santé, du soutien à des modes de production construits sur la spécialisation, l’intensification et l’utilisation massive d’intrants, de l’encouragement actif au changement d’affectation des sols avec la déforestation et ses effets multiplicateurs sur les émissions de CO2, de la remise en cause à large échelle des surfaces d’agriculture vivrière dans les pays du Sud, de l’accaparement des terres et de la spéculation foncière… difficile de trouver les traces d’une évaluation sérieuse et publique de ces impacts dans la littérature libérale de la Commission !
Et quand bien même une analyse d’impact est instruite, comme pour les accords de libre-échange en cours de négociation, elle se limite à la classique (et très contestable) expertise « coûts/avantages » sur la balance commerciale des filières. Comme le souligne le dernier rapport d’information « pour une agriculture durable pour l’Union européenne » présenté le 31 mai 2018 par les députés André Chassaigne et Alexandre Freschi devant la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale, la DG Agriculture de la Commission européenne a bien rendu publique une étude « sur l’impact économique cumulé » des (12) futurs accords commerciaux sur l’agriculture européenne d’ici 2025. Ses conclusions avancent non seulement un impact négatif pour l’essentiel des filières, en particulier pour les viandes bovines et ovines, mais surtout elles ne font jamais le lien direct avec sa traduction sur la réalité humaine, sociale, économique, territoriale et environnementale.
Contrairement à l’image de « réalisme économique » si souvent véhiculée, on n’importe pas seulement des « produits agricoles », on délocalise surtout à bon compte l’ensemble des facteurs de production, tout en déstructurant des systèmes agricoles historiquement construits et qui peuvent être par ailleurs soutenus par des politiques publiques comme la PAC. Pour donner une illustration parmi d’autres de ces implications, une estimation reprise notamment par le think tank Momagri évaluait en 2008 à 35 millions d’hectares de terres agricoles l’équivalent en termes de surfaces de production des importations agricoles de l’UE. Ces « terres virtuelles » représentaient alors 35 % de l’ensemble de la surface agricole utile européenne. Où en sommes-nous 10 ans plus tard ?
En faisant le choix de valoriser sur le marché européen des productions importées, en substitution de productions européennes, l’UE porte atteinte délibérément à l’ensemble de l’agriculture communautaire, aux principes fondateurs de la PAC et à toute ambition de transition agricole et alimentaire vers des systèmes durables, créateurs de richesse et d’emplois pérennes.
L’urgence est à remettre sur pied la perspective d’une véritable Politique agricole et alimentaire commune (PAAC), au moment où la voie du libre-échange est poussée comme une solution alors qu’elle est aujourd’hui le problème. Cela implique une première rupture politique à conquérir aux côtés des actifs agricoles, de leurs représentants syndicaux et des citoyens européens : la reconnaissance d’une exception agricole, d’une exclusion du secteur agricole des accords de libre-échange et l’indispensable besoin d’une coopération basée sur des objectifs communs et partagés. Tandis que l’horizon qui se dégage des propositions de la Commission européenne pour la PAC 2020-2025 est celui d’une renationalisation marquée des politiques agricoles, le premier risque est de voir s’amplifier encore les concurrences intracommunautaires, et la fuite en avant des États vers des politiques de « compétitivité » toujours plus agressives, poussés qu’ils sont en cela par leurs champions nationaux du secteur.
Cette conquête d’une vision commune se doit d’éviter l’écueil des raccourcis et des simples injonctions au regard de la situation réelle de l’agriculture européenne comme nationale, et de la dégradation marquée et continue des agro-systèmes à l’échelle mondiale. Elle est indispensable pour progresser vers d’autres avancées telles que l’harmonisation des normes sanitaires et environnementales et la lutte pour une protection sociale de haut niveau pour tous les travailleurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
Bien entendu, et de façon complémentaire, notre projet de PAAC doit aussi pouvoir s’articuler autour de propositions plus concrètes et spécifiques : le maintien d›un budget fort et solidaire, la réorientation du premier pilier au profit d’un soutien à l›actif, à l’installation et à la montée en gamme des productions, le retour de mécanismes de régulation des volumes et des marchés, la définition de nouveaux outils en faveur de garanties de revenus, des soutiens spécifiques à l’échelle européenne pour le transfert des pratiques agricoles durables sur chaque type de production.
le 30 June 2018
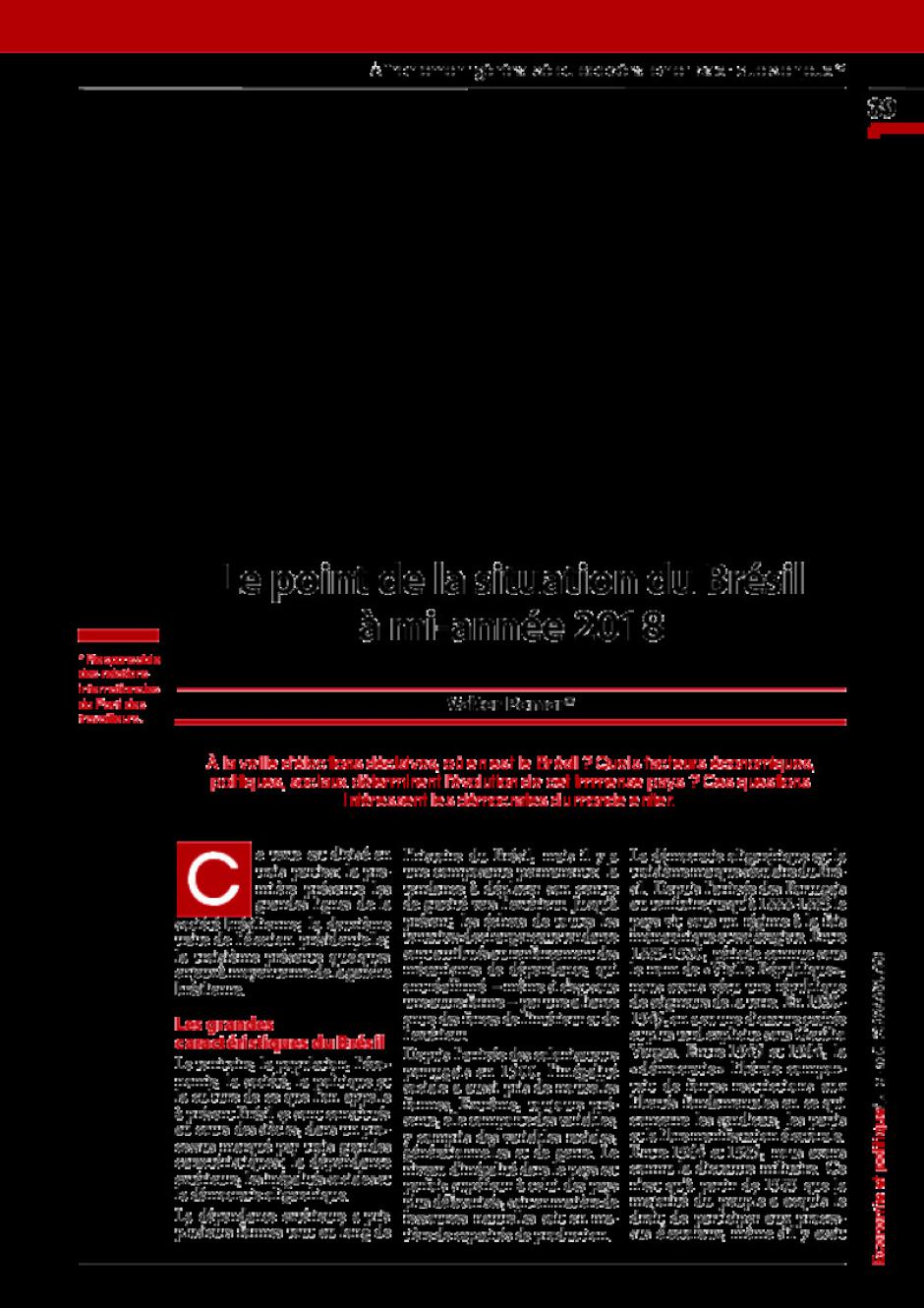
Ce texte est divisé en trois parties : la première présente les grandes lignes de la société brésilienne ; la deuxième traite de l’élection présidentielle ; la troisième présente quelques enjeux à moyen terme de la gauche brésilienne.
Le territoire, la population, l’économie, la société, la politique et la culture de ce que l’on appelle à présent Brésil se sont constitués au cours des siècles, dans un processus marqué par trois grandes caractéristiques : la dépendance extérieure, les inégalités sociales et la démocratie oligarchique.
La dépendance extérieure a pris plusieurs formes tout au long de l’histoire du Brésil, mais il y a une composante permanente : la tendance à déplacer son centre de gravité vers l’extérieur. Jusqu’à présent, les échecs de toutes les tentatives de changer cette tendance sont attribués au renforcement des mécanismes de dépendance, qui ont réaffirmé – même si c’est sous une autre forme – par une alliance entre des forces de l’intérieur et de l’extérieur.
Depuis l’arrivée des colonisateurs portugais en 1500, l’inégalité sociale a aussi pris de nouvelles formes. Extrême, toujours présente, elle comporte des variables, y compris des variables raciales, générationnelles et de genre. Le niveau d’inégalité dans le pays est parfois supérieur à celui des pays plus défavorisés, soit en matière de ressources naturelles soit en matière de capacités de production.
La démocratie oligarchique est la troisième marque séculaire du Brésil. Depuis l’arrivée des Portugais au territoire jusqu’à 1888-1889 le pays vit sous un régime à la fois monarchique et esclavagiste. Entre 1889-1930, période connue sous le nom de « Vieille République », nous avons vécu une république de seigneurs de la terre. En 1930-1945, on a eu une dictature cachée et plus tard explicite sous Getúlio Vargas. Entre 1945 et 1964, la « démocratie » libérale comportait de fortes restrictions aux libertés fondamentales en ce qui concerne les syndicats, les partis et la libre manifestation électorale. Entre 1964 et 1985, nous avons connu la dictature militaire. Ce n’est qu’à partir de 1989 que la majorité du peuple a acquis le droit de participer aux processus électoraux, même s’il y avait des contraintes de l’influence de l’argent, de l’oligopole des médias et des règles électorales qui tordent de système de représentation proportionnelle.
La dépendance extérieure, les inégalités sociales et la démocratie oligarchique sont à l’origine des principales caractéristiques, contrastes et contradictions de la société brésilienne.
Ces caractéristiques incluent un modèle de développement qui est par défaut prisonnier de ces trois marques que nous venons de décrire. Ayant une nature limitée, il n’arrive pas à passer la barrière, il semble toujours progresser peu si l’on considère les possibilités et potentialités du pays. Il nous semble aussi qu’il s’agit d’un phénomène cyclique, c’est-à-dire qu’il retourne toujours au point de départ, plus précisément à cause des certains enjeux et obstacles. Au cours de 517 années nous avons crû beaucoup mais, par contre, développé peu.
En deux moments de l’histoire récente, la société brésilienne semblait commencer à surmonter son modèle standard de développement : depuis les années 1930 et 2003.
Depuis 1930, l’urbanisation, l’industrialisation, le renforcement de l’État, les transformations sociales, politiques et culturelles ont pris des dimensions importantes. Cependant, le cycle de développement démarré par la Révolution de 1930 a atteint son point culminant autour des années 1980. À la fin de cette décennie, la classe dominante du pays a choisi le chemin des réformes néolibérales entraînant, dans les années 1990, la fin d’une partie importante du progrès accompli dans les décennies précédentes et renforçant les grandes caractéristiques de l’histoire nationale.
Dès le début, la classe dominante brésilienne a été un partenaire minoritaire des classes dominantes des métropoles, qu’elles soient ibériques, anglaise ou américaine. Il est important de noter que choisir de faire face aux métropoles demanderait de sa part une alliance solide avec les autres couches de la population. En contrepartie, cette alliance devrait se traduire en réforme agraire, en salaires plus élevés, en politiques sociales effectivement universelles avec la participation démocratique des habitants aux affaires du pays. La conséquence de ces mesures, mises en place, ensemble ou séparément, serait la réduction des profits et du statut de la classe dominante. Voilà pourquoi elle a non seulement un rapport de complaisance, mais aussi de protection et reproduction de la dépendance extérieure, des inégalités sociales, de la démocratie oligarchique et d’adhésion à des politiques de développement limité.
C’est quand Luís Inácio Lula da Silva (Lula) entre en fonction, le 1er janvier 2003, qu’a lieu la deuxième tentative de surmonter le développement limité standard. Parmi les partis et les mouvements de la gauche brésilienne, le débat est intense sur les réussites et les contraintes de cette tentative conduite par Lula et le Parti des travailleurs (PT). De toute façon, quelles que soient les réussites et les erreurs de cette tentative sous les gouvernements du PT, la crise financière internationale de 2008, ou, plus précisément, les effets des démarches des États-Unis pour surmonter la crise, ont provoqué un changement d’attitude de la classe dominante brésilienne face au PT et à ses gouvernements. Finalement, en 2016, après le coup d’État contre la présidente Dilma Rousseff, les forces adeptes des politiques néolibérales ont mis en place une reconquête totale du gouvernement et, depuis lors, elles ont détruit tout qui a été construit depuis 2003 en démolissant des aspects positifs de la Constitution fédérale de 1988 et notamment en remettant en cause des conquêtes des années 1950 (comme la compagnie pétrolière nationale Petrobras) et des années 1930 (comme la Consolidation des lois du travail).
Un nombre croissant de défavorisés errant dans les centres-villes, la violence policière contre les jeunes noirs « périphériques », les explosions du système carcéral, la croissance du machisme et de l’homophobie, le discours fasciste sur les réseaux sociaux, ce sont des effets collatéraux du renforcement du néolibéralisme et, parallèlement, il y a l’approfondissement de la dépendance extérieure, des inégalités sociales et des restrictions aux libertés démocratiques.
Dans un pays marqué par des inégalités importantes comme le Brésil, la possibilité d’occuper des terres en friche – même si elles sont situées loin des grandes villes –, les hauts taux de croissance économique, les politiques sociales et la participation démocratique – même limités – ont constitué une soupape pour les tensions sociales accumulées. L’action du néolibéralisme dans les années 1990 et la reprise néolibérale à présent, depuis 2016, associés à un cadre international croissant de crise et polarisation, instaurent un environnement politique et social explosif.
En arrière-plan de la défaite de la gauche brésilienne, notamment du PT, face au coup d’État de 2016 et depuis lors, on trouve trois déplacements de classe importants :
a. Entre 2003 et 2005, la gauche a perdu le soutien et voit monter l’opposition progressive d’une grande partie des classes moyennes. Jusqu’à 2002, elles ont eu une trajectoire de soutien croissant au PT et ses candidatures. Quelle est la cause de ce changement de position ? L’une des causes de fond est que la politique du parti visant à améliorer les conditions de vie des pauvres sans toucher aux profits des riches les a affectées du point de vue matériel et idéologique.
b. Entre 2011 et 2014, on voit la poussée de l’opposition totale du secteur des plus grands capitalistes contre la gauche brésilienne. Entre 2003 et 2010 le grand capital a adopté une combinaison de tactiques : stimuler certaines politiques du gouvernement, s’opposant au piétisme et soutenant principalement les candidatures du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB, droite) et d’autres partis similaires. Pourquoi ce changement de position ? L’une des causes de fond est la suivante : l’un des effets collatéraux de la crise de 2008 a été la disparition des possibilités offertes par les affaires internationales, qui a poussé la classe capitaliste brésilienne à revenir à son fonctionnement normal consistant à surexploiter la classe ouvrière et à livrer les ressources nationales à des intérêts étrangers. C’était incompatible avec la présence du PT à la tête du gouvernement d’État.
c. Notamment en 2015, la gauche brésilienne a perdu le soutien d’une partie importante de la classe ouvrière, recevant plutôt son indifférence. Le tournant s’est produit vers la fin 2014-début 2015 quand la présidente Dilma Rousseff a mis en place un projet d’ajustement fiscal occasionnant des dégâts matériels immédiats pour la classe ouvrière.
Dans les élections présidentielles de 2006, 2010 et 2014, la gauche brésilienne avait réussi à affronter et à vaincre l’alliance entre les classes moyennes et le grand capital. Cela n’a pas été possible en 2015-2016 essentiellement en raison de la perte du soutien de la majorité de la classe ouvrière.
La classe dominante et ses alliés étaient impliqués dans le coup d’État parlementaire, médiatique et judiciaire de 2016, qui visait les objectifs suivants :
a. Réduire les salaires et les cotisations sociales, ainsi que supprimer des libertés démocratiques de la classe ouvrière.
b. Aligner notre politique extérieure sur celle des États-Unis et leurs alliés.
c. Rétablir la position de la gauche brésilienne en tant que force minoritaire ou équipe de soutien d’une partie de la classe capitaliste contre l’autre, comme avant 1980, rendant toute alternative de gauche au gouvernement et toute transformation en alternative de pouvoir impossible.
Depuis le coup d’État de 2016, plusieurs mesures ont été prises pour mettre en œuvre ces objectifs, parmi lesquels la réforme du Code du travail, qui supprime les droits de la classe ouvrière ; la révision de la politique nationale pétrolière, afin de servir les intérêts des multinationales de ce secteur.
Pour réussir ces objectifs à moyen terme, les putschistes doivent remporter les élections qui auront lieu en octobre 2018.
Dans les premiers mois de 2016, le coup d’État a obtenu un certain succès et un soutien populaire, constaté non seulement sur la base de sondages d’opinion, mais aussi sur les résultats obtenus par les partis putschistes aux élections municipales. Cependant, aujourd’hui la popularité du gouvernement putschiste est anémique, contaminant la plupart des candidatures présidentielles liées au coup d’État.
En ce moment il y a 13 candidatures à la présidence de la République. De ce nombre, quatre demandes ont été formulées par les partis qui se sont opposés au coup d’État de 2016. Les autres 9 précandidatures ont été lancées par les partis qui ont soutenu le coup d’État de 2016.
Jusqu’à présent, le capitaine Jair Bolsonaro – défenseur de positions d’extrême droite – est le seul candidat putschiste qui révèle un stock suffisant de voix pour passer au deuxième tour.
Lula était en tête de tous les candidats dans tous les sondages, avec plus d’intention de vote que tous les autres candidats ensemble mais sa candidature a été bloquée par voie judiciaire le 11 septembre. Fernando Haddad a été désigné à sa place comme candidat du PT avec comme colistière Manuela D’Avila du Parti communiste du Brésil (PCdoB). Depuis cette date, deux évolutions majeures se sont produites. La première est le report en faveur de Haddad des intentions de votes précédemment favorables à Lula. La deuxième évolution est une consolidation des intentions de vote pour Bolsonaro. La tendance actuelle fait envisager un deuxième tour entre Bolsonaro et Haddad, dont Haddad sortirait victorieux.
Ce serait une catastrophe pour les putschistes car leur problème, ce n’est pas Lula, c’est le PT et la gauche. Que peuvent-ils faire pour l’empêcher ? En ce qui concerne les alternatives électorales (étant donné qu’une partie d’entre eux n’exclut pas des alternatives non électorales, c’est-à-dire un coup d’État militaire), il existe trois possibilités : a) écarter Bolsonaro du deuxième tour (par quelque conspiration) et mettre en avant un candidat plus acceptable ; b) soutenir Bolsonaro à fond, en négociant des garanties telles que l’autonomie de la Banque centrale et le parlementarisme ; c) effectuer des opérations extraordinaires pour essayer d’empêcher Haddad et le PT d’atteindre le deuxième tour en faisant émerger un candidat « modéré », ce qui semble difficile au vu des sondages actuels.
En outre, actuellement un grand pourcentage d’électeurs n’ont pas encore pris leur décision. Mais il y a des signes qui nous indiquent qu’un bon nombre d’entre eux doit pencher pour les votes blancs, nuls et l’abstention. Les autres doivent se répartir entre les candidatures principales. Par conséquent, la polarisation entre Lula et Bolsonaro peut se maintenir dominante jusqu’à la fin de la campagne électorale.
Ce n’est pas en se rapprochant du centre que la gauche peut réussir à faire barrage à l’extrême droite mais en démasquant le programme socio-économique de Bolsonaro et en mettant en avant son propre programme et les mesures d’urgence qu’elle propose pour gagner au vote Haddad l’électorat populaire.
La profondeur de la crise brésilienne indique deux possibilités : une rupture conservatrice et une rupture populaire.
Les forces putschistes s’orientent vers une rupture conservatrice, dont l’expression extrême serait la dictature. Les actions des putschistes sont déjà à la limite de la légalité, comme l’a démontré un épisode récent où Lula a été maintenu en détention malgré l’octroi de la demande d’habeas corpus ; les aspects démocratiques et sociaux de la Constitution de 1988 ont été supprimés ; les militaires sont déjà convoqués pour prendre des postes et des tâches autrefois réservés aux civils.
Cependant, une rupture conservatrice demanderait une intervention militaire explicite, ce qui jusqu’à présent n’est pas souhaitable pour les dirigeants militaires. À cause des possibles effets collatéraux dans le cadre international et national, le grand capital hésite à toucher à cette question.
D’ailleurs, une rupture populaire demanderait une lutte populaire à croissance exponentielle, associée à une victoire électorale massive de la gauche en 2018, permettant au gouvernement élu d’annuler les mesures adoptées par les putschistes depuis la destitution de la présidente Dilma ; de mettre en place un « plan d’urgence » ; convoquer une Assemblée constituante ; faire débuter un cycle de réformes structurelles. En même temps, il faut réunir des forces pour défaire la réaction des capitalistes et de leurs alliés.
Les conditions pour un tournant dans notre conjoncture ne sont pas encore visibles, mais elles pourraient éventuellement se produire. Ainsi, on estime que la situation politique brésilienne continuera d’être instable en dépit des résultats des élections, en octobre 2018, à la présidence, des gouverneurs des États, du Congrès national, des Chambres de députés des États.
Dans ce contexte, les forces de gauche visent à :
a. Retrouver la capacité de mobilisation et de soutien organisé auprès de la classe ouvrière.
b. Garder la classe ouvrière et la gauche comme pôles protagonistes indépendants, empêchant qu’elles retournent au poste d’équipe de soutien dans la dispute entre deux secteurs de la bourgeoisie, tout en gardant les groupes démocratiques et populaires comme alternatives au gouvernement, cherchant sa conversion en alternative de pouvoir.
De ce point de vue, il paraît important de penser que le futur de 2018 c’est aussi le futur du PT.
Depuis 1989 il y a des secteurs qui ont rompu les liens avec le parti pour construire des alternatives de gauche. Toutes leurs tentatives de supplanter le PT ont finalement échoué. Le PT risque d’être détruit à cause de ses erreurs, combinées aux attaques de la droite. Si cette situation se concrétise, on aura pour des décennies le retour d’une gauche du modèle que l’on avait principalement avant les années 1980 : marginale et subordonnée à un secteur de la classe dominante, sans constituer une alternative de gouvernement ou sans accéder au pouvoir.
Ainsi, la survie et le renforcement du PT sont de l’intérêt de l’ensemble de la gauche. Il y a plusieurs signes indiquant la survie du parti, parmi lesquels le résultat des sondages : le PT est le parti le plus populaire du pays ayant un soutien cinq fois supérieur à celui de son concurrent.
Néanmoins, il y a aussi des indices défavorables. Parmi eux, le principal est la difficulté d’une grande partie du PT de traduire en mesures concrètes le fait que la lutte des classes est passée à un autre niveau, à cause des actions du grand capital.
Désormais, l’ensemble de la gauche devrait surmonter des défis extrêmes comparables à ceux de la période 1990-2002. Parmi eux, élaborer et soutenir un nouveau projet de développement – orienté vers la fin de la dépendance extérieure, des inégalités sociales, de la démocratie oligarchique et impliquant non seulement des réformes structurelles combinées à des politiques publiques, mais aussi avec la lutte directe pour le socialisme.
Ces reformes incluent : la réforme fiscale, la réforme financière, la réforme agraire, la souveraineté énergétique, la constitution de l’État-providence, la garantie et l’élargissement des droits civils, la réforme politique, la démocratisation des médias, la réforme du système juridique et du système de sécurité.
L’ensemble de ces réformes doit se traduire, fusionner et se matérialiser dans un ensemble de politiques publiques. Du coup, la réussite de ces réformes et des politiques publiques dépend du moteur économique du Brésil, principalement en ce qui concerne les points suivants :
a. L’adaptation de la production de biens et services à la demande sociale actuelle et à la croissance de la population tout en tenant en compte ses besoins.
b. L’objectif d’avoir des taux de croissance et de productivité capables d’absorber la masse de chômeurs et de nouveaux entrants sur le marché de travail.
c. La rémunération pécuniaire directe (salaires et pensions) et la rémunération pécuniaire indirecte (l’offre de services publics) permettant aux personnes en activité et en retraite d’avoir une meilleure qualité de vie de façon continue.
d. Une capacité de production qui, au fil du temps, soit analogue aux niveaux des moyens de production des pays les plus développés.
Le Brésil n’est pas condamné pour toujours à être exportateur des produits du secteur primaire et importateur de produits industriels. Pour changer ce cadre, il nous faut un nouveau processus de « substitution d’importations » basé sur l’association de l’élargissement du marché des produits de consommation de masse avec le développement d’un grand marché de biens d’équipement.
Il sera également nécessaire de mettre en place un ensemble d’actions afin d’articuler : a) la dévaluation du real face au dollar ; b) la réduction des taux d’intérêt en adéquation avec l’investissement productif ; c) la taxation du capital spéculatif et d’autres mesures pour garantir la qualité de l’investissement étranger ; d) la taxation des importations ; e) la réduction du service de la dette pour garantir l’extension de la capacité d’investissement de l’État ; f) l’élaboration d’un programme d’investissement public dans les infrastructures.
Il s’agit d’investir lourdement dans le transport collectif en zone urbaine ; dans l’infrastructure urbaine ; dans le transport ferroviaire ; dans les transports par voie navigable ; dans le logement social et tous les services publics qui touchent cette question, notamment l’assainissement .
Ces investissements publics constituent un investissement social, l’extension de l’offre et de la qualité des biens publics tout en ayant comme grand objectif la reconstruction d’une industrie solide et technologiquement avancée.
Ainsi, le but principal de la réindustrialisation n’est pas l’offre des biens de consommation individuelle, mais plutôt l’extension de l’offre et de la qualité des biens d’usage collectifs, comme les navires, les trains, les métros, les autobus, et pas majoritairement en faveur du transport individuel.
Il faut souligner que l’extension de la capacité de consommation de la population étendra aussi le marché de consommation de masse des biens privés. L’ensemble des millions de Brésiliens et Brésiliennes a le droit de consommer plus. Il faut donc associer l’offre des biens de consommation publics à celle des biens privés.
Évidemment, ces mesures se heurtent aux intérêts des oligopoles privés, dont beaucoup sont des entreprises transnationales ayant le contrôle sur les chaînes de productions. Ce sont de grands importateurs et des producteurs de biens de consommation de masse qui ne sont pas intéressés à l’expansion de la production nationale.
Cela veut dire aussi un choc contre les idées préconçues d’une partie de la population, qui confond systématiquement le bien-être avec l’extension de la consommation des biens privés.
Pour réussir ce développement en tenant compte des dimensions qu’on vient de présenter, il nous faut une autre organisation politique et un État fort, capable de concevoir et faire prévaloir les intérêts collectifs sur des intérêts individuels, les intérêts de la majorité de la population sur ceux de la minorité, les intérêts nationaux sur les intérêts internationaux. Un État capable de construire un secteur financier national qui atteigne l’objectif d’être 100 % public, conjugué à un grand nombre de banques des États, municipalités, et aussi des banques privées et/ou coopératives. Une telle dynamique ne sera pas le résultat de la « libre concurrence » entre les entreprises privées ou du « libre marché » international, surtout dans la conjoncture mondiale.
Bref, c’est à la gauche de développer au niveau pratique et théorique une alternative d’avenir visant à affronter et surmonter les trois grandes caractéristiques de la trajectoire du pays.
Il nous faut une tentative dont le résultat soit un pays souverain au plan national, avec la démocratie politique, l’égalité sociale et le développement durable.
Il nous faut un projet de développement intégrant les divers aspects de la société brésilienne tout en s’orientant vers la construction d’un pays où l’ensemble de la classe ouvrière obtient un niveau élevé de vie matérielle, culturelle et politique. Les conditions historiques effectives du Brésil indiquent que pour atteindre ces objectifs il faut une organisation économiquement, socialement et politiquement socialiste.
La quête de ces objectifs aura plus de chances de réussite si cette organisation est mise en place de façon intégrée avec les autres pays de l’Amérique latine et les Caraïbes, tout en conservant un certain degré de coopération entre les pays des BRICS.
L’Amérique latine et les Caraïbes ont été victimes au cours des années 1960 et 90 des gouvernements dictatoriaux et néolibéraux. Depuis 1998 un cycle de gouvernements progressistes à gauche a été enclenché. Malgré leurs faiblesses et différences, ce changement a présenté des résultats positifs : expansion du bien-être social et de l’égalité sociale, des libertés démocratiques, de la souveraineté nationale et de l’intégration régionale.
C’est depuis la crise de 2008 et à cause de ses effets, de l’action du gouvernement des États-Unis, de l’opposition de la droite, ajoutée aux erreurs et contraintes des expériences « progressistes de gauche », que s’et engagé ce cycle d’attaques réactionnaires. Ils ont vaincu les gouvernements progressistes de gauche de la région ou les ont mis en garde, ainsi que les forces sociales et partisanes liées aux ouvriers.
Jusqu’à la crise internationale de 2008 les gouvernements progressistes à gauche ont réussi à gérer leurs limites, contradictions et fautes. Cependant, depuis la crise de 2008, la dégradation des prix des produits de base, la dépendance financière et commerciale, la force des oligopoles – surtout étrangers – et la faiblesse de l’État rendent la situation très difficile. En outre, un ensemble de problèmes accumulés s’est aggravé, soit le rejet, la limitation du plan d’action politique, des politiques d’intégration trop timides, les politiques macro-économiques privilégiant l’agro-exportation et le secteur financier, etc.
Le retour de la droite aux gouvernements a donné lieu à des revers en matière sociale, économique et politique, comme des revers dans la politique étrangère, soumise à nouveau aux intérêts des États-Unis.
Le fait que plusieurs gouvernements progressistes existent et se soutiennent mutuellement a été un élément important pour avancer collectivement. L’offensive réactionnaire s’oriente en sens inverse.
Aujourd’hui, les classes ouvrières de la région sont appelées à arrêter les attaques réactionnaires, à récupérer les espaces qu’on occupait autrefois, à assurer de nouvelles victoires, à créer des conditions pour redonner la prépondérance à l’Union des nations sud-américaines (UNASUL) et à la Communauté d’États latino-américains et caraïbes sur la scène internationale, tout en visant la paix, un nouvel ordre économique et une nouvelle politique internationale.
Face à une nouvelle situation, la gauche est appelée à créer une nouvelle stratégie. L’une de ses composantes, aujourd’hui comme hier, demeure l’intégration de l’Amérique latine et des Caraïbes.
Dans ce contexte d’hégémonie capitaliste, de crise du capitalisme, de développement des contradictions intercapitalistes, de conflits des États-Unis contre les BRICS, d’instabilité, de crise et de la croissante menace de guerre, l’alternative est de construire un fort mouvement international ancré dans les classes ouvrières et dans les secteurs populaires, non seulement pour faire de la résistance, mais aussi pour rallier d’autres gouvernements, réorientant ainsi l’économie et la politique vers un monde socialiste. zzz
* Responsable des relations internationales du Parti des travailleurs.
Par Pomar Valter, le 30 June 2018

Ce texte est divisé en trois parties : la première présente les grandes lignes de la société brésilienne ; la deuxième traite de l’élection présidentielle ; la troisième présente quelques enjeux à moyen terme de la gauche brésilienne.
Le territoire, la population, l’économie, la société, la politique et la culture de ce que l’on appelle à présent Brésil se sont constitués au cours des siècles, dans un processus marqué par trois grandes caractéristiques : la dépendance extérieure, les inégalités sociales et la démocratie oligarchique.
La dépendance extérieure a pris plusieurs formes tout au long de l’histoire du Brésil, mais il y a une composante permanente : la tendance à déplacer son centre de gravité vers l’extérieur. Jusqu’à présent, les échecs de toutes les tentatives de changer cette tendance sont attribués au renforcement des mécanismes de dépendance, qui ont réaffirmé – même si c’est sous une autre forme – par une alliance entre des forces de l’intérieur et de l’extérieur.
Depuis l’arrivée des colonisateurs portugais en 1500, l’inégalité sociale a aussi pris de nouvelles formes. Extrême, toujours présente, elle comporte des variables, y compris des variables raciales, générationnelles et de genre. Le niveau d’inégalité dans le pays est parfois supérieur à celui des pays plus défavorisés, soit en matière de ressources naturelles soit en matière de capacités de production.
La démocratie oligarchique est la troisième marque séculaire du Brésil. Depuis l’arrivée des Portugais au territoire jusqu’à 1888-1889 le pays vit sous un régime à la fois monarchique et esclavagiste. Entre 1889-1930, période connue sous le nom de « Vieille République », nous avons vécu une république de seigneurs de la terre. En 1930-1945, on a eu une dictature cachée et plus tard explicite sous Getúlio Vargas. Entre 1945 et 1964, la « démocratie » libérale comportait de fortes restrictions aux libertés fondamentales en ce qui concerne les syndicats, les partis et la libre manifestation électorale. Entre 1964 et 1985, nous avons connu la dictature militaire. Ce n’est qu’à partir de 1989 que la majorité du peuple a acquis le droit de participer aux processus électoraux, même s’il y avait des contraintes de l’influence de l’argent, de l’oligopole des médias et des règles électorales qui tordent de système de représentation proportionnelle.
La dépendance extérieure, les inégalités sociales et la démocratie oligarchique sont à l’origine des principales caractéristiques, contrastes et contradictions de la société brésilienne.
Ces caractéristiques incluent un modèle de développement qui est par défaut prisonnier de ces trois marques que nous venons de décrire. Ayant une nature limitée, il n’arrive pas à passer la barrière, il semble toujours progresser peu si l’on considère les possibilités et potentialités du pays. Il nous semble aussi qu’il s’agit d’un phénomène cyclique, c’est-à-dire qu’il retourne toujours au point de départ, plus précisément à cause des certains enjeux et obstacles. Au cours de 517 années nous avons crû beaucoup mais, par contre, développé peu.
En deux moments de l’histoire récente, la société brésilienne semblait commencer à surmonter son modèle standard de développement : depuis les années 1930 et 2003.
Depuis 1930, l’urbanisation, l’industrialisation, le renforcement de l’État, les transformations sociales, politiques et culturelles ont pris des dimensions importantes. Cependant, le cycle de développement démarré par la Révolution de 1930 a atteint son point culminant autour des années 1980. À la fin de cette décennie, la classe dominante du pays a choisi le chemin des réformes néolibérales entraînant, dans les années 1990, la fin d’une partie importante du progrès accompli dans les décennies précédentes et renforçant les grandes caractéristiques de l’histoire nationale.
Dès le début, la classe dominante brésilienne a été un partenaire minoritaire des classes dominantes des métropoles, qu’elles soient ibériques, anglaise ou américaine. Il est important de noter que choisir de faire face aux métropoles demanderait de sa part une alliance solide avec les autres couches de la population. En contrepartie, cette alliance devrait se traduire en réforme agraire, en salaires plus élevés, en politiques sociales effectivement universelles avec la participation démocratique des habitants aux affaires du pays. La conséquence de ces mesures, mises en place, ensemble ou séparément, serait la réduction des profits et du statut de la classe dominante. Voilà pourquoi elle a non seulement un rapport de complaisance, mais aussi de protection et reproduction de la dépendance extérieure, des inégalités sociales, de la démocratie oligarchique et d’adhésion à des politiques de développement limité.
C’est quand Luís Inácio Lula da Silva (Lula) entre en fonction, le 1er janvier 2003, qu’a lieu la deuxième tentative de surmonter le développement limité standard. Parmi les partis et les mouvements de la gauche brésilienne, le débat est intense sur les réussites et les contraintes de cette tentative conduite par Lula et le Parti des travailleurs (PT). De toute façon, quelles que soient les réussites et les erreurs de cette tentative sous les gouvernements du PT, la crise financière internationale de 2008, ou, plus précisément, les effets des démarches des États-Unis pour surmonter la crise, ont provoqué un changement d’attitude de la classe dominante brésilienne face au PT et à ses gouvernements. Finalement, en 2016, après le coup d’État contre la présidente Dilma Rousseff, les forces adeptes des politiques néolibérales ont mis en place une reconquête totale du gouvernement et, depuis lors, elles ont détruit tout qui a été construit depuis 2003 en démolissant des aspects positifs de la Constitution fédérale de 1988 et notamment en remettant en cause des conquêtes des années 1950 (comme la compagnie pétrolière nationale Petrobras) et des années 1930 (comme la Consolidation des lois du travail).
Un nombre croissant de défavorisés errant dans les centres-villes, la violence policière contre les jeunes noirs « périphériques », les explosions du système carcéral, la croissance du machisme et de l’homophobie, le discours fasciste sur les réseaux sociaux, ce sont des effets collatéraux du renforcement du néolibéralisme et, parallèlement, il y a l’approfondissement de la dépendance extérieure, des inégalités sociales et des restrictions aux libertés démocratiques.
Dans un pays marqué par des inégalités importantes comme le Brésil, la possibilité d’occuper des terres en friche – même si elles sont situées loin des grandes villes –, les hauts taux de croissance économique, les politiques sociales et la participation démocratique – même limités – ont constitué une soupape pour les tensions sociales accumulées. L’action du néolibéralisme dans les années 1990 et la reprise néolibérale à présent, depuis 2016, associés à un cadre international croissant de crise et polarisation, instaurent un environnement politique et social explosif.
En arrière-plan de la défaite de la gauche brésilienne, notamment du PT, face au coup d’État de 2016 et depuis lors, on trouve trois déplacements de classe importants :
a. Entre 2003 et 2005, la gauche a perdu le soutien et voit monter l’opposition progressive d’une grande partie des classes moyennes. Jusqu’à 2002, elles ont eu une trajectoire de soutien croissant au PT et ses candidatures. Quelle est la cause de ce changement de position ? L’une des causes de fond est que la politique du parti visant à améliorer les conditions de vie des pauvres sans toucher aux profits des riches les a affectées du point de vue matériel et idéologique.
b. Entre 2011 et 2014, on voit la poussée de l’opposition totale du secteur des plus grands capitalistes contre la gauche brésilienne. Entre 2003 et 2010 le grand capital a adopté une combinaison de tactiques : stimuler certaines politiques du gouvernement, s’opposant au piétisme et soutenant principalement les candidatures du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB, droite) et d’autres partis similaires. Pourquoi ce changement de position ? L’une des causes de fond est la suivante : l’un des effets collatéraux de la crise de 2008 a été la disparition des possibilités offertes par les affaires internationales, qui a poussé la classe capitaliste brésilienne à revenir à son fonctionnement normal consistant à surexploiter la classe ouvrière et à livrer les ressources nationales à des intérêts étrangers. C’était incompatible avec la présence du PT à la tête du gouvernement d’État.
c. Notamment en 2015, la gauche brésilienne a perdu le soutien d’une partie importante de la classe ouvrière, recevant plutôt son indifférence. Le tournant s’est produit vers la fin 2014-début 2015 quand la présidente Dilma Rousseff a mis en place un projet d’ajustement fiscal occasionnant des dégâts matériels immédiats pour la classe ouvrière.
Dans les élections présidentielles de 2006, 2010 et 2014, la gauche brésilienne avait réussi à affronter et à vaincre l’alliance entre les classes moyennes et le grand capital. Cela n’a pas été possible en 2015-2016 essentiellement en raison de la perte du soutien de la majorité de la classe ouvrière.
La classe dominante et ses alliés étaient impliqués dans le coup d’État parlementaire, médiatique et judiciaire de 2016, qui visait les objectifs suivants :
a. Réduire les salaires et les cotisations sociales, ainsi que supprimer des libertés démocratiques de la classe ouvrière.
b. Aligner notre politique extérieure sur celle des États-Unis et leurs alliés.
c. Rétablir la position de la gauche brésilienne en tant que force minoritaire ou équipe de soutien d’une partie de la classe capitaliste contre l’autre, comme avant 1980, rendant toute alternative de gauche au gouvernement et toute transformation en alternative de pouvoir impossible.
Depuis le coup d’État de 2016, plusieurs mesures ont été prises pour mettre en œuvre ces objectifs, parmi lesquels la réforme du Code du travail, qui supprime les droits de la classe ouvrière ; la révision de la politique nationale pétrolière, afin de servir les intérêts des multinationales de ce secteur.
Pour réussir ces objectifs à moyen terme, les putschistes doivent remporter les élections qui auront lieu en octobre 2018.
Dans les premiers mois de 2016, le coup d’État a obtenu un certain succès et un soutien populaire, constaté non seulement sur la base de sondages d’opinion, mais aussi sur les résultats obtenus par les partis putschistes aux élections municipales. Cependant, aujourd’hui la popularité du gouvernement putschiste est anémique, contaminant la plupart des candidatures présidentielles liées au coup d’État.
En ce moment il y a 13 candidatures à la présidence de la République. De ce nombre, quatre demandes ont été formulées par les partis qui se sont opposés au coup d’État de 2016. Les autres 9 précandidatures ont été lancées par les partis qui ont soutenu le coup d’État de 2016.
Jusqu’à présent, le capitaine Jair Bolsonaro – défenseur de positions d’extrême droite – est le seul candidat putschiste qui révèle un stock suffisant de voix pour passer au deuxième tour.
Lula était en tête de tous les candidats dans tous les sondages, avec plus d’intention de vote que tous les autres candidats ensemble mais sa candidature a été bloquée par voie judiciaire le 11 septembre. Fernando Haddad a été désigné à sa place comme candidat du PT avec comme colistière Manuela D’Avila du Parti communiste du Brésil (PCdoB). Depuis cette date, deux évolutions majeures se sont produites. La première est le report en faveur de Haddad des intentions de votes précédemment favorables à Lula. La deuxième évolution est une consolidation des intentions de vote pour Bolsonaro. La tendance actuelle fait envisager un deuxième tour entre Bolsonaro et Haddad, dont Haddad sortirait victorieux.
Ce serait une catastrophe pour les putschistes car leur problème, ce n’est pas Lula, c’est le PT et la gauche. Que peuvent-ils faire pour l’empêcher ? En ce qui concerne les alternatives électorales (étant donné qu’une partie d’entre eux n’exclut pas des alternatives non électorales, c’est-à-dire un coup d’État militaire), il existe trois possibilités : a) écarter Bolsonaro du deuxième tour (par quelque conspiration) et mettre en avant un candidat plus acceptable ; b) soutenir Bolsonaro à fond, en négociant des garanties telles que l’autonomie de la Banque centrale et le parlementarisme ; c) effectuer des opérations extraordinaires pour essayer d’empêcher Haddad et le PT d’atteindre le deuxième tour en faisant émerger un candidat « modéré », ce qui semble difficile au vu des sondages actuels.
En outre, actuellement un grand pourcentage d’électeurs n’ont pas encore pris leur décision. Mais il y a des signes qui nous indiquent qu’un bon nombre d’entre eux doit pencher pour les votes blancs, nuls et l’abstention. Les autres doivent se répartir entre les candidatures principales. Par conséquent, la polarisation entre Lula et Bolsonaro peut se maintenir dominante jusqu’à la fin de la campagne électorale.
Ce n’est pas en se rapprochant du centre que la gauche peut réussir à faire barrage à l’extrême droite mais en démasquant le programme socio-économique de Bolsonaro et en mettant en avant son propre programme et les mesures d’urgence qu’elle propose pour gagner au vote Haddad l’électorat populaire.
La profondeur de la crise brésilienne indique deux possibilités : une rupture conservatrice et une rupture populaire.
Les forces putschistes s’orientent vers une rupture conservatrice, dont l’expression extrême serait la dictature. Les actions des putschistes sont déjà à la limite de la légalité, comme l’a démontré un épisode récent où Lula a été maintenu en détention malgré l’octroi de la demande d’habeas corpus ; les aspects démocratiques et sociaux de la Constitution de 1988 ont été supprimés ; les militaires sont déjà convoqués pour prendre des postes et des tâches autrefois réservés aux civils.
Cependant, une rupture conservatrice demanderait une intervention militaire explicite, ce qui jusqu’à présent n’est pas souhaitable pour les dirigeants militaires. À cause des possibles effets collatéraux dans le cadre international et national, le grand capital hésite à toucher à cette question.
D’ailleurs, une rupture populaire demanderait une lutte populaire à croissance exponentielle, associée à une victoire électorale massive de la gauche en 2018, permettant au gouvernement élu d’annuler les mesures adoptées par les putschistes depuis la destitution de la présidente Dilma ; de mettre en place un « plan d’urgence » ; convoquer une Assemblée constituante ; faire débuter un cycle de réformes structurelles. En même temps, il faut réunir des forces pour défaire la réaction des capitalistes et de leurs alliés.
Les conditions pour un tournant dans notre conjoncture ne sont pas encore visibles, mais elles pourraient éventuellement se produire. Ainsi, on estime que la situation politique brésilienne continuera d’être instable en dépit des résultats des élections, en octobre 2018, à la présidence, des gouverneurs des États, du Congrès national, des Chambres de députés des États.
Dans ce contexte, les forces de gauche visent à :
a. Retrouver la capacité de mobilisation et de soutien organisé auprès de la classe ouvrière.
b. Garder la classe ouvrière et la gauche comme pôles protagonistes indépendants, empêchant qu’elles retournent au poste d’équipe de soutien dans la dispute entre deux secteurs de la bourgeoisie, tout en gardant les groupes démocratiques et populaires comme alternatives au gouvernement, cherchant sa conversion en alternative de pouvoir.
De ce point de vue, il paraît important de penser que le futur de 2018 c’est aussi le futur du PT.
Depuis 1989 il y a des secteurs qui ont rompu les liens avec le parti pour construire des alternatives de gauche. Toutes leurs tentatives de supplanter le PT ont finalement échoué. Le PT risque d’être détruit à cause de ses erreurs, combinées aux attaques de la droite. Si cette situation se concrétise, on aura pour des décennies le retour d’une gauche du modèle que l’on avait principalement avant les années 1980 : marginale et subordonnée à un secteur de la classe dominante, sans constituer une alternative de gouvernement ou sans accéder au pouvoir.
Ainsi, la survie et le renforcement du PT sont de l’intérêt de l’ensemble de la gauche. Il y a plusieurs signes indiquant la survie du parti, parmi lesquels le résultat des sondages : le PT est le parti le plus populaire du pays ayant un soutien cinq fois supérieur à celui de son concurrent.
Néanmoins, il y a aussi des indices défavorables. Parmi eux, le principal est la difficulté d’une grande partie du PT de traduire en mesures concrètes le fait que la lutte des classes est passée à un autre niveau, à cause des actions du grand capital.
Désormais, l’ensemble de la gauche devrait surmonter des défis extrêmes comparables à ceux de la période 1990-2002. Parmi eux, élaborer et soutenir un nouveau projet de développement – orienté vers la fin de la dépendance extérieure, des inégalités sociales, de la démocratie oligarchique et impliquant non seulement des réformes structurelles combinées à des politiques publiques, mais aussi avec la lutte directe pour le socialisme.
Ces reformes incluent : la réforme fiscale, la réforme financière, la réforme agraire, la souveraineté énergétique, la constitution de l’État-providence, la garantie et l’élargissement des droits civils, la réforme politique, la démocratisation des médias, la réforme du système juridique et du système de sécurité.
L’ensemble de ces réformes doit se traduire, fusionner et se matérialiser dans un ensemble de politiques publiques. Du coup, la réussite de ces réformes et des politiques publiques dépend du moteur économique du Brésil, principalement en ce qui concerne les points suivants :
a. L’adaptation de la production de biens et services à la demande sociale actuelle et à la croissance de la population tout en tenant en compte ses besoins.
b. L’objectif d’avoir des taux de croissance et de productivité capables d’absorber la masse de chômeurs et de nouveaux entrants sur le marché de travail.
c. La rémunération pécuniaire directe (salaires et pensions) et la rémunération pécuniaire indirecte (l’offre de services publics) permettant aux personnes en activité et en retraite d’avoir une meilleure qualité de vie de façon continue.
d. Une capacité de production qui, au fil du temps, soit analogue aux niveaux des moyens de production des pays les plus développés.
Le Brésil n’est pas condamné pour toujours à être exportateur des produits du secteur primaire et importateur de produits industriels. Pour changer ce cadre, il nous faut un nouveau processus de « substitution d’importations » basé sur l’association de l’élargissement du marché des produits de consommation de masse avec le développement d’un grand marché de biens d’équipement.
Il sera également nécessaire de mettre en place un ensemble d’actions afin d’articuler : a) la dévaluation du real face au dollar ; b) la réduction des taux d’intérêt en adéquation avec l’investissement productif ; c) la taxation du capital spéculatif et d’autres mesures pour garantir la qualité de l’investissement étranger ; d) la taxation des importations ; e) la réduction du service de la dette pour garantir l’extension de la capacité d’investissement de l’État ; f) l’élaboration d’un programme d’investissement public dans les infrastructures.
Il s’agit d’investir lourdement dans le transport collectif en zone urbaine ; dans l’infrastructure urbaine ; dans le transport ferroviaire ; dans les transports par voie navigable ; dans le logement social et tous les services publics qui touchent cette question, notamment l’assainissement .
Ces investissements publics constituent un investissement social, l’extension de l’offre et de la qualité des biens publics tout en ayant comme grand objectif la reconstruction d’une industrie solide et technologiquement avancée.
Ainsi, le but principal de la réindustrialisation n’est pas l’offre des biens de consommation individuelle, mais plutôt l’extension de l’offre et de la qualité des biens d’usage collectifs, comme les navires, les trains, les métros, les autobus, et pas majoritairement en faveur du transport individuel.
Il faut souligner que l’extension de la capacité de consommation de la population étendra aussi le marché de consommation de masse des biens privés. L’ensemble des millions de Brésiliens et Brésiliennes a le droit de consommer plus. Il faut donc associer l’offre des biens de consommation publics à celle des biens privés.
Évidemment, ces mesures se heurtent aux intérêts des oligopoles privés, dont beaucoup sont des entreprises transnationales ayant le contrôle sur les chaînes de productions. Ce sont de grands importateurs et des producteurs de biens de consommation de masse qui ne sont pas intéressés à l’expansion de la production nationale.
Cela veut dire aussi un choc contre les idées préconçues d’une partie de la population, qui confond systématiquement le bien-être avec l’extension de la consommation des biens privés.
Pour réussir ce développement en tenant compte des dimensions qu’on vient de présenter, il nous faut une autre organisation politique et un État fort, capable de concevoir et faire prévaloir les intérêts collectifs sur des intérêts individuels, les intérêts de la majorité de la population sur ceux de la minorité, les intérêts nationaux sur les intérêts internationaux. Un État capable de construire un secteur financier national qui atteigne l’objectif d’être 100 % public, conjugué à un grand nombre de banques des États, municipalités, et aussi des banques privées et/ou coopératives. Une telle dynamique ne sera pas le résultat de la « libre concurrence » entre les entreprises privées ou du « libre marché » international, surtout dans la conjoncture mondiale.
Bref, c’est à la gauche de développer au niveau pratique et théorique une alternative d’avenir visant à affronter et surmonter les trois grandes caractéristiques de la trajectoire du pays.
Il nous faut une tentative dont le résultat soit un pays souverain au plan national, avec la démocratie politique, l’égalité sociale et le développement durable.
Il nous faut un projet de développement intégrant les divers aspects de la société brésilienne tout en s’orientant vers la construction d’un pays où l’ensemble de la classe ouvrière obtient un niveau élevé de vie matérielle, culturelle et politique. Les conditions historiques effectives du Brésil indiquent que pour atteindre ces objectifs il faut une organisation économiquement, socialement et politiquement socialiste.
La quête de ces objectifs aura plus de chances de réussite si cette organisation est mise en place de façon intégrée avec les autres pays de l’Amérique latine et les Caraïbes, tout en conservant un certain degré de coopération entre les pays des BRICS.
L’Amérique latine et les Caraïbes ont été victimes au cours des années 1960 et 90 des gouvernements dictatoriaux et néolibéraux. Depuis 1998 un cycle de gouvernements progressistes à gauche a été enclenché. Malgré leurs faiblesses et différences, ce changement a présenté des résultats positifs : expansion du bien-être social et de l’égalité sociale, des libertés démocratiques, de la souveraineté nationale et de l’intégration régionale.
C’est depuis la crise de 2008 et à cause de ses effets, de l’action du gouvernement des États-Unis, de l’opposition de la droite, ajoutée aux erreurs et contraintes des expériences « progressistes de gauche », que s’et engagé ce cycle d’attaques réactionnaires. Ils ont vaincu les gouvernements progressistes de gauche de la région ou les ont mis en garde, ainsi que les forces sociales et partisanes liées aux ouvriers.
Jusqu’à la crise internationale de 2008 les gouvernements progressistes à gauche ont réussi à gérer leurs limites, contradictions et fautes. Cependant, depuis la crise de 2008, la dégradation des prix des produits de base, la dépendance financière et commerciale, la force des oligopoles – surtout étrangers – et la faiblesse de l’État rendent la situation très difficile. En outre, un ensemble de problèmes accumulés s’est aggravé, soit le rejet, la limitation du plan d’action politique, des politiques d’intégration trop timides, les politiques macro-économiques privilégiant l’agro-exportation et le secteur financier, etc.
Le retour de la droite aux gouvernements a donné lieu à des revers en matière sociale, économique et politique, comme des revers dans la politique étrangère, soumise à nouveau aux intérêts des États-Unis.
Le fait que plusieurs gouvernements progressistes existent et se soutiennent mutuellement a été un élément important pour avancer collectivement. L’offensive réactionnaire s’oriente en sens inverse.
Aujourd’hui, les classes ouvrières de la région sont appelées à arrêter les attaques réactionnaires, à récupérer les espaces qu’on occupait autrefois, à assurer de nouvelles victoires, à créer des conditions pour redonner la prépondérance à l’Union des nations sud-américaines (UNASUL) et à la Communauté d’États latino-américains et caraïbes sur la scène internationale, tout en visant la paix, un nouvel ordre économique et une nouvelle politique internationale.
Face à une nouvelle situation, la gauche est appelée à créer une nouvelle stratégie. L’une de ses composantes, aujourd’hui comme hier, demeure l’intégration de l’Amérique latine et des Caraïbes.
Dans ce contexte d’hégémonie capitaliste, de crise du capitalisme, de développement des contradictions intercapitalistes, de conflits des États-Unis contre les BRICS, d’instabilité, de crise et de la croissante menace de guerre, l’alternative est de construire un fort mouvement international ancré dans les classes ouvrières et dans les secteurs populaires, non seulement pour faire de la résistance, mais aussi pour rallier d’autres gouvernements, réorientant ainsi l’économie et la politique vers un monde socialiste. zzz
* Responsable des relations internationales du Parti des travailleurs.
Par Durand Denis , le 30 June 2018
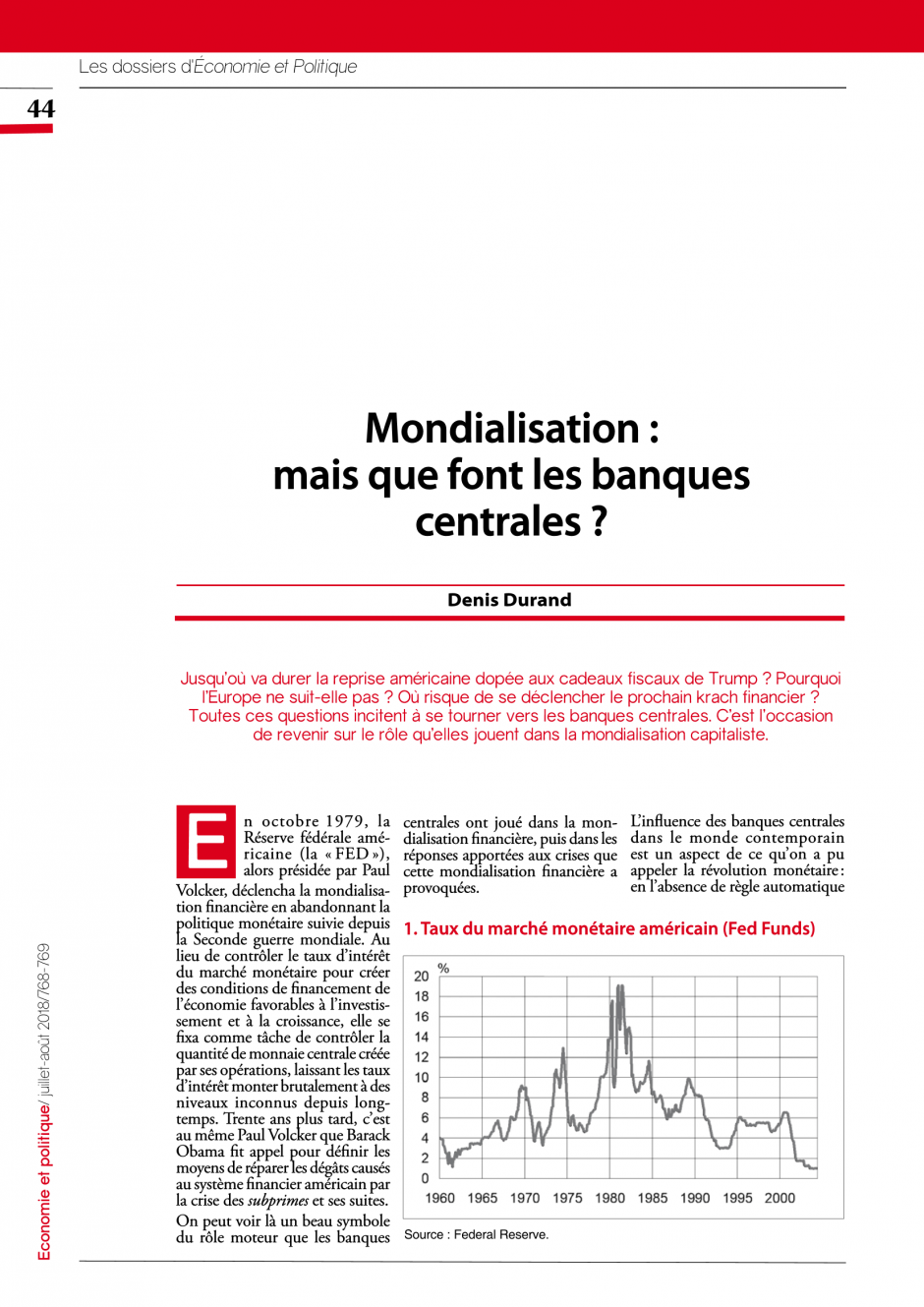
En octobre 1979, la Réserve fédérale américaine (la « FED »), alors présidée par Paul Volcker, déclencha la mondialisation financière en abandonnant la politique monétaire suivie depuis la Seconde guerre mondiale. Au lieu de contrôler le taux d’intérêt du marché monétaire pour créer des conditions de financement de l’économie favorables à l’investissement et à la croissance, elle se fixa comme tâche de contrôler la quantité de monnaie centrale créée par ses opérations, laissant les taux d’intérêt monter brutalement à des niveaux inconnus depuis longtemps. Trente ans plus tard, c’est au même Paul Volcker que Barack Obama fit appel pour définir les moyens de réparer les dégâts causés au système financier américain par la crise des subprimes et ses suites.
On peut voir là un beau symbole du rôle moteur que les banques centrales ont joué dans la mondialisation financière, puis dans les réponses apportées aux crises que cette mondialisation financière a provoquées.
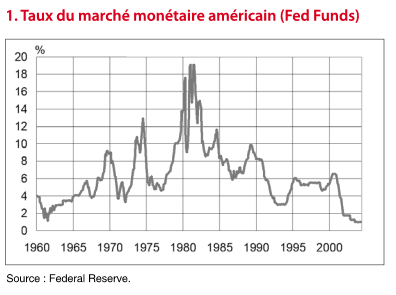
L’influence des banques centrales dans le monde contemporain est un aspect de ce qu’on a pu appeler la révolution monétaire : en l’absence de règle automatique destinée à justifier la confiance dans la monnaie par sa convertibilité en or (règle abandonnée depuis la Première guerre mondiale) ou dans une monnaie, le dollar, elle-même convertible en or (base du système de Bretton Woods jusqu’à la fin de la convertibilité du dollar en 1971), toute l’économie repose sur la capacité des banques centrales à persuader en permanence le public – et les marchés – que la monnaie émise par les banques correspond bien à la création de richesses réelles par le travail humain.
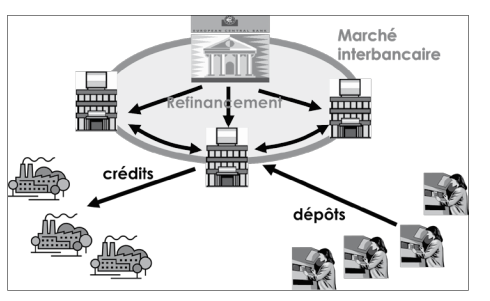
Les moyens dont elles disposent pour cela sont très puissants puisque les banques ordinaires ne peuvent exercer leur activité que si elles disposent de réserves déposées sur leur compte auprès de leur banque centrale (c’est ce qu’on appelle la monnaie centrale). La principale source de réserves sont les prêts que les banques centrales leur accordent pour refinancer les crédits que les banques accordent aux entreprises, aux collectivités publiques et aux États. Les banques centrales ont donc le pouvoir de fixer les conditions auxquelles elles prêtent ces réserves aux banques ordinaires (par exemple les taux d’intérêt, dits « taux directeurs » dont sont assortis ces prêts).
Elles peuvent aussi refuser de prêter à une banque en manque de réserves. Dans ce cas, elles provoquent sa disparition immédiate : c’est le sort que la Réserve fédérale américaine a infligé le 25 septembre 2008, avec l’assentiment du Trésor américain, à l’une des grandes institutions de Wall Street, Lehman Brothers.
Or, l’inflation financière que les banques centrales ont elles-mêmes déclenchée il y a quarante ans mine la capacité de création de richesses dans l’économie mondiale, ce qui rend plus fragile la confiance dans la monnaie et rend la tâche des banques centrales de plus en plus difficile.
Le « coup d’État monétaire » d’octobre 1979, au moment où des gouvernements inspirés des préceptes néolibéraux prenaient le pouvoir, avec Margaret Thatcher, en Grande-Bretagne et s’apprêtaient à le faire avec Ronald Reagan aux États-Unis, a été immédiatement compris comme une mise en œuvre des théories « monétaristes » de Milton Friedman, recommandant de tenir sous contrôle la quantité de monnaie en circulation et de laisser le marché assurer l’équilibre entre l’épargne et l’investissement. Plus profondément, ce tournant dans la politique monétaire a fait entrer l’économie américaine, et avec elle l’économie mondiale, dans un régime de fonctionnement tout à fait nouveau1. C’est ce que montre le graphique 2.
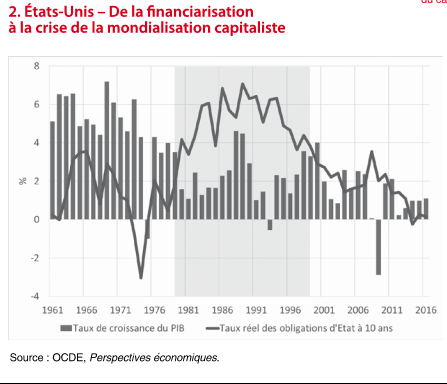
Jusqu’en 1979, le rendement « réel », c’est-à-dire corrigé de l’inflation, des emprunts d’État américains, qui guide le coût du crédit à l’investissement dans le pays, est constamment resté inférieur au taux de croissance de l’économie. Il a même été négatif (la hausse des prix étant supérieure au taux d’intérêt) pendant la récession de 1974-1975. En revanche, au cours des 17 années qui ont suivi (zone en grisé sur le graphique 2), il lui a constamment été supérieur. Cela signifie que la richesse des détenteurs de titres financiers s’est accrue plus vite, chaque année, que la valeur ajoutée créée par le travail des habitants du territoire américain. Les financiers ont pu en profiter pour développer leur activité et les innombrables innovations (marchés à terme, options, swaps et toutes les combinaisons imaginables de ces techniques) qui ont facilité les opérations spéculatives. Mais cela signifie aussi que ce prélèvement croissant de la finance sur la valeur ajoutée s’est fait au détriment des entreprises et, plus précisément, de leurs salariés. Il n’a été possible que parce que les gestions d’entreprises ont été, plus directement et plus brutalement qu’auparavant, dictées par l’obsession de rentabiliser le capital (les actionnaires et les créanciers : banques, fonds de placement, fonds de pension, compagnies d’assurances…) et de baisser, pour y parvenir, le coût du travail. Les choix technologiques, les choix d’investissement et de financement, la gestion du personnel (licenciements, externalisations, précarisation) ont traduit cette obsession, sous le regard permanent des marchés financiers sanctionnant instantanément tout écart par rapport à la norme de rentabilité capitaliste. La gestion des collectivités publiques a obéi aux mêmes impératifs, à la faveur des doctrines néolibérales recommandant la baisse des dépenses publiques et l’austérité budgétaire.
Le graphique 2 montre qu’à partir de 1997 le taux d’intérêt réel cesse d’être systématiquement supérieur au taux de croissance car ce régime est devenu intenable en raison de l’instabilité financière qu’il provoque (krach boursier de 1987, « krach obligataire » de 1994). En décembre 1996, le successeur de Paul Volcker à la FED, Alan Greenspan, a beau dénoncer l’« exubérance irrationnelle » des marchés financiers, il n’a plus les moyens de réprimer cette exubérance. Il faudrait en effet rendre plus cher l’accès des spéculateurs au crédit bancaire mais il ne peut plus se le permettre : le risque de provoquer un krach serait trop grand.
Un gros effort est néanmoins tenté, à l’échelle internationale et à l’initiative des autorités monétaires britanniques et américaines, pour discipliner l’action des banques par d’autres moyens que le seul usage des taux de marchés. La réglementation internationale dit de Bâle I est adoptée en 1988 à l’issue de longues négociations motivées par les frayeurs consécutives à la faillite de la banque Herstatt en 1974. Entrée en vigueur à partir de 1992, elle se révèle vite insuffisante et fait place à des réglementations (Bâle II puis Bâle III) rendues plus restrictives au lendemain des crises financières… puis affaiblies par le lobbying des financiers dès que l’appât de nouveaux gains fait oublier les craintes de la veille. La bride sur le cou laissée aux financiers qui entourent Donald Trump pour défaire les restrictions mises en place par son prédécesseur (et par Paul Volcker) est une nouvelle manifestation de l’« aveuglement au désastre » qui frappe symptomatiquement les financiers, mais aussi les meilleurs économistes, en période d’euphorie financière.
Plus fondamentalement, on voit mal comment ces règles dites de solvabilité pourraient dissuader les banques de prendre des risques inconsidérés puisqu’elles sont fondées sur une norme de rentabilité (l’accroissement des fonds propres des banques) qui ne peut être respectée que par la prise de risques supplémentaires…
De fait, des krachs se produisent bel et bien, et celui de 2007-2008 a placé le système financier occidental au bord de l’effondrement. Depuis la « grande récession » qui l’a suivie, les taux d’intérêt réels sont systématiquement inférieurs au taux de croissance et la FED manifeste une extrême prudence dans le processus de remontée des taux d’intérêt qu’elle a amorcé depuis deux ans et demi. Elle se souvient que c’est la crainte d’un petit durcissement des politiques monétaires des deux côtés de l’Atlantique qui a semé la panique sur les marchés, en août 2007, et déclenché la crise dite des subprimes.
Significativement, la Banque centrale européenne, quant à elle, ne peut même pas se permettre d’amorcer une hausse des taux d’intérêt aujourd’hui, alors qu’elle avait dû suivre la FED dans leur réduction dès 2008, puis dans l’adoption de politiques monétaires « non conventionnelles », sur lesquelles nous allons revenir. Un aspect important de la mondialisation financière est en effet qu’elle a réaffirmé la hiérarchie des monnaies, et donc la dépendance des politiques monétaires du monde entier vis-à-vis de la monnaie de l’impérialisme le plus puissant, le dollar.
En octobre 1979, une multitude de facteurs économiques, financiers, politiques menaçaient d’ébranler la confiance dans la monnaie américaine et le cours du dollar contre les monnaies rivales (yen, deutsche Mark) était au plus bas. Il remonte en flèche avec la remontée des taux aux États-Unis, jusqu’à ce que les accords du Plaza, en 1985, et du Louvre, en 1987, prennent acte du retour incontesté de l’« exorbitant privilège » qui permet aux États-Unis de s’endetter dans leur propre monnaie, et d’user de ce pouvoir au mieux des intérêts des groupes capitalistes américains et de Wall Street. Cela alors même que les autorités américaines ne peuvent plus se prévaloir d’une convertibilité du dollar en or, comme c’était le cas jusqu’en août 1971.
Le projet de monnaie unique européenne exprime une velléité de rivaliser avec la finance américaine dans le cadre de l’hégémonie du dollar et de la domination des marchés financiers.
La révolution financière américaine s’est en effet répandue dans tous les pays développés, sous le puissant effet de l’attrait exercé par Wall Street sur les capitaux en provenance du monde entier. En France, comme aux États-Unis, les taux d’intérêt réels deviennent durablement supérieurs au taux de croissance de l’économie à partir de 1980, jusqu’à l’époque de plus en plus troublée qui commence le xxie siècle.
Comme dans l’ensemble des pays développés, ce régime de croissance a pour condition des gestions d’entreprises visant à faire baisser la part des salaires dans la valeur ajoutée. Le phénomène, et sa corrélation avec la financiarisation, est particulièrement net en France.
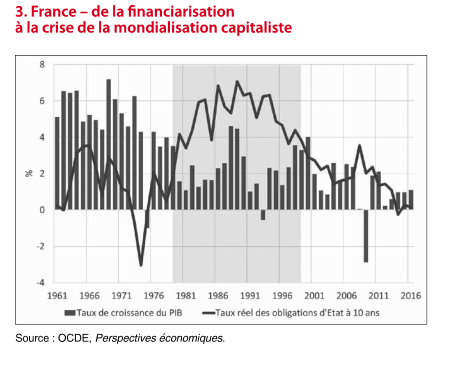
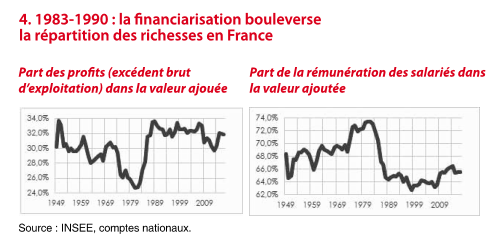
C’est par cet enchaînement que la mondialisation capitaliste, loin de constituer une « bulle » déconnectée de l’économie réelle, a imposé le pouvoir des marchés financiers à toutes les décisions portant sur l’utilisation de l’argent dans les entreprises et dans les États, et a modifié par-là les conditions d’emploi, la répartition des revenus, affectant la vie de tous les habitants de la planète.
Impuissantes à maîtriser les divagations de la finance qu’elles avaient elles-mêmes déchaînées par leurs politiques monétaristes, les banques centrales n’ont pas pu empêcher les catastrophes causées par la suraccumulation chronique de capitaux financiers libres de se déplacer instantanément d’un point à l’autre de la planète. Lorsque ces catastrophes se sont produites, elles ont été contraintes de revoir leur doctrine et de recourir à des moyens d’action auxquels elles répugnaient pourtant profondément.
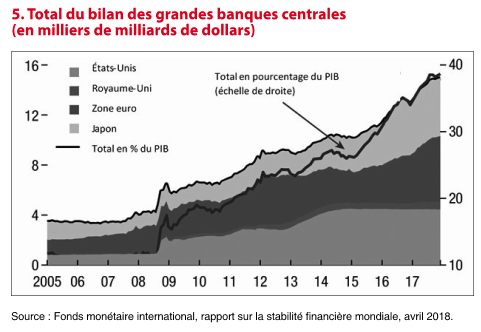
La première à se trouver dans cette situation a été la Banque du Japon. Par son dynamisme industriel, son avance technologique, et par la taille de ses banques, le Japon semblait, dans les années quatre-vingt, en mesure de rivaliser avec succès avec la puissance américaine. Il était aussi le siège d’une spéculation financière et immobilière effrénée. Placée sous la pression américaine (les accords de Bâle I sont très défavorables aux banques japonaises), la Banque du Japon crut possible, en 1990, de maîtriser la spéculation en durcissant sa politique monétaire. Le résultat fut non seulement de provoquer un krach retentissant mais surtout de briser pour les trente ans qui ont suivi l’élan de la croissance japonaise. Confrontée à une tendance durable à la déflation (spirale destructrice de baisse des prix et de la demande), la Banque du Japon a été contrainte dès 1999 de ramener ses taux d’intérêt à zéro, puis de mener une politique de quantitative easing (création de monnaie centrale sous forme d’achats massifs de titres publics et privés pour maintenir le plus haut possible leurs cours sur le marché financier). Cette politique, dans le contexte particulier de l’économie japonaise (taux d’épargne très élevé, excédent commercial structurel) lui permet de supporter – jusqu’à quand ? – un endettement public de 253 % du PIB mais elle est devenue une des moins dynamiques du monde.
C’est à partir de la crise des subprimes, en 2007, que les grandes banques centrales occidentales se sont trouvées contraintes d’adopter des politiques analogues, dites « non conventionnelles ». À côté de l’intervention directe des gouvernements (plans de relance, nationalisation partielle ou totale de banques en difficultés, comme en Grande-Bretagne), l’action des banques centrales a pris une intensité extraordinaire pour sauver le système financier d’un effondrement systémique. L’obligation d’agir avait pour partie une cause technique. Après la faillite de Lehman en septembre 2008, les grandes banques refusaient de se prêter entre elles, paralysant le marché interbancaire. Or ce marché remplit une fonction vitale pour les banques : assurer pour chacune d’elle, à chaque instant, l’équilibre de ses créances et de ses dettes. Les banques centrales ont donc été contraintes de se substituer au marché pour remplir cette fonction : elles ont dû prêter massivement aux banques en déficit temporaire de trésorerie, tandis que celles qui étaient en excédent conservaient leurs avoirs en comptes auprès de la banque centrale. Sans cette énorme création monétaire, les banques se seraient retrouvées les unes après les autres en cessation de paiement.
Les banques centrales sont allées plus loin. Non seulement ces prêts au secteur bancaire ont été assortis de taux d’intérêts de plus en plus faibles mais lorsque ceux-ci sont descendus à 0 % voire en-dessous, les banques centrales ont continué d’injecter de la monnaie centrale sur les marchés, cette fois-ci en achetant directement des titres (obligations publiques, privées, titres du marché monétaire, voire actions). En inondant les marchés de ces liquidités, elles espéraient faciliter la reprise après la « grande récession » de 2008-2009. C’est ce qu’on a appelé l’« assouplissement quantitatif » (quantitative easing) de la politique monétaire2.
Au total, les grandes banques centrales du monde ont quadruplé la taille de leur bilan depuis 2005.
Dans le cas de la Banque centrale européenne – ou, plus exactement, de l’Eurosystème, constitué de la BCE et des banques centrales nationales de la zone euro, comme la Banque de France – l’augmentation de la taille de son bilan a pris deux formes : l’achat de titres sur le marché financier et la mise en place d’opérations de refinancement à long terme (voir graphique 6).
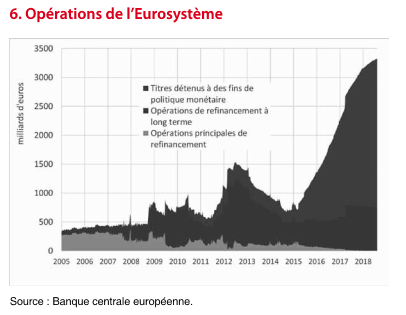
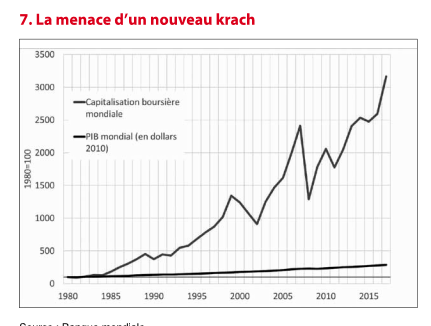
Les opérations de refinancement à long terme ont fini par remplacer entièrement, dans le bilan de l’Eurosystème, les opérations principales de refinancement hebdomadaires (qui représentaient l’essentiel de l’activité de la BCE jusqu’en 2008). Il s’agit de prêts accordés aux banques à une échéance de quatre ans (au lieu d’une semaine) et assortis d’un taux d’intérêt nul, qui peuvent même être négatifs (jusqu’à -0,4 %) pour les banques qui prouvent que leurs crédits financent les entreprises. Il s’agit en effet d’opérations « ciblées » (Targeted Long Term Refinancing Operations). La BCE reconnaît ainsi elle-même qu’en période de suraccumulation financière les refinancements doivent être sélectifs, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas se contenter de laisser le marché déterminer l’affectation des fonds qu’elle met en abondance à la disposition aux financiers. C’est un changement de doctrine majeur par rapport aux conceptions néolibérales et monétaristes qui ont prévalu jusqu’en 2008. Mais de quelle sélectivité doit-il s’agir ? De celle que pratique aujourd’hui la BCE, fondée sur le verdict des agences de notation, c’est-à-dire sur la recherche de la rentabilité financière à l’exclusion de toute autre considération ? Ou d’une nouvelle sélectivité, fondée sur des critères économiques (création de valeur ajoutée dans les territoires), sociaux (emploi, formation, salaires, conditions de travail) et écologiques (économies d’énergies et de matières premières) ? C’est un enjeu politique qui appelle à la prise en compte d’une cohérence portée par les mobilisations sociales.
Les banques centrales, des deux côtés de l’Atlantique, souhaitent vivement tourner la page des politiques monétaires « non conventionnelles ». Elles n’y sont pas seulement portées pour des raisons de principe mais parce qu’elles savent à quoi ont servi les énormes quantités de monnaie centrale qu’elles ont créées depuis dix ans : pour une part essentielle, à gonfler les prix des actifs financiers, alimentant la menace d’une prochaine crise financière.
Le consensus est quasi total chez les économistes comme chez les financiers pour juger qu’une telle crise est inévitable. Nul ne peut prédire où et quand la déflagration se produira mais le graphique 7 – corroborant bien d’autres indices – donne à penser que les masses financières en jeu la rendront encore bien plus violente que celle de 2007. S’attaquer à l’inflation financière est donc peut-être vital pour le système financier mondial, et pour toutes les économies de la planète.
Les données du problème ne sont pas tout à fait les mêmes pour la Réserve fédérale et pour la BCE3. Comme on l’a déjà indiqué, l’hégémonie monétaire américaine donne à la FED une capacité d’action supérieure à celle des autres banques centrales ; mais l’état de l’économie américaine rend une action urgente. La reprise, amorcée dès 2010 aux États-Unis, a déjà inauguré un des cycles les plus longs que l’économie américaine ait connus. La stimulation de la demande orchestrée par Trump (mesures fiscales en faveur des groupes multinationaux et des financiers) a vraisemblablement pour effet de prolonger ce cycle jusqu’à un point où la chute en récession sera particulièrement brutale ; en attendant, cette politique propulse les profits, les dividendes distribués et les cours de Bourse à des hauteurs qui donnent le vertige aux financiers eux-mêmes. Le Conseil de la Réserve fédérale a donc mis en œuvre un resserrement progressif de la politique monétaire. Il a agi sur les deux leviers dont il dispose. À partir de la fin décembre 2015, il a commencé à relever les taux d’intérêt du marché monétaire (graphique 8). Parallèlement, il a mis fin au quantitative easing : les achats de titres par la banque centrale ont été ralentis à partir de décembre 2013, le montant des titres qu’elle détient a cessé d’augmenter à partir d’octobre 2014 et depuis juin 2017 elle laisse décroître ce montant à mesure que les titres qu’elle a en portefeuille viennent en échéance. Le rythme de cette « normalisation » a été suffisamment prudent pour que l’économie américaine puisse le supporter sans dommage apparent. De façon significative, elle n’a été mise en œuvre qu’à partir du moment où la FED a considéré que la situation de l’emploi s’était suffisamment améliorée après la « grande récession » de 2009.
Il n’en a toutefois pas été de même pour les économies qui subissent l’influence de la politique des états-Unis, en particulier les marchés émergents, du Brésil à la Turquie, où les annonces de la FED ont à plusieurs reprises provoqué de sérieuses turbulences.
De son côté, la Banque centrale européenne ne s’est pas senti la force d’emboîter le pas à son homologue américaine. De fait, la reprise économique a été beaucoup plus tardive, beaucoup plus incertaine et beaucoup plus inégalement répartie dans la zone euro que de l’autre côté de l’Atlantique. Non seulement les vicissitudes politiques sont venues aggraver les vulnérabilités de l’économie italienne mais les banques européennes – jusqu’à la Deutsche Bank, clé de voûte du « capitalisme rhénan » – ont donné à plusieurs reprises des signes inquiétants de fragilité. Pour l’instant, la BCE s’est donc contentée de ralentir le rythme d’accroissement de son portefeuille de titres achetés sur le marché, et d’annoncer son intention d’en stabiliser le montant à partir de fin décembre 2018. Elle a indiqué qu’elle n’envisageait pas de remonter ses propres taux directeurs avant l’été 2019.
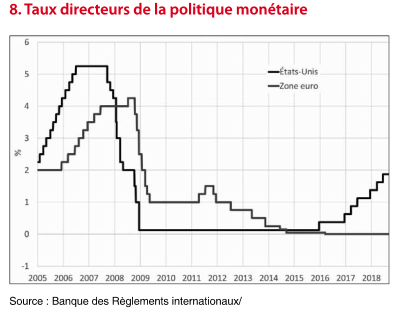
Sortir des dilemmes de la politique monétaire, c’est donc réorienter la création monétaire, et l’utilisation de l’argent ainsi mis en circulation.
Les lecteurs d’Économie et politique connaissent les critères qui devraient guider cette réorientation : le crédit devrait contribuer à l’élévation du potentiel de création de valeur ajoutée disponible pour les populations en favorisant, à cet effet, le développement de l’emploi, de la formation, des services publics.
Les moyens techniques de donner à la création monétaire une sélectivité capable de répondre à ces critères et de priver les marchés financiers de leur alimentation existent : les politiques monétaires « non conventionnelles » en ont fait un usage abondant depuis dix ans, comme on l’a vu dans les paragraphes précédents. On peut agir sur trois leviers au moins :
– une nouvelle sélectivité du refinancement des banques. Le taux pratiqué par la banque centrale serait d’autant plus réduit que les crédits refinancés contribueraient à la réalisation d’investissements répondant à des critères économiques, sociaux et écologiques ; à l’inverse, les opérations financières (achats de titres, spéculations sur les taux de change, LBO…) subiraient des taux prohibitifs ;
– le remplacement du quantitative easing par la création d’un fonds de développement économique, social et écologique européen financé par la BCE pour le développement des services publics, à partir de projets démocratiquement élaborés dans chaque pays de l’Union européenne ;
– de nouvelles normes de réglementation des banques, prenant en compte non le rendement financier de leurs opérations mais leur contribution à la création de valeur ajoutée pour la population : les banques ne peuvent pas être en bonne santé si l’économie va mal ;
– une nouvelle alliance de l'Europe avec les pays émergents pour imposer une alternative à l'hégémonie du dollar. Comme l'a préconisé le gouverneur de la Banque centrale de Chine en avril 2009, rejoignant une proposition faite par Paul Boccara dès 1983, la première étape pourrait être la création d'un nouvel instrument de réserves international à partir des drotis de tirage spéciaux du FMI.
Ce qui manque, c’est la force politique de mobiliser ces moyens au service de nouveaux objectifs sociaux et écologiques. Cette force ne peut venir que de mobilisations sociales et politiques, dans les entreprises et dans les territoires, pour peser sur le choix des investissements privés et publics.
En ce sens, mettre l’accent, pour les prochaines élections européennes, sur des solutions radicales aux dilemmes de la BCE, comme Ian Brossat, chef de file des candidats communistes, a commencé à le faire, est tout autre chose qu’un projet technocratique. C’est une réponse politique à des questions qui sont aux premiers rangs des préoccupations de nos concitoyens.