Par Dimicoli Yves , le 31 May 2018

C’est l’Acte unique européen de 1986 qui, en adoptant la proposition de J. Delors, alors président de la Commission européenne, de réaliser le « marché intérieur européen unique » au plus tard en 1992, qui a vraiment enclenché un processus européen de libéralisation des services publics et sociaux nationaux.
Le choix fait de la « libre concurrence » a été si radical que « à la différence de la plupart des régimes “anti-trust” en vigueur, notamment aux États-Unis, les règles de concurrence concernent non seulement les entreprises mais aussi les autorités publiques »1.
Face au vide juridique dû au fait que n’existait aucune définition commune des services publics2, et qu’il n’en existe toujours pas, la Cour de Justice des communautés européennes a élaboré deux concepts en lieu et place de celui de service public.
Il s’agit d’abord des services d’intérêt général (SIG), marchands et non marchands, que les autorités publiques considèrent comme étant d’intérêt général et soumettent à des obligations de service public ». Le SIG renvoie à la fois au service rendu et au statut de fournisseur de service, et mêle service public administratif et service public industriel et commercial.
Il s’agit, ensuite, des services d’intérêt économique général (SIEG) qui sont des services de nature économique que les États membres ou la Communauté soumettent à des obligations spécifiques en vertu d’un critère d’intérêt général. Cela concerne, pour l’essentiel, les grands services de réseaux (transports, énergie, poste.) qui tous étaient adossés à des entreprises publiques.
C’est en développant progressivement la notion de SIEG que l’UE a prétendu réussir à « concilier » la spécificité des missions de services publics avec les exigences nécessaires à la réalisation du marché unique européen. C’est-à-dire, en pratique, la recherche obsessionnelle de compétitivité par la baisse du « coût du travail » et l’appel, au nom de l’efficacité, à des objectifs et des indicateurs de gestion pilotés par les critères de rentabilité financière.
La notion de SIEG n’a été conçue que comme une exception au droit de la concurrence et aux règles du marché et dans la mesure où la mission particulière de ces services le nécessite.
Dès les années 1990, ils ont été ouverts à la concurrence. Des autorités nationales dites « de régulation sectorielle » ont été chargées de faire disparaître les anciens monopoles publics nationaux au profit de « nouveaux acteurs » dans le cadre de règles propres à ouvrir un marc hé.
Au nom de la modernisation, du progrès d’efficacité et de l’impératif de coopération de services et entreprises publics étatisés, alors circonscrits aux frontières nationales et en crise, une méthode a été mise au point pour tenter de faire se résigner les salariés et les usagers à la déréglementation des SIEG :
– On commence par faire démanteler chaque entreprise publique en situation de monopole en secteurs rentables et non rentables. Les premiers sont filialisés et voués à être tôt ou tard cédés au privé. Les seconds sont appelés à rester dans le giron de la collectivité publique mais au risque de voir s’accentuer ainsi l’inefficacité relative des unités étatisées et, donc, leur charge pour la collectivité.
– Puis, le « régulateur » s’attache à faire perdre de son « pouvoir de marché » à l’ancienne entreprise publique en favorisant systématiquement l’entrée sur son marché domestique de nouveaux acteurs susceptibles de la concurrencer en utilisant, sans avoir eu à les financer, ses infrastructures de réseaux existants.
– Enfin, les autorités concernées s’attachent à ce que « la régulation du marché soit compatible avec l’objectif d’un cadre de gouvernement d’entreprise aussi efficace que possible »3. En bref, il s’agit d’interdire à l’opérateur historique de bénéficier d’aides publiques et il est sommé de recourir, pour sa gestion, à des critères de rentabilité financière.
Le processus général de mise en concurrence des services de réseau comporte deux étapes préalables : la séparation de l’infrastructure et des services associés ; la séparation entre missions de service public et entreprise publique.
La première s’est avérée particulièrement nocive pour les transports ferroviaires4 notamment. En effet, pour que des trains exploités par des entreprises distinctes puissent rouler sur les mêmes lignes, on a séparé la gestion des services ferroviaires de celle de leur infrastructure.
Or, il y a des interactions très fortes entre infrastructures et mobiles (technique, sécurité, efficacité) qui nécessitent de considérer le chemin de fer, insiste P. Mühlstein, comme un « système intégré où réseaux et services sont interdépendants ».
Du coup, la libéralisation de la SNCF a conduit à une extrême multiplication des acteurs, à l’opacité croissante des circuits de décision et à des dysfonctionnements graves liés à l’insuffisant partage des informations, sur fond de pénurie croissante de personnels et de rivalités au sommet entre les différents états-majors.
N’est-il pas plausible de se demander si des catastrophes aussi graves que celle entraînée par l’accident de Brétigny-sur-Orge en 2013 soient liées à cela5 ?
Mais des problèmes analogues ont pu être constatés pour le service public d’électricité et EDF, avec une inflation des « coûts administratifs », que ce soit pour la séparation entre les différentes entités d’EDF ou pour l’adaptation aux règles générales de la concurrence. On a pu notamment relever le coût de duplication des systèmes informatiques, entre EDF, ERDF et RTE, estimé à 84 millions d’euros. Comment, dans ces conditions, s’étonner de la hausse continue de la facture des usagers, de l’ordre de 30 % depuis 2007, alors même que ces processus étaient censés améliorer le rapport qualité/prix du service rendu6 ?
Quant à la séparation entre mission de service public et entreprise publique, elle ouvre la voie, avant même sa privatisation qui finit par tomber comme un fruit mûr, à l’appel aux critères de rentabilité du privé dans la gestion des entreprises publiques. Elle pousse aussi au lancement de politiques fébriles de croissance externe pour faire face à la concurrence des « nouveaux acteurs » venus sur le marché domestique et, en même temps, tenter de prendre des parts de marché aux monopoles historiques nationaux démantelés à l’étranger. Tout cela contribue à une envolée de l’endettement sur les marchés financiers.
Il faudra faire un inventaire complet de ce que ces procédures ont coûté à la collectivité en vies brisées, accidents et fatigue au travail, coûts de remise en état des installations, mauvaise ou sous-utilisation des équipements, abandon d’atouts et de compétences, désertification de territoires, inflation du coût du capital avec la folle croissance externe au lieu de la coopération entre acteurs…
Mais c’est pourtant ainsi que la libéralisation des activités exercées sous monopole public a pu être accompagnée par le maintien formel d’obligations de service public et de garanties prétendues pour les usagers. L’irritation grandissante de ces derniers contre la perte d’efficience de ce qui leur était offert était alors utilisée pour mieux justifier l’avancée dans ces réformes réactionnaires.
C’est ainsi qu’a été pondu le concept de « service universel ». D’origine anglo-saxonne, il est censé fixer l’obligation de service public minimale que doit respecter le secteur public ouvert à la concurrence. On se doute, alors, combien ce « service de base » a vocation à devenir de plus en plus misérable.
Au total, dans la pratique du mouvement de libéralisation au plan européen, tout ce qui ressemble de près ou de loin à du service public est resté étroitement cantonné à une « exception » aux règles du marché, alors qu’il aurait fallu que ses principes deviennent la règle de construction d’une Europe digne d’être qualifiée « de progrès social ».
C’est l’article 16 du traité d’Amsterdam, approuvé en 1997 et mis en œuvre en 1999, qui finit par reconnaître aux SIEG « la place qu’ils occupent parmi les valeurs communes de l’Union » ainsi que le « rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union ».
Mais cette reconnaissance laborieuse, tardive et très formelle n’est intervenue qu’une fois largement engagé la libéralisation et une profonde pénétration concomitante de la culture de rentabilité financière et de recherche prioritaire d’économies sur les moyens humains et la réponse aux besoins populaires. L’affirmation de valeurs sans des critères « ad’hoc » de gestion et des pouvoirs d’intervention décisionnelle et de contrôle des salariés et des usagers dans la gestion « c’est du flan »7 !
Le service public de réseau ainsi coupé de l’entreprise publique ayant, dès lors, vocation à être un jour ou l’autre privatisée, peut alors faire l’objet de concessions à des entreprises privées. Celles-ci n’auront qu’à respecter un cahier des charges rappelant, sur le papier, les missions d’égalité de traitement, d’égalité d’accès et de qualité attendues d’un service public.
Mais ce cahier se transforme rapidement en peau de chagrin face à la double pression de la concurrence et des exigences de rentabilité financière. Simultanément, les compensations financières de type étatique nécessaires aux SIEG sont progressivement rationnées et étroitement surveillées par Bruxelles pour s’assurer qu’elles ne constituent, en aucun cas, une aide d’État.
Au bout du compte, selon l’intensité des luttes, l’entreprise publique s’engage alors dans un processus de privatisation qui, le moment venu, sera défendu par les décideurs au nom des besoins de coopération européenne, de financements nouveaux, de gestion non bureaucratique efficace et d’implication des salariés et des usagers transmutés en clients.
À partir du moment où un large consensus, transmissible entre générations grâce aux grandes écoles rivalisant sur les formations « pro-business », s’est installé chez les élites nationales sur le sort à réserver aux SIEG, la Commission européenne, en dialogue permanent avec les gouvernements successifs, a décidé de progresser dans l’unification des concepts relatifs à tous les services à la personne relevant du public.
C’est ainsi que l’article 2 du protocole n° 26 du traité de Lisbonne8 a mis en avant la notion nouvelle de services non économiques d’intérêt général (SNEIG), précisant que « les dispositions des traités ne portent en aucune manière atteinte à la compétence des États membres pour fournir, faire exécuter et organiser des SNEIG »9.
Ces derniers recouvrent des services sociaux d’intérêt général (SSIG) qui, outre les services de santé, concernent aussi les régimes légaux et complémentaires de sécurité sociale, de même que les autres services rendus directement à la personne et jouant un rôle de prévention.
Ces SNEIG deviennent donc, eux aussi, une exception aux règles de la concurrence sur le marché intérieur des services, lequel a été unifié par le Conseil de l’UE du 24 juillet 2006 et ratifié par le Parlement européen le 15 novembre 2006.
Rien ne permet donc d’affirmer que ce type de services publics échapperait définitivement au mouvement de libéralisation et ne finiraient pas par entrer un jour, si l’on n’y prend garde et en partie du moins, dans la catégorie des services ne devant plus faire exception aux règles du marché. Et, sans doute, de ce point de vue, les immenses plateformes numériques et bases de données que monopolise le GAFAM au plan mondial constituent un nouveau défi considérable, à l’heure du passage aux services publics numérisés10.
Il y a là un défi considérable face auquel aucun pays européen n’est armé et qui exige, d’emblée, de faire émerger à l’échelle de toute l’Europe les infrastructures coopératives de services publics et sociaux, les règles et critères permettant de véritables maîtrises nationales et européennes de l’utilisation des données personnelles et une non-marchandisation des services publics à la personne.
Les gouvernements successifs, libéraux et sociaux-démocrates d’abord, puis hyperlibéraux et sociaux-libéraux, ont été les principaux acteurs de ces évolutions. Ils ont placé, à chaque étape, à la tête des entreprises et services concernés des bureaucrates issus des grands corps de l’État convertis aux règles libérales et, donc, comme après l’implosion de l’URSS les convertis de l’ex-nomenklatura, acharnés à démontrer qu’ils en sont les meilleurs exécutants.
Comme l’a bien souligné Jean Gadrey11, au niveau national et en France en particulier, a été mis en œuvre un protocole pour faire systématiquement reculer les services publics.
Cela commence par un rationnement continu du financement public des services publics. Pour le justifier, on invoque le pacte de stabilité, la dette et les déficits mais aussi la faible croissance et, sur toutes les ondes, on blâme les Français de « vivre au-dessus des moyens de la France ».
Or, le caractère public du financement conditionne dans une large mesure le respect des « obligations » de service public, lesquelles renvoient à des principes fondateurs bien connus : égalité, continuité, adaptabilité et accessibilité.
Ce faisant, les décideurs peuvent apparaître, en alternance et hypocritement, comme ne faisant que respecter des « engagements européens de la France ». En fait, ils s’appuient dessus pour faire résolument reculer, dans chacun de leur pays, la part des prélèvements publics et sociaux sur les richesses produites au profit de celle des prélèvements financiers du capital.
Bien évidemment, dans ces affaires, la BCE demeure à l’abri du pacte de stabilité et de l’engagement forcené des dirigeants politiques pour le faire respecter. Pourtant, son immense capacité de création monétaire, au lieu d’alimenter les marchés financiers, pourrait financer, à taux nuls voire négatifs, les services publics et, notamment, les investissements matériels et immatériels nécessaires pour progresser en efficacité sociale, sous condition chiffrée de création d’emplois et de formations correctement rémunérés.
La dégradation continue de la qualité des services publics et de leur accessibilité sur tous les territoires, malgré les hausses continuelles de tarifs dévorant le pouvoir d’achat des salariés et de leurs familles, n’est pas qu’une conséquence du rationnement financier. Les pouvoirs publics l’ont, en quelque sorte, accompagnée.
Cela a été notamment le cas en France pour le transport ferroviaire de voyageurs en donnant la priorité à la réalisation de lignes TGV le long des sillons reliant les métropoles de haute rentabilité pour les capitaux. Et cela au détriment des réseaux de banlieue, surtout en Île-de-France, et des lignes secondaires en province vouées au délabrement, voire à l’abandon.
Mais cela a été aussi le cas avec la mise en déclin volontaire du fret ferroviaire qui a accompagné la promotion continue du fret routier dont la rentabilité financière, les émissions de CO2 et de nano-particules ainsi que les risques d’accident sont autrement plus élevés.
L’émergence de grands groupes privés de transports routiers a été systématiquement encouragée. Les salariés y sont soumis au dumping social grâce aux règles européennes des « travailleurs détachés ». Le plus gros de ces groupes, et donc le principal concurrent routier de la SNCF, c’est sa filiale privée Geodis.
La loi propulsant les « bus Macron » a renforcé encore cet arsenal, deux ans après la libéralisation du marché du bus. Celle-ci a fait proliférer de nombreuses compagnies à rayon d’action européen entrées en guerre des prix (et en gare) sur le territoire français.
C’est ainsi que la SNCF a créé sa propre filiale « Ouibus » et a intégré Starshipper, consortium de 32 transporteurs routiers français indépendants. Son principal concurrent, Flixbus, a pour actionnaire l’allemand Daimler. Ces deux sociétés ont fait l’objet d’une enquête de l’association « UFC - Que Choisir » révélant que leurs opérations comportaient « une myriade de clauses (qui) apparaissent comme pouvant être qualifiées d’abusives et/ou d’illicites au regard des législations nationales et de l’Union européenne ». Elle en recense « 28 pour Ouibus et 43 pour Flixbus ».
Mais Ouibus est aussi concurrencé par Eurolines, filiale de Transdev (Veolia environnement) et ALSA (Automoviles Luarca SA), filiale espagnole du groupe britannique National Express Group.
N’y-t-il pas dans ces processus d’auto-destruction du public de quoi rappeler un peu ce qui, chez les humains est appelé maladies auto-immunes12 ?
Tout cela finit par engendrer des endettements dont l’ampleur n’est pas aussi préoccupante que la nature des opérations qui l’ont généré. Et on le met sans cesse sous les yeux des usagers en leur jurant que cela nécessite une grande réforme bien réactionnaire de la SNCF ouvrant la voie à une future privatisation… même si les dirigeants font serment qu’il n’en sera jamais question.
Face au goulot d’étranglement du financement des services publics ainsi traités, on a importé en France la pratique britannique des partenariats public-privé (PPP) au nom même de la défense du service public.
Il s’agit d’un mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer un équipement qui assure un service public. Il permet à un État (ou des collectivités territoriales), endetté au-delà des 60 % du PIB requis par Maastricht, de continuer à assumer des investissements et afficher des réalisations en les déléguant au privé. En transférant les investissements lourds nécessaires au secteur privé, c’est ce dernier qui contracte les emprunts pour les financer. Ceux-ci ne viendront donc pas alourdir la dette publique surveillée par Bruxelles.
Mais l’avantage n’est qu’apparent et de court terme, car les loyers que les autorités publiques concernées sont contraintes ensuite de payer pendant des années au partenaire privé fait s’apparenter ce système à un tonneau des Danaïdes pour l’argent public.
La Commission européenne encourage le recours aux PPP, généralement pour la construction de routes ou pour des projets concernant les technologies informationnelles. Cependant, un récent rapport de la Cour des comptes européenne13 relève que « souvent les PPP n’ont pas permis d’obtenir les avantages potentiels en raison des retards, de l’augmentation de leur coût et de leur sous-utilisation »14.
Entre 2000 et 2014, l’UE a dépensé 5,6 milliards d’euros pour 84 projets de PPP dont le coût totalisait 29,2 milliards d’euros. La Cour des comptes souligne que « pour la plupart des projets audités, le calendrier et les limites budgétaires n’ont pas été respectés »15. La Cour critique particulièrement « la répartition des risques entre les partenaires publics et privés […] souvent inappropriée […] tandis que les taux de rémunération élevés (jusqu’à 14 %) du capital-risque du partenaire privé ne reflétaient pas toujours les risques supportés par celui-ci » 16. Au final, elle conseille de « ne pas promouvoir un recours accru et généralisé aux PPP […] »17.
En France, il est significatif que les dirigeants de la SNCF ont eu recours à ce système critiqué pour la construction de la ligne grande vitesse (LGV) Tours-Bordeaux. Sur les 7,8 milliards d’euros qu’a coûté l’investissement, le partenaire privé (le consortium Lisea dont Vinci est le principal actionnaire) n’en a assumé qu’un tiers environ. Or, il va bénéficier de la totalité des recettes moyennant des péages payés par la SNCF pendant les 44 ans que va durer la phase dite d’exploitation du contrat de concession. Les pertes évaluées par la SNCF pourraient atteindre 100 millions d’euros par an. Quant aux actionnaires, ils bénéficieront d’un rendement de quelque 14 % ! Qui défend le « vieux monde » ?…
Les pressions à la libéralisation des services publics dans l’UE ont aussi pour origine les négociations commerciales internationales visant des accords de libre-échange.
La Commission de Bruxelles, très « libre-échangiste », présente d’ailleurs comme un avantage comparatif le fait que l’UE constitue, avec son marché unique et la course-poursuite des États nationaux pour « simplifier » les procédures et flexibiliser les salariés, l’aire commerciale régionale la plus ouverte et la plus libéralisée au monde. Cela, nous dit-on, permettrait aux dirigeants européens de négocier en position de force face aux partenaires commerciaux pour qu’ils déprotègent leur marché domestique.
Cette façon de jouer avec le feu contribue, en pratique, à mettre en exergue ces « exceptions » au marché que sont les SIG dont ils exigent alors la banalisation. Les Anglo-saxons s’en privent d’autant moins qu’il n’existe pas de définition unifiée des services publics dans l’UE en dehors de ce qui relève de la sphère régalienne, ce qui favorise les divisions et les calculs sournois intra-européens.
Les accords de libre-échange visent traditionnellement la réduction des barrières tarifaires entre États afin, prétend-on, de favoriser les échanges commerciaux. Les accords dits « de nouvelle génération » se distinguent par le fait qu’ils ne se contentent pas de diminuer les droits de douane mais ils tentent d’amoindrir toutes les entraves existantes au commerce. Cette réduction des barrières non-tarifaires est d’ailleurs aussi appelée « commerce derrière les frontières »18. et concerne donc également les services, les marchés publics, la protection de la propriété intellectuelle…
C’est ce qui se joue dans les négociations très secrètes en cours de l’accord sur le commerce des services (ACS), plus connu sous son acronyme anglais TISA (pour Trade In Services Agreement) ouvertes en juillet 2013 grâce, notamment, côté français, au vote très majoritaire des députés UMP et PS.
Wikileaks, l’organisation non gouvernementale créée pour donner une large audience aux lanceurs d’alerte, tout en protégeant ses sources, a rendu public sur Internet, le 19 juin 2014, l’annexe du projet d’accord.
Une plus grande restriction du champ des services publics serait envisagée. Tous les services, publics comme privés, seraient soumis aux mêmes règles, car implicitement considérés comme à but lucratif. Ils seraient donc ouverts à la concurrence avec, en corollaire, la pénétration des critères de rentabilité financière dans leur gestion jusqu’à d’éventuelles privatisations. Quant aux entreprises contrôlées par l’État, elles seraient forcées de fonctionner selon les règles, critères de gestion et codes éthiques du privé.
L’Accord économique et commercial global (AEGC), ou CETA (pour Comprehensive Economic and Trade Agreement) est un traité international de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada, signé le 30 octobre 2016, à l’issue de négociations dénoncées comme très opaques. Suite au refus de la Wallonie d’autoriser la Belgique à parapher l’accord, le sommet a été annulé pour, finalement, être signé le 30 octobre 2016.
Le CETA doit réduire la quasi-totalité des barrières d’importations, permettre aux entreprises canadiennes et européennes de participer aux marchés publics, de services et d’investissements de l’autre partenaire. Il prévoit qu’en cas de désaccord avec la politique publique menée par un État, une multinationale peut porter plainte auprès d’un tribunal spécifique, indépendant des juridictions nationales qui pourraient être suspectées de trancher plus souvent en faveur de leur État. Comme cette disposition a été très vivement critiquée, la Commission européenne a été contrainte de donner le change avec de nouvelles dispositions prétendant renforcer l’indépendance, l’impartialité et la transparence de ce système d’arbitrage.
Après son entrée en vigueur provisoire en septembre dernier, le CETA fait toujours l’objet d’une large défiance en France, ce qui a fait repousser sa ratification par le Parlement. Pour l’heure, huit pays européens ont déjà ratifié le CETA : la Croatie, le Danemark, l’Espagne, la Lettonie, Malte, la République tchèque, l’Estonie et le Portugal.
Tout cela rappelle, bien sûr, ce qui s’est tenté avec la négociation d’un accord de partenariat trans-atlantique sur le commerce et l’investissement ou TTIP (pour Transatlantic Trade and Investment Partnership) également appelé TAFTA (pour Trans-Atlantic Free Trade Agreement) négocié depuis 2013 entre l’UE et les états-Unis, visant à créer la plus grande zone de libre-échange du monde. Mais il a rencontré l’opposition de certains pays et une très forte mobilisation citoyenne, tandis que le Brexit est encore venu compliquer la donne.
On voit beaucoup mieux désormais combien prétendre traiter ainsi des enjeux objectifs de coopération intime, de mutualisation des coûts, de partage de toutes les informations au sein de l’Union européenne pour, soi-disant, offrir des services de meilleur qualité aux usagers, en France et à l’échelle de tout l’espace européen, conduit en réalité à son contraire : une guerre économique acharnée entre Européens sur le marché unique, des gâchis inouïs de moyens et de compétences, la domination par de nouveaux monopoles informationnels privés mondiaux à base américaine, l’accroissement du chômage et la double insuffisance grave de formation et de demande. Enfin, et ce n’est pas le moindre, les besoins populaires et la démocratie sont piétinés comme jamais. C’est dire s’il faut faire autrement en prenant appui sur les luttes populaires et l’avancée douloureuse de l’expérience des citoyens, avec des propositions novatrices.
----------------
1. Conseil d’État : « Neuvième conférence : Quelle place pour les services publics dans l’Union ? », Dossier du participant, 07/12/2016, p. 3.
2. La conception à la française des services publics repose, en particulier, sur le préambule de la constitution de 1946, repris dans notre constitution actuelle (1958) qui stipule que « tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité », laquelle ne saurait se réduire à l’État. Mais cette conception n’est aucunement reconnue par le droit européen.
3. Revue économique de l’OCDE- numéro spécial « réforme de la réglementation », n° 312, 2001/1.
4. On pourra se reporter à une note de P. Mühlstein sur « La “libéralisation” ferroviaire pour l’UE et ses conséquences ». 24/03/2018. Il y signale, page 2, que « les systèmes ferroviaires les plus performants au monde sur un plan strictement économique, celui des États-Unis pour le fret et celui du Japon pour les voyageurs, sont certes privatisés mais demeurent intégrés », leurs dirigeants affirmant que « séparer infrastructure et son ouverture forcée à des services en concurrence sont des absurdités techniques et économiques ». Accessible sur le site <http://hussonet.free.fr/spub.htm>.
5. I. du Roy : « Accident de Brétigny – Comment l’exigence de rentabilité a eu raison de la sécurité ferroviaire », Basta !, 3 novembre 2014.
6. J.-L. Tur : « Électricité : un rapport accablant pour les privatisations », Blog Paul Jorion, 30 juillet 2015.
7. Cette expression du xie siècle fait référence à de la fausse monnaie, et par extension à tout mensonge.
8. Conseil d’État, op. cit., p. 6.
9. Protocole n° 26 sur les services d’intérêt général annexé au traité de Lisbonne.
10. L’objectif officiel de la démarche « Action Publique 2022 » est « de simplifier tout ce qui doit l’être et de numériser tout ce qui peut l’être ». Macron a ainsi fixé l’objectif d’offrir aux Français « 100 % de services dématérialisés d’ici 2022 ».
11. J. Gadrey : « Destruction des services publics : asphyxie financière, dégradation de la qualité et dette “insupportable” », 02/03/2018, Blog <alternatives-économiques.fr>.
12. Les maladies auto-immunes résultent d’un dysfonctionnement du système immunitaire qui va alors s’attaquer aux constituants normaux de l’organisme.
13. Cour des comptes européenne : Les partenariats public-privé dans l’UE : de multiples insuffisances et des avantages limités – Rapport spécial n° 09/2018, 20/03/2018, 65p.
14. Ibid., résumé.
15;, Ibid p. 29. Elle a notamment audité 12 PPP cofinancés par l’UE en France, Grèce, Irlande et Espagne pour un coût total de 9,6 milliards d’euros (2,2 milliards cofinancés par l’UE). Elle a pu constater des retards considérables de réalisation allant jusqu’à 52 mois et une forte augmentation des coûts.
16 300 millions d’euros, à la charge du partenaire public, pour des autoroutes espagnoles ; 13 millions d’euros (+73 %) pour le projet TIC Pau-Pyrénées en France ; un retard de quatre ans en moyenne et un surcoût de 1,2 milliards d’euros, à la charge du partenaire public, pour trois autoroutes en Grèce.
17. Ibid., p. 12.
18. Toute l’Europe : « CETA, TAFTA, JEFTA… qu’est-ce qu’un accord de libre-échange “nouvelle génération” » ?, 13.04.2018 .
le 31 May 2018

Louis Armand, résistant, Président de la SNCF de 1955 à 1958, disait : « le chemin de fer sera le moyen de transport du xxie siècle s’il parvient à survivre au xxe siècle. »
Il y a quelques années, on nous enviait encore de par le monde notre chemin de fer incarné depuis 80 ans par la SNCF, pour sa ponctualité, sa sécurité, sa qualité de service, l’entreprise publique avec ses cheminots à statut, ses ingénieurs, en appui d’ALSTOM, constructeur ferroviaire public d’alors, qui lançait pour la re fois au monde un train à Grande Vitesse en service commercial le 27 septembre 1981 entre Paris et Lyon.
La SNCF créée en 1938 après la faillite de compagnies privées a été transformée en EPIC (100 % État), le 1er janvier 1983 sous l’impulsion du ministre communiste des Transports d’alors, Charles Fiterman, faisant adopter la loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI). Celle-ci consacrait, entre autres, le droit au transport pour tous. Dans la foulée, des milliers d’embauches de cheminots à statut ont été réalisées, des lignes de chemins de fer ont été ré-ouvertes, des activités et installations ont été sauvegardées, des militants syndicaux ayant été révoqués pour activités revendicatives ont été réhabilités dans leurs droits, les conditions de travail des cheminots améliorées (augmentation du nombre de repos…).
Aujourd’hui la SNCF est mise en accusation sur la place publique pour une dette colossale de 54 milliards d’euros dont 47 milliards est en définitive une dette de la responsabilité de l’État qui a décidé de la création de lignes à grande vitesse sans les financer !
De plus, la SNCF de par les dysfonctionnements récurrents dont souffrent les usagers au quotidien est considérée comme peu fiable. Ce qui autorise ses détracteurs à proposer la privatisation sans jamais évoquer les dégâts que celle-ci a entraîné sur certains réseaux à l’étranger. Par exemple, en Angleterre, il y a eu 24 accidents entre 1995 et 2005 entraînant 40 morts et plus de 600 blessés et les tarifs ont augmenté de 117 % depuis 1995. Les Britanniques dépensent aujourd’hui 14 % de leur revenu mensuel dans les transports en commun, ce qui les conduit à demander à 76 % la renationalisation complète de leur chemin de fer.
Les attaques contre la SNCF s’ajoutent au dénigrement systématique des cheminots qualifiés de privilégiés dans des termes poujado-libéraux où les inepties le disputent aux contrevérités et autres caricatures.
Après le premier contrat de plan en 1985 entre l’État et la SNCF imposant l’équilibre des comptes par activité, la suppression de milliers d’emplois (41 % en 34 ans !) dont 10 000 pour la seule année 1990, la gestion et le pilotage par activités, accentuée aujourd’hui par axes, par produits, les premières directives européennes de libéralisation, les mobilisations sociales se sont amplifiées !
Sans l’impulsion de la Fédération CGT des cheminots, les trois années qui ont précédé le formidable mouvement social de l’automne 1995 ont vu grandir des grèves et manifestations massives et unitaires.
Le conflit social de 1995 aura permis de mettre en échec la stratégie de Juppé consistant à supprimer les régimes spéciaux de retraite et à jeter dans les poubelles le contrat de plan État-SNCF pour la période 1995-2000 qui devait amputer le réseau ferré national de 6 000 km de lignes et réduire de façon drastique les effectifs de cheminots.
Donc, sous la conjonction des politiques nationales de casse des Services publics et celles dogmatiques de l’Union européenne qui portent comme seul modèle de développement la concurrence tous azimuts, on a procédé en 1997 (loi Pons-Idrac) à la partition de chemin de fer avec la création de RFF (Réseau Ferré de France aujourd’hui SNCF Réseau). La SNCF s’est transformée, s’est remodelée profondément de l’intérieur sous le coup de restructurations empilées au pas de charge sans négociation, qui ont eu pour objet de détruire progressivement l’organisation historique des chemins faite d’intégration, de mutualisation, de transversalité, d’unicité.
Pour exemple, un vendeur d’une gare d’Île-de-France travaillant pour l’activité Transilien ne peut pas vendre de billet de TGV alors que l’outil de travail le permet. Une locomotive dédiée à l’activité Fret ne peut pas assurer la traction d’un train de voyageurs même si c’est la seule disponible. La SNCF préfère supprimer le train ! Chaque service est également devenu client/fournisseur des autres, faisant disparaître la logique de coopération au profit de logiques commerciales et augmentant de fait les frais de transaction.
Alors que le Service public ferroviaire a besoin de souplesse, de réactivité, notamment en cas d’aléas, ce fonctionnement rigidifié, cette balkanisation de l’organisation interne affectent grandement la qualité de service rendu aux usagers.
Ce ne sont ni les cheminots, ni leurs syndicats qui sont responsables de cet état de fait, mais bien la Direction de la SNCF, son DG G. Pepy en tête, et aussi l’actuelle ministre des Transports Elisabeth Borne qui a été directrice de la stratégie à la SNCF de 2002 à 2007.
Cette logique où les branches, les activités, les services deviennent autonomes et s’opposent entre eux, a affaibli considérablement l’efficacité organisationnelle du système qui a été en plus éclaté en 3 EPIC par la réforme de 2014 !
Rappelons que cette réforme, à l’aune de ce qui se joue aujourd’hui, devait régler les dysfonctionnements du système, commencer à désendetter celui-ci, et l’État devait retrouver son rôle de stratège au détriment de la technocratie dans laquelle les financiers et autres intégristes du libéralisme impriment des stratégies anti-service public.
Rien n’a été fait de tout cela, pire on a induit dans la réforme de 2014 la « règle d’or » imposant à RFF de maîtriser ses investissements afin de contenir la dette !
Cela n’a pas tenu longtemps, puisque l’État a demandé à SNCF-Réseau d’abonder le financement du train CDG Express devant relier sans arrêt Paris Gare de l’Est à l’aéroport de Roissy-CDG, projet dispendieux, ségrégatif et néfaste ! Ce dossier confine d’ailleurs à un scandale d’État qui s’avère être aujourd’hui un outil de la privatisation envisagée des Aéroports de Paris (ADP).
Ainsi SNCF-Réseau s’endette… pour rembourser la dette… imposée par l’État.
Le dernier rapport des comptes Transports de la Nation précise que sur l’ensemble des dépenses liées au transport ferroviaire en 2016, 2,7 milliards d’euros sont allés aux banques et aux compagnies d’assurances, pour l’essentiel en charges financières. C’est presque un tiers de la masse salariale !
Quand la SNCF emprunte 100 euros au titre de la dette, 41 % vont au réseau et 59 % aux secteurs financiers ! C’est donc bien le coût de la finance qui plombe le système ferroviaire et non le coût du statut des cheminots !
On ne pourra pas améliorer, rendre plus robuste, plus fiable le Service public ferroviaire, si on ne règle pas la question de la dette !
L’Allemagne a désendetté dans les années 1990 à deux reprises son chemin de fer. Ce qui fait qu’aujourd’hui, 97 % du réseau ferroviaire allemand est électrifié contre 58 % en France. L’Allemagne finance à hauteur de 60 % les infrastructures ferroviaires contre 40 % en France. Ainsi, l’âge moyen de l’infrastructure du réseau ferroviaire en Allemagne est de 17 ans… alors qu’il est de 32 ans en France ! L’idée centrale a été que la SNCF devait devenir une entreprise comme une autre, or c’est la logique comptable, le business, la profitabilité qui prennent le pas sur l’intérêt général et les missions de Service Public. Les usagers sont devenus des clients, les cheminots des collaborateurs, les trains des produits, les syndicats des « partenaires sociaux ».
Avec les encouragements des représentants de l’État qui siègent dans les Conseils d’administration, l’actuel Président de la SNCF, qui a avoué à la presse anglaise n’avoir jamais aimé le train, a poussé le développement de la route contre le rail par l’intermédiaire du groupe SNCF, fort de 1 200 filiales et sous filiales essentiellement routières ! Rappelons que celui-ci est le premier transporteur routier en France (Calberson, Bourgey Montreuil…) et le 3e en Europe où le dumping social et salarial va… bon train !
Dans le débat actuel autour de la réforme Macron/Philippe/Pepy, on devrait mettre plus en exergue les opérations capitalistiques à risques du Groupe SNCF à l’étranger comme l’achat pour 775 millions d’euros de l’opérateur OHL en Amérique, la gestion déficitaire des transports régionaux de Boston…
Il en est ainsi également de la filiale Ouibus qui a perdu 40 millions d’euros en 2016 et a été recapitalisée avec de l’argent public à hauteur de 175 millions d’euros sur 3 ans. Cette filiale qui vit sous perfusion concurrence les TGV, les trains Corail et les TER !!
On pourrait mettre également sur la table le fait que la sous-traitance augmente (89 millions d’euros en 2009 pour 255 millions d’euros en 2016) et coûte 10 % plus cher que si le travail était effectué par les cheminots, de par les reprises que doivent effectuer ces derniers au regard de nombreuses malfaçons laissées par les prestataires privés !
Le résistant Raymond Aubrac lors d’une rencontre avec des cheminots faisait preuve d’une grande lucidité lorsqu’il leur déclarait : « si je vous comprends bien, la SNCF fut les artères et les veines du pays, mais aujourd’hui les politiques libérales sont en train de tronçonner les membres et le sang se retire ». C’est ce que nous avons appelé la « privatisation vampire. »
Les pratiques managériales en vigueur depuis des années à la SNCF empruntent de plus en plus aux méthodes libérales dans leurs dimensions les plus brutales, infantilisantes et culpabilisantes. Le dialogue social est indigent et n’est conçu que comme un instrument d’accompagnement des stratégies patronales. Les organisations syndicales ne sont considérées que si elles présentent sans renâcler la facture sociale aux cheminots.
Celles et ceux qui ont l’outrecuidance de s’opposer à la pensée unique, à la casse du Service public et de l’exprimer par la grève sont sévèrement réprimés après avoir été caricaturés au point que beaucoup d’observateurs pensent que Macron veut la disparition des syndicats notamment au plan confédéral, ceux que l’on nomme les « corps intermédiaires ».
Les libéraux et leurs affidés veulent casser cette culture de Service public qui solidarise, cimente, nourrit l’esprit de corps pour lequel les cheminots ont le sentiment de participer à une œuvre commune.
Malgré la dureté du contexte socio-économique, politique, médiatique, les cheminots ne lâchent rien et à l’instar des agents de la Fonction publique et du secteur public, ils sont fiers de défendre le bien commun, l’intérêt général !
Dans la foulée du rapport « à charge » de M. Spinetta, Macron et son gouvernement dramatisent à dessein la situation de la SNCF qui imposerait une réforme urgente et fondamentale au moment où la Direction de la SNCF présente des chiffres d’activités et des chiffres d’affaires en progression pour 2017 !
Que cache cet empressement alors que lors de la COP 21, dans la loi de transition énergétique, le plan Hulot et les Assisses gouvernementales de la Mobilité on n’a jamais évoqué l’enjeu du rail public ! ?
Comment expliquer le décalage qui existe entre les discours dithyrambiques à propos de la nécessaire lutte contre le réchauffement climatique où les modes alternatifs à la route (rail, voie navigable…) devraient être privilégiés, et la casse planifiée, de façon méthodique et progressive, du Service public ferroviaire ! ?
Devons-nous rappeler que le train est 15 fois moins polluant qu’une voiture, 12 fois moins qu’un avion sur des trajets longue distance et qu’un train de marchandises de 35 wagons retire 55 camions de 32 tonnes des routes ! ?
Le Premier ministre justifie cette réforme en indiquant que c’est pour entre autres respecter nos engagements européens en matière de libéralisation, donc de transposer en droit français des directives et règlements.
Certes, à part les députés de la GUE-NGL (Gauche unitaire européenne-gauche verte nordique), pratiquement tous les partis ont au Parlement européen voté pour la mise en œuvre du 4e paquet ferroviaire qui parachève un cycle de démantèlement des entreprises historiques de chemin de fer.
Cela dit, la France en tant qu’État membre de l’Union européenne a des marges de manœuvre pour s’opposer à ces politiques. De ce point de vue le règlement européen OSP (obligations de Service public) modifié en 2016 prévoit dans son article 5 paragraphe 4 bis une série d’exceptions quant à l’ouverture à la concurrence des transports régionaux de voyageurs. Il est ainsi précisé que « l’autorité compétente peut décider d’attribuer directement des contrats de Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer » donc sans passer par la mise en concurrence !!
Sur ces bases, M. Spinetta préconise d’ailleurs de n’ouvrir à la concurrence les lignes du réseau transilien qu’à l’horizon… 2039 !
Cette question relève donc bien d’une décision éminemment politique !
En matière de consistance du transport régional de voyageurs, il est bon de rappeler que depuis la mise en œuvre en 2002 de la « régionalisation des TER » (convention d’exploitation pluriannuelle entre les Régions et la SNCF), singulièrement sous l’impulsion des vice-présidents communistes en charge des transports dans les Régions, l’offre s’est accrue de plus de 20 % et la fréquentation de 47 %.
Le matériel roulant a été quasiment entièrement modernisé, des gares ont été rénovées, des ateliers de maintenance construits, des emplois créés et des tarifications sociales innovantes ont été proposées !
Bien sûr, si on arrête la gestion libérale interne de la SNCF et qu’on lui donne ainsi qu’aux Régions les moyens financiers du développement du transport ferroviaire régional, on peut faire encore mieux pour répondre aux besoins croissants des usagers.
Avant de brandir la concurrence comme la solution à tous les problèmes en présence, ses partisans feraient bien de faire un bilan objectif de l’ouverture à la concurrence du transport de marchandises par rail intervenue en 2006 en France !
Que constate-t-on ?
Réduction par deux du volume de marchandises transportées par train.
Aujourd’hui Fret SNCF transporte moins de 10 % (3 % en Île-de-France) de marchandises (23 % pour la Deutsche Bahn en Allemagne), alors qu’en 2000 il en transportait 20,6 % ! 8 000 emplois de cheminots ont été supprimés, depuis 2006 plus de 400 gares de Fret ont été fermées, ainsi que la plupart des grands triages !
Près de 400 locomotives Fret, dont la plupart en bon état de marche, pourrissent dans le triage ferroviaire de Sotteville-Les-Rouen. La SNCF fait acheminer ses propres matériaux (rails, traverses, essieux de wagon…) par une kyrielle de camions suite à la fermeture des structures de proximité (gares, triages…) !! Pire la filialisation de l’activité Fret est sur les rails pour la mettre encore mieux à la disposition des intérêts du privé !
C’est donc un bilan catastrophique et un gâchis économique, industriel, environnemental et social qui augurent d’une certaine façon ce que pourrait être l’ouverture à la concurrence du transport de voyageurs !
Quand le Premier ministre déclare le 26 février dans sa conférence de presse : « ce n’est pas de Paris que l’on décide de l’avenir des petites lignes », il met la poussière sous le tapis car il ne dit pas tout !
Dans son rapport remis début février à la ministre des Transports, Monsieur Duron, au titre du Conseil d’orientation des Infrastructures (COI), propose en quelque sorte de transformer des lignes secondaires, dans les zones peu denses, en « coulées vertes » en pleine campagne ! Quelle bonne idée !!
Monsieur Spinetta lui emboîte le pas et suggère de réfléchir à la fermeture de ces lignes (9 000 km) au prétexte qu’il n’y circule que quelques trains par jour ! Vont-ils proposer de fermer des routes départementales et rurales où ne passent que quelques voitures par jour… qui ne paient d’ailleurs pas l’utilisation et l’entretien des infrastructures routières ! ?
Mais où sont passées les vertus vantées hier du mode ferroviaire : économie d’énergie, peu polluant, aménagement du territoire, sécurité, vitesse, fréquence, quiétude, localisation des gares… ! ?
Les usagers/citoyens/contribuables ont tout intérêt, malgré les contraintes qu’impose le mouvement de grève des cheminots, à s’informer et à être solidaires de ce qui se joue. L’avenir des « lignes secondaires » donc d’aménagement du territoire, de désenclavement des régions est gravement menacé !
Plusieurs de ces lignes sont reprises, pour travaux dans les contrats de plan État-régions (2015-2020), mais SNCF-Réseau indique vouloir réduire sa contribution en lien avec le contrat de performance de 2014 et des Préfets ont fait savoir qu’ils n’engageraient pas les fonds prévus par l’État ! Donc celui-ci va continuer à se désengager !
Et ce n’est pas sur ces lignes que le privé s’il en a la possibilité, va se positionner !
Les Régions déjà fortement impactées par les réductions budgétaires de l’État seront conduites à faire des choix douloureux qui pourraient se traduire par la fermeture de ces lignes secondaires et les remplacer, au moins au début, par des cars de substitution.
Comme les gouvernements précédents, les représentants de l’actuel, la main sur le cœur, des trémolos dans la voix, jurent que la SNCF ne sera jamais privatisée, notamment à cause de la réforme qu’ils portent.
Ils veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes !
à l’instar de ce qui s’est passé pour de grands groupes publics qui ont été libéralisés et privatisés, le fait du changement de statut juridique de la SNCF passant d’EPIC où l’État est propriétaire à une société anonyme à capitaux publics où l’État devient actionnaire, favorisera sans nul doute une privatisation partielle ou totale.
L’argument avancé « d’actions de l’État incessibles » ne résistera pas quand la SNCF sera adossée à un autre groupe privé comme ce fut le cas avec Air-France KLM et GDF-Suez où c’est maintenant le capital privé qui est majoritaire.
Progressivement, l’opinion publique se rend mieux compte que le statut des cheminots présenté comme étant le responsable de tous les maux que rencontrent la SNCF et les usagers, s’avère être un écran de fumée qui a vocation à cacher le fond de la réforme !
Le statut des cheminots qui a beaucoup évolué au cours de l’histoire de la SNCF, de son histoire sociale comporte droits et devoirs. Il est inhérent au service public car il garantit la continuité, l’indépendance, la neutralité des agents vis-à-vis du pouvoir économique et politique. Les cheminots ne travaillent pas pour enrichir leur patron, ni pour verser des dividendes à des actionnaires mais pour permettre au pays de répondre à l’intérêt général, aux besoins sociaux du plus grand nombre en matière de transport.
L’heure est grave ! Si la réforme Macron est mise en œuvre, il en sera à terme fini de la SNCF, et Macron et son gouvernement pousseront les feux d’autres réformes visant à casser les protections et garanties, à précariser le monde du travail, à ubériser la société !
Au regard de ce qui se joue, il n’y a pas d’autres solutions que de contribuer à l’élargissement du rapport de force, sans instrumentalisation du mouvement social mais simplement en travaillant les convergences d’intérêts, les convergences des luttes.
La lutte des cheminots porte un enjeu de société et non la défense de revendications corporatistes !
Le gouvernement et le patronat n’ont d’autres choix que d’ouvrir de véritables négociations en lieu et place d’une stratégie de pourrissement du conflit rythmée par des coups tordus de la direction SNCF et par des pseudo-concertations baptisées à juste titre par les syndicats de « farce », de « mascarade » !
L’unité syndicale qui demeure un élément déterminant pour la suite des événements a permis que soit élaboré une plate-forme revendicative de 8 points et la Fédération CGT des cheminots a remis en février au Premier ministre un document étayé de contre-propositions intitulé « Ensemble pour le Fer ».
C’est sur ces bases là, complétées par les propositions que portent les partis politiques progressistes,que peuvent et doivent s’engager les négociations permettant de sortir par le haut du conflit social et d’assurer un bel avenir pour le Service public ferroviaire et ses serviteurs que sont les cheminotes et les cheminots.
Chacun voit bien que la question du désendettement du système ferroviaire est déterminante pour tracer un avenir prometteur tourné vers l’intérêt général à notre chemin de fer. Le PCF, ses élu. es, ses militant. es, ont toujours été aux côtés des cheminots et de leurs syndicats dans les luttes visant à défendre, développer, promouvoir un Service public ferroviaire de qualité.
C’est encore et plus que jamais vrai dans le combat actuel où les économistes du PCF ont travaillé dans le respect de l’indépendance de chacun avec la Fédération CGT des cheminots à des solutions permettant de libérer la SNCF du coût excessif de la dette qu’elle porte au nom de l’État.
Tout en maintenant son chantage aux efforts de productivité que devront produire les cheminots, l’État a dernièrement annoncé qu’il reprendrait en deux temps 35 milliards de dette.
Celle-ci doit s’accompagner d’une renégociation et d’une conversion en une dette à très long terme et à taux très bas, proche de 0 %, sinon cela reporte la charge sur les contribuables, c’est-à-dire pour l’essentiel, sur les salariés et retraités. La Caisse des dépôts pourrait être chargée de cette opération pour laquelle en tant qu’établissement de crédit, elle peut demander un refinancement à la BCE.
Rappelons qu’en 2008, lors de la crise financière, crise systémique, on a su trouver les outils financiers pour aider le secteur bancaire et les collectivités locales.
S’il y a la volonté politique de mobiliser les institutions financières, cela pourrait ouvrir la voie à la création d’un Fonds de développement économique, social, écologique et solidaire européen qui financerait avec l’argent prêté par la BCE à taux 0, des projets démocratiquement décidés dans chaque État européen pour le développement des Services publics.
À ces questions cruciales de désendettement et de financement des investissements s’ajoute l’exigence de revenir à un système ferroviaire réunifié autour de la SNCF permettant de relever les défis de notre temps en matière de transport, favorisant l’intermodalité.
L’enjeu dans ce cadre de la démocratie citoyenne et sociale se pose avec une grande acuité avec une meilleure représentativité des usagers dans les instances de décisions et l’octroi de droits et pouvoirs nouveaux pour les représentants des salariés afin de peser efficacement sur les stratégies patronales et gouvernementales.
Oui, vraiment, OSONS LE RAIL PUBLIC !
--------------
* Conseiller PCF de Paris, membre du Conseil national du PCF, secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots (2000-2010).
-------------------
le 31 May 2018

Il est de bon ton aujourd’hui de brandir l’étendard de la lutte contre l’évasion fiscale. Tout le monde ou presque y va de son discours plein d’engagements tous plus prometteurs les uns que les autres — « croix de bois, croix de fer, si je mens… »-, à prendre des mesures concrètes et efficaces pour lutter contre l’évasion fiscale. Une évasion fiscale devenue une sorte d’auberge espagnole où se côtoient pêle-mêle fraude fiscale pur sucre et méthodes d’optimisation fiscale qui consistent à tirer la quintessence des textes existants pour échapper à l’impôt. Ainsi après le scandale des Paradise Papers, Pascal Saint-Amans, directeur du centre d’administration fiscale de l’OCDE, dénonçait les pratiques d’évitement fiscal assurant « que les États, conscients de cette situation, allaient bâtir de nouvelles coopérations pour lutter contre celles-ci ». Il reconnaissait volontiers dans le journal Le Monde du 7 novembre 2017 que d’importantes fraudes à la TVA existaient, notamment par un procédé appelé « carroussel » qui consiste à récupérer frauduleusement des crédits de TVA par le biais d’un circuit rapide de cette taxe entre plusieurs pays au sein desquels on retrouve très souvent l’île de Man. Et pour cause cette dernière pratique un taux de TVA zéro. Avec un cynisme rare, ce monsieur n’hésitait pas à déclarer que : « L’île de Man a toujours été en avance en termes de coopération. Mais sa fiscalité zéro peut conduire certains opérateurs à vouloir en abuser. » Du grand art !
Après l’épisode Cahuzac, ministres, Présidents et hauts responsables français et de l’Union européenne ne s’étaient-ils pas dits prêts à renforcer les échanges automatiques d’informations bancaires entre pays. Quelques années plus tard, quelle évolution législative est intervenue ? Les pratiques ont-elles vraiment changé ? à part les déclarations fiscales spontanées de quelques contribuables que cette annonce a suscité, peu de choses ont changé dans le quotidien de l’action des services de contrôle et les échanges d’informations sont toujours aussi difficiles à activer.
Au centre de ces choix éminemment politiques est la question de l’évolution et du devenir du contrôle fiscal. Une mission centrale du ministère des Finances et de ce qui demeure sa principale administration, la Direction générale des finances publiques. Une mission qui justifie à elle seule, l’existence même d’une l’administration fiscale organisée et dotée de moyens d’interventions adaptés. Une mission qui constituait jusqu’à la fusion des administrations des impôts et de la comptabilité publique le cœur de métier du ministère des Finances. Car la mission de contrôle fiscal, pour être efficace dans la lutte contre la fraude, nécessite l’organisation et l’existence en amont et en aval d’un ensemble d’autres tâches et missions allant de la gestion des dossiers des contribuables concernés (entreprises et particuliers à hauts revenus), c’est-à-dire de la connaissance du terrain, à la recherche et à la collecte d’informations jusqu’à leur traitement. Une mission qui doit pouvoir s’exercer sur les lieux même de la production, les entreprises, ou en contact direct avec les contribuables à hauts revenus. Une mission qui suppose des moyens matériels et humains importants en nombre et en niveau de qualification, c’est-à-dire tout le contraire de l’orientation suivie depuis de nombreuses années avec une nette inflexion au cours du quinquennat Sarkozy ; ses successeurs continuant dans le même sens mais en accélérant le rythme des opérations de démantèlement.
Depuis des années la mission de contrôle fiscal des entreprises et des contribuables les plus fortunés, appelé dans le jargon du ministère des Finances le contrôle fiscal externe, est sur la sellette. Jusqu’à l’ère Sarkozy, tout l’art des gouvernements successifs, par la voix des Ministres des Finances et des directeurs généraux successifs, consistait à faire croire que rien ne changeait vraiment et que le contrôle fiscal était à l’abri de tout bouleversement, à la différence des autres services qui ne cessaient de connaître restructurations sur restructurations. Tout était bon pour rassurer les personnels. « Le contrôle fiscal existera toujours, comment pourrait-il en être autrement ? D’ailleurs observez que ces services n’entrent pas dans les opérations de restructuration engagées à l’aune du processus de fusion entre la Direction générale des impôts et la Direction générale de la comptabilité publique. » Tel était le discours officiel. RGPP, MAP se succédaient sans devoir atteindre cette mission.
Ce n’était pas voir que les évolutions profondes imprimées aux autres missions participaient d’une entreprise de sape savamment organisée de ce qui fondait l’existence de la mission de contrôle fiscal externe, particulièrement les services de gestion, de programmation et de recherche. Si des retards ont été pris dans la mise en œuvre de ces restructurations, ils ne sont dus qu’aux actions de résistance des personnels, résistance qui au fil du temps et des départs en mutations et/ou en retraite, a eu de plus en plus de mal à se maintenir au niveau nécessaire même si au contact de la réalité, une nouvelle prise de conscience se construit. Une prise de conscience croissante qui fait d’ailleurs écho à la phase de radicalisation et d’accélération des projets de réorganisation des services du contrôle fiscal externe. Les évolutions suivies depuis la fin des années 1990 comme les projets actuels portés par M. Macron sont, en effet, annonciateurs d’un basculement de cette mission dans une autre dimension. Et cela est devenu trop visible pour que quiconque puisse l’ignorer.
Avant de décrypter les récentes évolutions proposées, nous tenterons de retracer le cheminement des réformes ayant jalonné les années passées. Mais au préalable, une précision de langage. Pour le grand public, parler de contrôle fiscal évoque presque automatiquement la lutte contre la fraude, sous-entendu : le contrôle des milieux d’affaires, des entreprises et des contribuables les plus fortunés. Ce contrôle qui s’effectue au sein des établissements concernés ou en présence du contribuable est connu sous l’appellation de contrôle fiscal externe. La procédure propre aux entreprises s’intitule, VG (vérification générale de comptabilité) et celle concernant les contribuables fortunés, ESFP (examen de la situation fiscale personnelle). Or le contrôle fiscal ne se résume pas au contrôle fiscal externe. On peut même affirmer que le contrôle fiscal externe n’est que l’aboutissement d’un processus d’actions, de recherches et de contrôles mis en œuvre par l’ensemble des services qui gèrent et analysent les dossiers des contribuables et qui recoupent renseignements et informations. Cet ensemble de tâches est appelé dans le milieu professionnel, contrôle sur pièces. Ce travail effectué dans les services de gestion par du personnel sédentaire est à la base même de l’exercice du droit fiscal en France. Il est également le point de départ d’opérations de contrôle plus approfondies, le contrôle fiscal externe, déclenchées en dernier ressort lorsque la prise de connaissance des pièces du dossier ne permet pas de se forger une opinion précise du comportement fiscal d’un contribuable. Rappelons enfin que la vérification des dossiers des contribuables qu’elle soit accomplie par des personnels sédentaires ou mobiles est la contrepartie du système déclaratif, lui-même garantie d’une conception républicaine et démocratique de l’impôt.
Le contrôle fiscal externe a toujours été considéré par les pouvoirs publics comme une vitrine de l’action de l’administration fiscale et de la lutte contre la fraude. Une vitrine que chaque gouvernement s’évertue à lustrer alors que l’étale est de plus en plus vide. Les coups de boutoir répétés n’ont en effet pas laissé indemne cette mission. Au premier rang de sa remise en cause est la baisse importante de ses moyens, principalement de ses moyens humains. En fait, depuis le milieu des années 1990, les effectifs de vérificateurs dédiés au contrôle fiscal externe sont restés constants, soit environ 5 000 agents. Mais cette apparente stabilité cache une véritable diminution. Le passage aux 35 heures s’est effectué sans aucune compensation en créations d’emplois. Les emplois d’assistance dans les services de contrôle ont fondu comme neige au soleil au rythme de plus d’un agent sur deux. S’ajoute à ce tableau l’introduction de la bureautique et de techniques informationnelles très chronophages contrairement aux discours dominants. Au final, le même nombre de vérificateurs dispose de facto de moins de temps pour traiter chaque dossier, alors que l’objectif de rendu total qui leur est demandé individuellement est toujours le même. Cela constitue un premier élément de poids de la fragilisation de la mission de contrôle fiscal externe.
Une seconde étape de la dégradation du contrôle fiscal externe est matérialisée par la perte de substance et la raréfaction des informations contenues dans les dossiers des contribuables. Suite au dégraissage massif des effectifs dans les services de gestion, le travail élémentaire de compilation des informations, de suivi des dossiers et de connaissance du terrain ne peut plus être effectué dans des conditions correctes. La qualité de la programmation des affaires proposées en contrôle fiscal externe en est profondément altérée, ce qui pèse fortement sur l’efficacité et la crédibilité de cette mission. S’y ajoute la disparition quasi complète des dossiers papiers et, avec elle, une importante perte de connaissances de l’historique fiscal, économique et social des entreprises. Une perte qui est loin d’être compensée par les informations contenues dans les banques de données informatiques, avec qui plus est d’énormes problèmes de conservation sur le long terme.
Ces conditions matérielles ont un impact considérable sur le contenu de la mission de contrôle fiscal externe désorganisant le travail des vérificateurs en même temps que les démotivant. Pire encore, l’accroissement de la charge de travail a permis aux technocrates parisiens à l’instar de leurs homologues libéraux de par le monde, de proposer des solutions aux effets totalement pervers. Qu’elles soient de nature informationnelle, en multipliant des applications informatiques visant à encadrer de plus en plus l’action du vérificateur et à soi-disant réduire sa charge de travail, ou qu’elles soient juridiques, en proposant une évolution régressive des procédures pour les services de vérifications et permissive pour les entreprises, toutes les évolutions proposées n’ont eu qu’un résultat : pousser insidieusement, au prétexte de faire mieux en moins de temps, à une accélération des cadences de travail en standardisant les investigations et en incitant à un survol des affaires par la généralisation d’une sorte de méthode par sondage. Pour donner le change, quelques affaires emblématiques sont mises en lumière, et ont fait monter les statistiques de la sphère répressive en pénalisant de manière beaucoup plus forte et systématique qu’avant certains manquements qui ne relèvent pas forcément de la grande fraude.
L’outil informatique, outre qu’il est souvent mal maîtrisé par les personnels car n’ayant été précédé d’aucune formation informatique initiale, revêt une dimension très structurante des modes et méthodes de travail. Pratiquées de façon empirique et conceptualisées sur fond d’hyper centralisation, les techniques informationnelles vident pour une part le travail d’analyse et de conception de son sens. Elles ont tendance à procurer parmi les personnels du contrôle fiscal un sentiment de désappropriation et de désincarnation de leur mission. Ce ressenti, qui reflète d’ailleurs une évolution bien réelle, est renforcé par le fait que l’outil informatique est très souvent utilisé par la hiérarchie comme une sorte de cheval de Troie pour faire passer dans la pratique de radicaux changements d’orientation du travail et de procédure en même temps que de nouveaux modes managériaux.
Les applications proposées travaillent en effet une seule et même logique. Il s’agit d’instaurer dans les services de vérifications une véritable culture de la rentabilité passant d’une obligation de moyens à une obligation de résultats. Et cela se traduit par l’accroissement des rythmes de travail, par une course à la réduction des coûts avec l’obsession de faire baisser la dépense publique en réponse aux objectifs fixés par les traités européens.
Sur fond d’économies et de volonté de réduire la présence de l’administration fiscale dans les entreprises et auprès des détenteurs de grandes fortunes et du capital, ces applications fournissent le prétexte à une transformation fondamentale de la nature même du contrôle fiscal dans notre pays. Il s’agit là encore d’en finir avec une spécificité française dans l’œil du cyclone depuis longtemps, de services de contrôle sur place des entreprises répartis sur l’ensemble du territoire, intervenant à intervalles réguliers et appréhendant l’ensemble des problématiques fiscales, comptables et juridiques ; cela à la différence du modèle anglo-saxon.
Par la normalisation des modes de travail et le recentrage des interventions sur place vers du travail au bureau qu’elles induisent, naturellement sous le label de l’amélioration et de la qualité et de la rapidité des interventions, les nouvelles applications informatiques aboutissent à faire sortir les vérificateurs des entreprises et de chez les contribuables les plus riches pour les sédentariser autour d’un travail de bureau consistant à faire tourner des algorithmes qui devraient trouver la fraude tout seuls. Au-delà, elles engagent une déqualification de la mission de contrôle elle-même. Elles réduisent en effet considérablement le travail de conceptualisation et d’analyse justifiant ainsi le transfert de cette mission vers du personnel d’un moins haut niveau de qualification. Effectivement faire tourner des algorithmes et en transmettre le résultat aux contribuables, c’est à la portée du plus grand nombre et, surtout, cela ne justifie pas un très haut niveau de qualifications, ce qui permet de facto de moins dépenser en coût de personnels. Ainsi sera atteint le double objectif de réduire la dépense publique et d’alléger la présence fiscale auprès des entreprises et des contribuables fortunés. Au-delà encore, cette nouvelle conception de la mission de contrôle fiscal externe peut très rapidement conduire à remplacer du personnel fonctionnaire titulaire par des agents contractuels recrutés à la mission ou à la tâche. Ceux-ci intervenant dans le cadre d’agences hors statut de la Fonction publique, on ferait ainsi sauter l’ensemble des garanties statutaires qui y sont attachées et permettant une réduction importante du nombre de vérificateurs. Enfin, transformer du personnel mobile en personnel sédentaire permet une autre économie, celle du remboursement des frais de déplacements qui sont dans le collimateur depuis plusieurs années. Du pain béni pour le Medef qui ne cesse de demander une réduction du temps de présence des représentants de l’administration fiscale dans les locaux des entreprises et qui veut toujours plus capter d’argent public à son profit. C’était le sens profond du « choc de simplification » mis en œuvre au cours du quinquennat de F. Hollande. Depuis E. Macron s’est engagé à faire mieux [voir l’encadré].
De telles évolutions ne tombent pas du ciel. Leur origine remonte à une réflexion engagée il y a plus de vingt ans. Un rapport comparatif des pratiques du contrôle fiscal externe dans divers pays européens et de l’OCDE a même été publié en décembre 2002 sur cette question. Du nom de son rédacteur, M. Strainchamps, ce rapport qui concluait à une bonne efficacité du contrôle fiscal français par rapport à celui de ses voisins, a vite été rangé au fond des tiroirs. Mais pour autant la piste ouverte n’a pas été refermée. Plus discrète mais tout aussi efficace, elle a pris la forme d’échanges annuels sur la politique fiscale entre divers pays, notamment avec l’Allemagne, modèle économique à suivre s’il en est un, mais aussi avec un pays comme le Canada grand fournisseur d’algorithmes et d’applications censés remplacer le cerveau du vérificateur.
La transposition dans la pratique française de ces échanges d’information s’incarne aujourd’hui dans des projets très avancés portés par les plus hauts responsables du ministère des Finances. Leur objectif est la concentration des services de vérifications de niveau départemental et interrégional en une seule et même structure. Celle-ci accueillerait également les services de recherche et du renseignement, de telle sorte que se créerait une administration du contrôle fiscal externe quasi autonome, coupée de l’ensemble des autres services de la DGFIP. La fusion des niveaux départementaux et interrégionaux s’accompagnerait dans un premier temps de la disparition de la moitié des effectifs de vérificateurs départementaux, processus d’ailleurs déjà engagé dans certains départements (Bouches-du-Rhône, Ardèche…). Si des emplois sont redéployés au plan interrégional, il n’y a pas d’équivalence en nombre et pour l’heure l’essentiel est d’ouvrir la voie. Se profile ainsi pour les services du contrôle fiscal externe une destinée à la mode Domaines. Le service des Domaines, dont la mission est d’évaluer les biens publics et les biens entrant dans les transactions publiques de l’État et des collectivités territoriales, a été sorti du bloc foncier de la Direction générale des impôts au moment de la fusion de cette dernière avec la Direction générale de la comptabilité publique. Il a été créé pour la circonstance, une structure appelée « France Domaines », directement rattachée à l’administration centrale et ainsi structurellement coupée des autres services, notamment des services fonciers et cadastraux. Aujourd’hui « France Domaines » est mise en concurrence avec des services d’évaluation foncière privés, par exemple de la BNP Parisbas, que l’administration rétribue pour effectuer quasiment les mêmes contrôles que ceux réalisés par France Domaine. Actuellement, il ne reste plus que quelques agents des domaines par département rattachés d’ailleurs administrativement à quelques départements référents. En fait, la mission est en voie d’extinction, on attend son avis de décès.
C’est à cette sauce que sont destinés à être mangés les services du contrôle fiscal externe. Une organisation en agence de service public avec à sa tête quelques encadrants relevant du ministère des Finances et des exécutants, contractuels, sous statut privés, missionnés sur quelques opérations à grand retentissement. Tel est un des schémas d’organisation plausible de cette mission, jusqu’à présent non seulement pas démenti mais que confirment chaque jour un peu plus les nouvelles orientations proposées.
Ainsi plusieurs responsables nationaux du contrôle fiscal externe ont clairement annoncé la volonté du gouvernement d’avancer vers la mise en place d’un traitement de masse et sédentaire du contrôle fiscal des entreprises, ce que permettent les nouveaux outils informatiques, mais ce qui pose aussi indirectement la question du devenir du statut des personnels et des missions de ce service.
Si c’est du pain béni pour le Medef, ce nouveau type de relations entre l’administration fiscale et les entreprises réorienterait fondamentalement la pratique du contrôle fiscal externe vers un traitement de masse qui concerne principalement les catégories d’entreprises les moins importantes. Mais une question se pose. Sera-t-il encore longtemps possible d’afficher un rendement budgétaire correct du contrôle fiscal et donc de justifier auprès de la représentation nationale un certain niveau de dépenses de fonctionnement de ce service ? La réponse est sans nul doute NON. Mais alors cela prépare une purge massive des effectifs de ce service.
On assiste dans les faits à une véritable révolution conservatrice de l’exercice de la mission contrôle fiscal externe. Il faut être sérieux, ce n’est pas de la sorte qu’on luttera contre la fraude fiscale. Ce n’est pas de la sorte qu’on assurera une égalité de traitement des entreprises devant l’impôt. Se créent pour les entreprises comme pour les citoyens une fiscalité et un contrôle à deux vitesses. Un contrôle automatisé et régulier pour les petits contribuables comme pour les petites entreprises, et un contrôle aléatoire, très politique et finalement très allégé pour les grandes entreprises comme pour les contribuables relevant de l’ISF ou aux revenus essentiellement non salariaux. Penser aujourd’hui que la fraude fiscale puisse être décelée par une analyse sommaire de la comptabilité, c’est tout simplement prendre les personnels vérificateurs et l’ensemble des citoyens de ce pays pour des idiots. La lutte contre la fraude fiscale des entreprises exige avant tout d’assurer un contrôle et une présence physique de l’administration fiscale dans les locaux de ces dernières, là où peut être mené un certain nombre d’investigations qui vont de l’observation des modes de gestion, des circuits commerciaux et financiers internes à la lecture de documents impossibles de se procurer autrement qu’en étant sur place. Et rappelons-le, ce type de contrôle est pour les entreprises la juste contrepartie du système déclaratif.
La voie choisie pour la mission de contrôle fiscal externe est manifestement tout autre. Pour preuve venant chapoter les évolutions présentées ci-dessus, plusieurs projets en cours.
Il s’agit d’une part, d’une idée déjà ancienne, la généralisation du rescrit fiscal. Présenté sous le thème de la « relation de confiance » cette pratique aboutirait à un contrôle fiscal de nouvelle génération. Au motif, toujours le même d’ailleurs, d’améliorer les relations entre les entreprises et l’administration fiscale, un nouveau type de dialogue fondé sur la transparence, la célérité, la disponibilité réciproque, le pragmatisme, la compréhension et la confiance mutuelle (sic), serait promu.
Le principe est que l’administration fiscale accompagne a priori l’entreprise dans ses obligations déclaratives. Ce nouveau mode de fonctionnement garantirait aux entreprises d’obtenir de l’administration fiscale des réponses aux questions juridiques qu’elles se posent, des déclarations d’impôts validées qui ne seront plus remises en cause lors de contrôles fiscaux et la certitude que les erreurs pourront être corrigées sans pénalités.
Il est assez instructif d’observer que de l’avis même du ministère des Finances, la seule partie à avoir un intérêt dans la mise en œuvre de ce nouveau mode opératoire, est l’entreprise. Cette dernière y trouverait une plus grande liberté, étant la seule à décider de recourir au rescrit, une meilleure sécurité juridique, bénéficiant d’un avis écrit de l’administration sur lequel cette dernière ne pourrait revenir, et d’une plus grande visibilité, l’entreprise étant certaine de ne pas être incommodée par un contrôle fiscal a posteriori.
Voilà les agents chargés du contrôle fiscal des entreprises en passe de devenir des auditeurs et des conseillers permanents de ces dernières. Des sommets pourraient être atteints lorsqu’il s’agira de se prononcer sur des questions touchant directement à des enjeux d’optimisation fiscale. Généraliser le rescrit fiscal comme mode opératoire des relations entre les entreprises et l’administration fiscale, c’est signer l’arrêt de mort de la mission de contrôle fiscal externe. Une décision qui nous ramènerait rapidement à la situation du début des années 1970 au moment où la mission de contrôle fiscal externe a été généralisée. Une mission qui a mis plus de 30 ans pour assainir les comportements fiscaux des entreprises et qui a contribué, certes avec d’importantes insuffisances, à créer un traitement équitable entre contribuables. Un tel projet est en fait taillé sur mesure pour les multinationales afin de leur ouvrir toutes grandes les portes de la France et leur permettre d’y réaliser sans entraves leurs affaires. Voire le contrôle fiscal prêter main forte à une telle logique est un pur contresens. C’est tout simplement rendre une mission de régulation complice d’une phénoménale escroquerie intellectuelle et d’un formidable holdup sur l’ensemble de la société.
Face à cet acharnement à mettre l’ensemble de la structure publique, dont le contrôle fiscal externe à la botte des grands groupes et des marchés financiers, il est urgent de poser les fondements d’une alternative de progrès. La réponse aux besoins sociaux et aux exigences modernes de développement de la société, avec en leur cœur l’expansion des services publics, exige de se donner les moyens pour assurer une nouvelle maîtrise publique et sociale. La mission de contrôle fiscal, et plus particulièrement celle de contrôle fiscal externe, fait partie des outils à mobiliser pour y parvenir.
Mais pour cela, il s’agit évidemment de faire franchir un nouveau cap à ce mode de contrôle. Un nouveau cap qui, en s’appuyant sur ce qu’il y a de positif dans la mission telle qu’elle existe encore (7), intègre la réalité de la société actuelle pour construire les évolutions nécessaires à sa prise en compte. La réaffirmation de certains principes et la mise en débat de quelques propositions nouvelles sont nécessaires pour construire la mission de contrôle fiscal externe de notre temps.
Tout d’abord une remarque. Dans un environnement marqué par la globalisation et la mondialisation capitaliste, il est complètement irresponsable de vouloir faire disparaître les outils de régulation et de contrôle existants. Même s’ils ont besoin d’un sérieux toilettage, leur existence permet de ne pas se retrouver complètement pris au dépourvu face aux logiques ultralibérales.
C’est pourquoi il est prioritaire de réaffirmer que le contrôle fiscal des entreprises et des plus riches contribuables doit être maintenu dans son acception générale. Son existence est la juste contrepartie d’un système déclaratif qu’il ne s’agit pas de remettre en cause, et il répond à un besoin de maîtrise d’une complexité de plus en plus importante du monde des affaires et des règles qui le régissent. Maintenir le contrôle fiscal externe signifie, premièrement, qu’il continue à être organisé autour d’interventions régulières dans les locaux des entreprises quelle que soit leur taille et en vertu d’un principe unique qui consiste à n’en considérer aucune comme un fraudeur d’office invétéré ni également à n’en sanctifier aucune. Cela nous rappelle que le contrôle fiscal externe a d’abord un rôle dissuasif, de par la présence que l’administration assure sur le terrain. En clair, il n’y a pas de grande ou de petite fraude, il y a une fraude qui s’opère à différents niveaux quel que soit le chiffre d’affaires d’une entreprise, une fraude qui doit être traquée avec la même détermination, naturellement en adaptant les moyens face à la taille et à la complexité des affaires.
Deuxièmement, il ne s’agit absolument pas de rejeter l’utilisation des techniques informationnelles dans la recherche de la fraude. Mais ces outils doivent être des aides, des appuis techniques. Leur utilisation doit être adaptable au type de contrôle engagé et d’entreprise ou de contribuable vérifié. Elles ne doivent pas être conçues dans le but premier de faire disparaître des emplois, de « fliquer » les agents, d’encadrer les procédures de contrôles dans des contingences bureaucratiques qui vont jusqu’à faire perdre tout sens à la mission de contrôle fiscal externe.
Troisièmement, il est nécessaire de s’intéresser aux conditions de travail des agents qui interviennent en contrôle fiscal externe. Le premier volet est celui des effectifs et de la situation de l’emploi. Face à l’évolution des procédures, à la croissance du nombre d’entreprises (2 767 774 entreprises imposables à l’impôt sur les sociétés en 2017 contre 1 807 584 en 2012 et 1 644 321 en 2010), à la complexité et à la mondialisation des échanges, à des conseils fiscaux et juridiques de plus en plus aguerris et au besoin d’assurer une plus grande présence de l’administration fiscale sur le terrain, il est essentiel dans un même mouvement, de créer des emplois et d’élever de façon très significative la formation professionnelle initiale et de cours de carrière. S’agissant des créations d’emplois, il convient d’intégrer la nécessité de redévelopper à la fois les effectifs de vérificateurs et ceux d’assistants des vérificateurs. Alors que le point d’indice n’a connu qu’une très faible évolution pour retourner maintenant vers la stagnation, alors qu’aucune véritable reconnaissance des qualifications n’a été observée depuis des lustres, notamment pour les inspecteurs vérificateurs qui ont dû accomplir des efforts considérables d’adaptation face à l’évolution de leurs tâches, le calcul d’une nouvelle grille indiciaire relève de la plus légitime des revendications.
Quatrièmement, il est temps de passer à une nouvelle ère de la démocratie sociale dans les services des administrations financières. Les commissions paritaires doivent disposer de réels pouvoirs quant à l’évaluation des outils et de l’organisation du travail, quant à l’efficience des décisions hiérarchiques et à l’efficacité des missions. Cela revient à instaurer un contrôle direct des personnels sur la gestion de la dépense publique à partir de critères d’efficacité sociale en lieu et place des critères de rentabilité imposés par la LOLF. Sur ce plan, il conviendrait de construire une nouvelle articulation entre missions de contrôle fiscal externe et intervention des salariés dans la gestion de leurs entreprises. Un droit d’alerte nouveau devrait permettre aux membres des Comités d’entreprises d’en appeler à l’intervention de l’administration fiscale pour lancer une procédure de contrôle.
Cinquièmement, la législation, qu’elle soit nationale ou européenne, doit être revue dans un sens permettant de juguler à l’échelle de chaque territoire les pratiques frauduleuses. Au plan national comme dans l’espace européen et mondial, une véritable prise de conscience et un réel effort doivent être consentis en matière de coopérations, d’échanges et de convergences fiscales. Notre représentation nationale doit en finir avec la distribution d’argent public à l’aveugle matérialisée notamment par des allégements de cotisations et d’impôts, avec la multiplication des niches fiscales qui sont dans la plupart des cas d’excellents supports de l’optimisation et de l’évasion fiscales. Vouloir faire remplir par le contrôle fiscal externe une sorte de tonneau des Danaïdes, c’est à plus ou moins brève échéance condamner cette mission à l’échec et à la disparition. Le contrôle fiscal doit être un des outils fiscaux au service d’une politique économique de relance d’une croissance saine et durable s’appuyant sur une production de biens utiles au développement de toutes les capacités humaines.
Sixièmement, la mission de contrôle fiscal externe ne peut être externalisée. Elle doit demeurer étroitement associée, imbriquée à l’ensemble des autres missions de la DGFIP. L’activité de contrôle fiscal externe a partie liée avec l’action de tous les services de la DGFIP. En dépend la qualité de la programmation des affaires à vérifier et donc l’efficacité de la mission de contrôle fiscal externe. Mais en dépend également la cohérence, l’image et l’existence d’administrations financières unifiées sur l’ensemble du territoire national, et ainsi l’assurance d’un égal traitement de chaque citoyen qu’il vive en région parisienne, dans le Nord-Pas-de-Calais, sur la Côte d’Azur ou dans des campagnes reculées.
À l’évidence, les tirades gouvernementales sur le renforcement de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi que des services en charge de la mission de contrôle fiscal externe, par exemple avec la mise en place d’une nouvelle brigade nationale d’intervention, ne sont que des leurres face à l’ampleur de l’entreprise de destruction engagée contre les missions essentielles. De même, les effets de manche sur le contrôle patrimonial ne suffiront plus longtemps à masquer le laxisme renvoyé par la suppression de l’ISF et l’indigence du contrôle des grandes entreprises et des multinationales, particulièrement lorsque ces dernières sont régulièrement arrosées de dizaines de milliards d’euros de deniers publics. Le contrôle fiscal externe comme l’ensemble de la politique fiscale doivent rapidement prendre un autre cap, celui du développement humain contre celui de la finance, celui du progrès social contre le recul de civilisation.
|
« Un État au service d’une société de confiance » Tel est le titre enjôleur d’un projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale au cours de la session 2017/2018 suivi d’une note interne aux services du contrôle fiscal de la Direction Générale des finances publiques. Une première remarque consiste à souligner l’empressement mis par la DGFIP à transcrire dans les pratiques concrètes cette loi alors que celle-ci arrivée devant le Sénat en janvier 2018 est en attente d’une seconde lecture vu les désaccords affichés au sein de la commission mixte paritaire. Tout y est dit et confirmé. Le rescrit est gravé dans le marbre. Les procédures d’allégement de la présence fiscale dans les entreprises sont confirmées avec la mise en place d’une nouvelle procédure dite « examen de comptabilité » (EC) conduite depuis le bureau, le dialogue administration/contribuable se passant au téléphone. Mais aussi avec un transfert de tâches des services sédentaires, notamment le contrôle sur pièces des dossiers (CSP), vers les services de vérifications. Tout est fait pour réduire au maximum la présence des vérificateurs dans les locaux des entreprises. Mais le cynisme n’a pas de limites. Partant d’un constat objectif des difficultés du contrôle fiscal en termes de résultats et d’efficacité dans sa lutte contre la fraude. Constatant à juste titre que les objectifs quantitatifs (nombre de vérifications) imposés aux vérificateurs peuvent constituer un handicap à une analyse lucide de l’impact des actions de contrôle fiscal externe en fonction d’objectifs et de résultats tangibles en matière de lutte contre la fraude plutôt qu’à partir d’un nombre d’affaires rendues annuellement par chacun, l’administration en arrive à une conclusion ahurissante. Pour elle il faut augmenter de 5 % le nombre d’affaires rendues par chaque vérificateur. Le prétexte est l’introduction des nouvelles procédures (EC et CSP) dites plus légères. Cette décision revient à ignorer volontairement qu’un des problèmes majeurs des vérificateurs est le manque de temps à consacrer à l’approfondissement des dossiers pour débusquer la fraude. Une manifestation concrète de plus de la volonté du pouvoir de liquider la mission de contrôle fiscal externe et de son choix délibéré de tenir les entreprises le plus à l’écart possible des « tracasseries » fiscales. Pour faire bonne figure, Bercy a en même temps fait le choix d’annoncer à grands renforts médiatiques la création d’une super brigade de contrôle fiscal à compétence nationale. Véritable police fiscale, sorte d’IGPN du fisc, cette structure serait dotée dans un premier temps d’une cinquantaine d’agents, placés sous l’autorité d’un magistrat. Cette brigade pourra être saisie par le Parquet national financier (PNF) dans le cas de dossiers nécessitant une expertise fiscale pointue, avec des enjeux budgétaires considérables. Ce « fisc judiciaire », censé épauler la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF), pourra par ailleurs procéder à des écoutes et des perquisitions, comme le fait la police judiciaire. Une nouvelle confirmation du dévoiement total de la mission de contrôle fiscal externe est ainsi sous nos yeux. Alors que les brigades de contrôle et de recherche départementales sont en voie de fusion avec d’autres services ce qui revient à les vider de leur contenu, alors que les brigades départementales de vérifications sont elles aussi en voie de disparition, une super brigade, à compétence nationale, type shérif du contrôle fiscal, est constituée. En fait elle servira à alimenter la vitrine de la lutte contre la fraude à partir d’affaires déjà juridiquement connues pour d’autres entorses aux lois et règlements. Directement placée sous l’autorité d’un magistrat cette brigade aura tendance à s’émanciper du droit fiscal et de la procédure qui y est attachée pour se soumettre à une procédure civile, de type pénal essentiellement. À la dimension cache-misère de cette structure, puisqu’il n’y aura plus de réelle connaissance de la diversité du tissu fiscal sur tout le territoire et donc plus de contrôle correspondant, s’ajoute un risque de remise en cause du droit fiscal lui-même, un peu à la façon dont cela se passe en matière de droit du travail avec la remise en cause du droit prud’homal, laissant ainsi en déshérence juridique des secteurs entiers. Il faut d’ailleurs remarquer que la campagne contre le verrou de Bercy si nous n’y prenons garde, peut constituer un accélérateur de cette déstructuration, les députés LREM n’enfourchant pas cette campagne par hasard. Un dernier élément contenu dans la loi « Un État au service d’une société de confiance » concernant l’allégement des obligations déclaratives proposé aux entreprises jusqu’à 5 millions d’euros de chiffre d’affaires, confirme le choix de faire sortir du champ du contrôle fiscal externe l’ensemble de ces entreprises. Le contrôle fiscal ne s’adresserait plus finalement qu’aux grandes entreprises et comme celles-ci bénéficient de largesses fiscales de plus en plus importantes, on devine aisément le sort final de la mission de contrôle fiscal. |
Par Teste Benoît, le 31 May 2018

Voilà un peu plus d’un an qu’Emmanuel Macron, prétendant représenter la « modernité », recycle en réalité les vieilles idées libérales et met en œuvre une politique d’austérité budgétaire, brutale à l’égard de la Fonction publique et de ses agents, parmi lesquels bien sûr les enseignants. Pas de place, dans le nouveau monde à construire, pour cet archaïsme que constitue le recrutement de personnels sous statut, ni pour le fonctionnement d’un service public unifié donnant un enseignement de qualité à toute la population.
Dans un jeu de miroir parfaitement orchestré, son ministre Jean Michel Blanquer communique au contraire sur le registre du retour au « bon vieux temps » de « l’école d’avant », dans un exercice fort curieux car il s’apparente bien souvent à la négation de sa propre action : les réformes, pourtant d’ampleur, sont minorées, ramenées dans les discours à de simples ajustements ou mesures de « bon sens ».
La stratégie de la diversion est ainsi poussée à son paroxysme dans le domaine de l’éducation, l’étendard de la modernité étant tantôt brandi comme instrument de délégitimation du service public, tantôt utilisé comme repoussoir au profit d’un retour à un ordre ancien plus fantasmé que réel. Imposer un retour au réel suppose d’analyser le véritable changement de modèle de société qu’impose à bas bruits le gouvernement.
Définir ce que devrait être un service public moderne de l’éducation revient donc à ne pas laisser le terrain de la modernité aux libéraux tout en affirmant que le véritable débat n’est pas dans une fausse querelle des anciens et des modernes mais bien dans la définition des permanences qu’il faut préserver et des évolutions nécessaires dans un objectif de progrès social.
Élever le niveau de connaissances d’abord car dans un monde où les enjeux politiques et les évolutions de l’économie sont de plus en plus complexes, faire en sorte qu’un maximum de jeunes aille le plus loin possible dans les études et s’approprie ainsi des connaissances de champs multiples, qui leur permettront d’être des citoyens éclairés, réfléchis, critiques, voilà qui reste le grand objectif du service public d’éducation. C’est un enjeu politique de première importance car il conditionne la société que nous voulons construire. Les libéraux théorisent l’entrée dans « l’économie de la connaissance », qui n’est rien d’autre qu’une marchandisation accrue du savoir. Or, la confiscation du savoir par une minorité toujours plus restreinte prépare la catastrophe démocratique. Il s’agit donc au contraire de donner à tous les citoyens en formation les armes intellectuelles pour évoluer dans cette économie et cette société nouvelles, y faire preuve d’esprit critique, et pouvoir y accéder aux savoirs.
Élever le niveau de qualifications ensuite, afin de tirer l’économie du pays vers le haut. Dans ce cadre, un service public d’éducation moderne doit continuer de délivrer des diplômes nationaux et travailler à faire acquérir le niveau de diplôme le plus élevé possible. Le diplôme n’est pas qu’un bout de papier, il atteste d’un niveau de connaissances acquis par les individus. Les connaissances nécessaires pour exercer aujourd’hui la plupart des métiers, même ceux qu’on pense « peu qualifiés », ne cessent d’augmenter, et les entreprises le savent bien : si elles embauchent des gens diplômés, même pour des postes « peu qualifiés », c’est bien pour bénéficier des savoirs et des savoir-faire acquis par les jeunes à l’école, même si elles ne rémunèrent pas forcément ce surplus de savoir qu’elles utilisent pourtant. Malgré les critiques souvent entendues contre le baccalauréat qui, « donné à tous », « ne vaudrait plus rien », il faut réaffirmer que l’accès accru au baccalauréat a été un progrès social qui a profité aux catégories populaires. On objectera que le baccalauréat n’ouvre plus, aujourd’hui, à des emplois aussi qualifiés que par le passé, mais ce n’est pas une preuve d’une dégradation de sa valeur, ou plus largement des diplômes, bien au contraire, c’est la preuve de l’évolution des métiers. « Avant », pour être mécanicien automobile, un CAP pouvait certes suffire alors que maintenant il faut un baccalauréat professionnel. Mais le métier de mécanicien automobile est-il vraiment le même qu’avant ? Les savoirs à maîtriser ne sont-ils pas plus nombreux et plus pointus, en lien avec les incessantes évolutions des technologies ? Si le bac professionnel, aujourd’hui, débouche sur des métiers pour lesquels le CAP était suffisant il y a quelques décennies, c’est parce que ces métiers sont devenus plus exigeants. Faire reconnaître la qualification détenue à sa juste valeur est l’objet du combat permanent des salariés, le niveau de diplôme constitue indéniablement une condition certes pas toujours suffisante mais évidemment nécessaire pour mener cette lutte alors que le libéralisme cherche par tous les moyens à déqualifier le travail. Pour les progressistes que nous sommes, tous les élèves sont capables de réussir et le lycée doit se fixer comme objectif d’amener au baccalauréat l’ensemble d’une génération.
Loin de répondre à cette exigence, la réforme Blanquer du lycée, contestée par les personnels et les organisations lycéennes, dynamite le baccalauréat comme examen national, anonyme et terminal. Le nouveau baccalauréat entre en vigueur à la rentrée 2019 en Première avec la mise en place d’épreuves communes dès la fin du premier semestre, sortes de « partiels » sur le modèle universitaire. Ne seraient conservées que 4 épreuves finales, comptant pour 40 % de la note. Les épreuves communes transformeront le cycle terminal (les deux années de première et terminale) en course folle à l’évaluation puisque sur les deux années, on atteindra allègrement la trentaine d’épreuves au lieu d’une dizaine actuellement, et surtout la majorité de la note relèvera désormais du contrôle local ou continu. Le bac deviendra un examen de fin d’études secondaires dont la valeur dépendra de la réputation du lycée dans lequel on le passe.
La loi ORE (orientation et réussite des étudiants) de 2018 créant en particulier Parcoursup, contestée par les personnels et les étudiants, s’inscrit parfaitement dans cette logique libérale : il s’agit de ne plus offrir l’accès à l’enseignement supérieur à l’ensemble des lycéens par refus des investissements nécessaires. Elle instaure la sélection à l’entrée à l’université. Le « parcours » individuel de l’élève comme les choix de spécialités et les engagements extrascolaires conditionneront largement la poursuite d’études au regard des attendus des formations envisagées. Cette loi part aussi du présupposé que le principal enjeu de la démocratisation du lycée et de l’enseignement supérieur serait l’orientation. Ainsi, pour faire mieux fonctionner le système, il suffirait que l’orientation des élèves soit plus pertinente. On passe ainsi sous silence le manque d’anticipation criant des besoins dus à la pression démographique dans l’enseignement supérieur (808 000 candidats en 2017 pour 654 000 places). Les gouvernements successifs en portent la responsabilité et on peut se demander si le fait d’en arriver au tirage au sort pour affecter les élèves, ne constituait pas un repoussoir tel que n’importe quelle autre solution ne pouvait apparaître que meilleure. On voit aujourd’hui qu’avec cette plate-forme, près de la moitié des lycéens se retrouvent sans affectation au premier tour.
La question de fond reste celle des efforts que la nation est disposée à consentir pour augmenter le niveau de formation dans l’enseignement supérieur. Or, pour le gouvernement, il ne s’agit pas de mieux former la jeunesse pour renforcer ses chances d’insertion mais de faire face au moindre coût à l’afflux démographique sans dépenser plus.
C’est aussi la raison pour laquelle la FSU a toujours défendu un service public national de l’orientation scolaire et qu’elle s’élève avec force contre sa régionalisation en cours au nom d’une prétendue meilleure adaptation de l’offre de formation aux besoins du territoire : cette vision « adéquationniste » formation/emploi a été invalidée par de nombreux travaux de chercheurs. L’absence de visibilité à 5 ans sur le marché de l’emploi rend caduque toute tentative d’y inféoder l’offre de formation. Par ailleurs, la conception d’une orientation réduite à une bonne information fait totalement l’impasse sur d’autres travaux de recherche qui montrent la complexité des processus mis en jeux chez les jeunes. Les inégalités d’apprentissage et de rapport aux études en fonction des milieux sociaux restent très fortes et la peur d’échouer par rapport à son avenir scolaire et professionnel est très différenciée socialement. Parcoursup renforce ces biais. Par ailleurs, le risque d’avis négatifs selon les formations demandées ne peut que renforcer les inégalités sociales. Les élèves de catégories modestes, et plus particulièrement les filles, à résultats scolaires égaux seront plus anxieux. se. s et auront plus tendance à rabattre leurs choix sur des formations jugées moins prestigieuses. Leur demander « comment ils envisagent leur vie professionnelle dans dix ans » (fiche du premier conseil de classe de Terminale) est un biais social important qui va largement embarrasser les élèves de milieu populaire.
En éducation comme dans d’autres domaines, le court-termisme des libéraux et leur fascination pour les profits immédiats leur fait préférer un système éducatif au coût le moins élevé possible, qui créerait une main-d’œuvre directement employable et réserverait les qualifications les plus élevées à une petite partie de la population. Ce système est injuste et absurde sur le long terme, il est générateur d’immenses inégalités, de gigantesques frustrations et il prive la société de personnes instruites et pouvant exercer pleinement leur citoyenneté.
Ce court-termisme libéral est terriblement compatible, en revanche, avec le temps du politique : tout ministre de l’éducation veut imprimer sa marque et se lance dans LA réforme d’envergure, celle que « personne n’a osé imposer avant » mais qu’un volontarisme visionnaire va enfin mettre en selle au bénéfice des élèves. C’est ce que les enseignants ont vécu avec la réforme du collège où l’interdisciplinarité était la « trouvaille » de Najat Vallaud Belkacem qui prétendait qu’enfin, grâce à cela, les élèves allaient s’épanouir et progresser… les enseignants, qui pour beaucoup pratiquaient déjà des formes variées de travail interdisciplinaire quand ils l’estimaient pertinent, sont ressortis de cette séquence avec beaucoup d’amertume et même le sentiment qu’ils participent à armes inégales au débat éducatif car ils n’ont souvent rien de véritablement spectaculaire à défendre : là où les gouvernants en viennent à se transformer en bateleurs de foires pour vanter la réforme miracle, les enseignants rappellent que la pédagogie est une science inexacte faite de tâtonnements, d’adaptations aux publics divers, d’échecs ou de réussites difficilement explicables et difficilement modélisables. Bref, rien de suffisamment spectaculaire, certaines choses fonctionnent mais pas tout le temps, d’autres nécessitent telle et telle condition pour réussir, un discours mesuré et nuancé, pas toujours médiatique mais en prise avec les réalités d’une classe. C’est ce que joue de nouveau Jean-Michel Blanquer qui a découvert les vertus d’un élément unique et quasi miraculeux : les sciences cognitives, qui nous apprennent de manière définitive comment on doit apprendre, dans quel ordre et avec quelles méthodes… Le guide « pour enseigner la lecture et l’écriture au CP » que vient de diffuser le ministère est de ce point de vue éclairant d’une volonté de mettre au pas les enseignants du primaire en prétendant diffuser les bonnes pratiques, niant l’expertise des professionnels qu’ils sont : de nombreuses dimensions, approches ou activités de l’apprentissage de la lecture sont ainsi ignorées quand elles ne sont pas proscrites : écriture approchée, méthode mixte, mémorisation de mots outils, utilisation du contexte pour comprendre.
Pour fonctionner, le système éducatif a besoin de constance et d’investissements conséquents. Plus que jamais à l’approche de la rentrée 2018 se pose la question de l’adéquation entre les moyens et les effectifs d’élèves. 26 000 élèves en plus attendus dans le second degré et 2 600 postes en moins, c’est l’équation qui tue l’éducation ! Le gouvernement s’est bien gardé d’annoncer le nombre de postes qu’il entendait supprimer ministère par ministère, mais avec 120 000 suppressions annoncées sur le quinquennat dont 50 000 dans la Fonction publique de l’État, et quand on sait que le ministère de l’Éducation Nationale emploie 40 % des agents de l’État, nul doute que l’éducation sera amenée à payer un lourd tribut.
Un service public moderne doit pourtant assurer l’ensemble de ses missions. On peut prendre l’exemple du remplacement des personnels absents, poste souvent sacrifié en premier. La continuité nécessaire du service public nous fait revendiquer un volant de titulaires remplaçants. Mais dans de trop nombreux services publics, l’absence d’un agent se traduit en réalité par la redistribution des tâches sur les agents présents, sans même compensation financière dans la plupart des cas. Cette pratique détestable accroît la charge de travail de tous. C’est trop souvent devenu le cas aussi dans l’éducation, en particulier pour les Conseillers principaux d’éducation ou les AED (assistants d’éducation) qui ne sont bien souvent pas remplacés, y compris sur des absences longues comme les congés de maternité. Il faut dès lors que chacun fasse le travail de plusieurs personnes ! Côté professeurs, les tentatives pour faire remplacer les enseignants par leurs collègues de l’établissement eux-mêmes se sont toutes heurtées à l’infaisabilité pratique, remplacer un collègue au pied levé quand on n’a par exemple pas le temps de prendre connaissance de sa progression avec ses élèves et donc de préparer une séquence en conséquence est impossible à faire sérieusement quand on a déjà, avec ses classes, entre 41 heures et 45 heures de temps de travail hebdomadaire moyen (selon la dernière étude disponible sur la question du temps de travail des enseignants des premier et second degrés). La seule solution serait donc de recruter d’une part des étudiants-surveillants qui assurent des études sur les très courtes absences, et des titulaires remplaçants pour faire face aux besoins. Malheureusement, la première de ces solutions a été abandonnée en 2002, la deuxième est en passe de l’être en raison du sous-recrutement.
Un autre mantra libéral réside dans le développement de « l’autonomie des établissements » dans le second degré. Les collèges et les lycées disposent depuis 1985 d’une autonomie pédagogique qui porte notamment sur l’emploi de la dotation en heures d’enseignement et d’accompagnement personnalisé, les modalités de répartition des élèves (classes, groupes), le projet d’établissement, les expérimentations, les voyages scolaires… Ce cadre juridique donne aux équipes la possibilité d’exprimer via leurs représentants en conseil d’administration leur volonté pour ce qui relève de ces domaines. La réforme du lycée Chatel a élargi ce champ de l’autonomie, en laissant aux établissements le choix de l’emploi des « heures de marge », comme les 10 heures par division en Seconde, l’organisation des enseignements d’exploration, de l’accompagnement personnalisé… La réforme du collège a repris ces dispositions auxquelles s’ajoute le conseil de cycle devant définir les progressions.
Jean-Michel Blanquer déclarait dès sa prise de fonction : « je veux créer plus d’autonomie des acteurs, plus de liberté, plus de pouvoir d’initiative », reprenant ainsi une antienne vieille de plus de 30 ans dans une version « start up nation » chère au président.
Moins d’un an après ces déclarations, leur traduction concrète a bien peu à voir avec le respect de l’expertise professionnelle. On voit par exemple en ce moment les collèges sommés de choisir entre le maintien d’un enseignement de langues anciennes ou régionales et une heure en groupe à effectifs réduits. Au-delà de la volonté de masquer la pénurie dont on renvoie la gestion au niveau local en espérant qu’ainsi elle se remarque moins, elle met les établissements en concurrence et renforce les inégalités. Dans l’exemple donné ci-dessus, le choix local devient le marqueur et l’élément qui renforce les inégalités : aux uns une soi-disant excellence marquée par le maintien d’une langue ancienne, aux autres le traitement de la difficulté scolaire. Cette concurrence est supposée améliorer une « performance » immédiatement mesurable.
Les conséquences sur les pratiques de classe sont très importantes. Ce développement de l’autonomie sous couvert de vouloir libérer les initiatives a mis en place un système basé sur la concurrence entre les établissements et entre les individus, chaque établissement étant renvoyé à la responsabilité de traiter seul ses difficultés. Les chefs ont des pouvoirs renforcés et les équipes pédagogiques sont mises sous tutelle des conseils pédagogiques, de cycle, école-collège. Le vrai travail d’élaboration des choix collectifs pertinents est de plus en plus difficile.
Une des premières missions du service public est d’assurer l’égalité d’accès à l’éducation sur tout le territoire. Les habitants des banlieues, des villes moyennes, des départements et territoires d’outre mer et des territoires ruraux ont droit à une éducation de qualité. La politique d’éducation prioritaire n’a toujours pas fait l’objet d’annonces de la part de Jean Michel Blanquer alors que le programme d’Emmanuel Macron promettait sa relance, en particulier par la création d’une nouvelle prime de 3 000 euros par an versée aux personnels qui y sont affectés. Le rapport Borloo de mai 2018, fraîchement accueilli par le Président et le gouvernement pour les raisons budgétaires que l’on sait, a pourtant démontré que le besoin d’investissements dans tous les services publics, dont l’éducation, est criant dans ces territoires. Continuer à délaisser des populations entières est inacceptable. Au-delà de la question principale des moyens supplémentaires qui doivent être alloués pour reconnaître la spécificité des territoires, la vigilance s’impose particulièrement en éducation car la tentation a toujours été de ne plus « donner plus à ceux qui ont moins », philosophie initiale des politiques d’éducation prioritaire et qu’il faut poursuivre et amplifier, mais de leur donner « autre chose », ce qui fait souvent glisser vers une éducation au rabais. Ainsi, pourquoi proposer, comme le fait Jean-Louis Borloo que nous critiquons sur ce point, qu’écoles et collèges soient mis en réseau sous la direction du principal de collège ? Les objectifs des collèges des quartiers populaires pourraient dès lors être centrés sur l’approfondissement des enseignements du primaire, quand ceux des autres collèges seraient la construction d’une culture commune et amèneraient « naturellement » sur le lycée et les poursuites d’études. C’est cette divergence qu’il faut éviter absolument, la jeunesse des quartiers populaires a le droit à un enseignement dont les objectifs sont identiques à ce qui se pratique sur le reste du territoire.
Globalement, on peut avancer l’idée que dans l’éducation comme dans tous les services publics, la dégradation créée par la pénurie de moyens sert ensuite de justification à une accélération des réformes qui ne règlent rien sur le fond.
De la même manière que le tirage au sort des lauréats du baccalauréat en raison de l’absence de créations de postes d’enseignants en nombre suffisant à l’université a été instrumentalisé pour justifier ensuite la mise en place de la sélection à l’entrée à l’université. C’est en réalité dans de nombreux domaines que, surfant sur des dysfonctionnements créés par une pénurie de moyens, le gouvernement impose aux services publics une série de régressions à marche forcée : Parcoursup, baccalauréat, orientation, lycée, formation professionnelle, retour aux fondamentaux au primaire, instrumentalisation de certaines sciences pour asseoir des préconisations pédagogiques parfois contraires aux programmes, injonctions, complaisance pour l’école privée, promotion de l’apprentissage pré-bac aux dépens des lycées professionnels. Les choix faits aujourd’hui consistent à augmenter les outils de sélection, réduire les moyens d’enseignement, dénaturer le caractère national du bac, soumettre la formation professionnelle aux besoins des entreprises et abaisser la fin de scolarité à la maîtrise des fondamentaux pour une part des élèves… Cette politique renforce les inégalités scolaires en maintenant le poids des déterminismes sociaux. Or, le service public est le bien commun seul à même de répondre aux ambitions démocratiques de l’École. Garantir un service public d’éducation est un devoir de l’État fixé par la Constitution. Certaines réorganisations font et feront la part belle aux initiatives privées dont la finalité économique et sociale est loin de servir l’intérêt général. La multiplication des discours institutionnels favorables aux projets privés est un choix idéologique, exercé aux mépris de l’analyse objective et des valeurs de laïcité indispensables à notre société. Seul le service public peut garantir l’intérêt général. Remettre en cause ce principe constitue un risque majeur.
Dans l’enseignement comme dans toute la Fonction publique, le gouvernement présente le statut comme une source de rigidités et ses défenseurs comme des idéologues arc-boutés sur la défense de prétendus « privilèges ». Certaines caricatures du statut en font même une protection exorbitante et quasi imparable de travailleurs pouvant quasiment refuser le travail qu’on leur donne. C’est oublier que si l’autonomie professionnelle se traduit en particulier pour les enseignants par le principe de liberté pédagogique, le statut prévoit aussi la nécessité pour l’enseignant de rendre des comptes et le contrôle par l’État de son travail.
Le statut est avant tout une garantie pour les usagers de qualité et d’accessibilité au service public et pour les personnels une protection contre les pressions de tous ordres, leur permettant de remplir correctement leur mission. Le fonctionnaire est dans une position « statutaire et réglementaire », ce qui signifie qu’il n’est pas dans une relation contractuelle avec son employeur puisqu’il est au service de l’intérêt général. Le statut est caricaturé, or il est un équilibre fin entre le principe de hiérarchie qui fait qu’un fonctionnaire doit se conformer aux ordres qui lui sont donnés, et en particulier un enseignant doit enseigner ce qui est contenu dans les programmes définis nationalement, et un principe de responsabilité qui fonde son activité sur sa conscience professionnelle plutôt que sur sa simple soumission aux ordres reçus et in fine garantit donc son indépendance.
Dans l’éducation tout particulièrement, le statut est une réponse à la question posée dès la Révolution Française, en particulier par Condorcet, de l’indépendance du savoir et de sa transmission par rapport à l’autorité politique : « Aucun pouvoir ne doit avoir ni l’autorité ni même le crédit, d’empêcher le développement des vérités nouvelles, l’enseignement des théories contraires à sa politique particulière ou à ses intérêts momentanés. » On n’enseigne pas ce que tel ou tel groupe de pression pense souhaitable d’enseigner, ni même ce que les parents croient ou souhaitent. On enseigne les connaissances établies par la science, dans un cadre qui est celui des « valeurs de la République ». Et il ne s’agit surtout pas d’inculquer aux élèves une morale ou un savoir officiels mais de leur permettre de se construire comme individus libres, citoyens responsables et travailleurs aux qualifications reconnues et maîtres de leur activité. Dès lors, la « liberté pédagogique » est en réalité la seule garantie d’un exercice correct du métier enseignant. Ce n’est même pas qu’il serait plus « agréable » ou « confortable » d’exercer son métier avec une moindre pression, c’est tout simplement que c’est nécessaire. Pour que l’enseignement soit pertinent et profitable aux élèves, il faut un personnel qui ait conçu cet enseignement. Un enseignant fait en permanence des choix face à des situations qui n’ont pu être toutes modélisées, ces choix sont d’autant plus pertinents qu’il sont éclairés et conscients. Dans la même idée, le statut confère au fonctionnaire la pleine jouissance des droits du citoyen. Ce n’est pas forcément le cas dans un grand nombre de fonctions publiques, par exemple l’Allemagne ne reconnaît pas le droit de grève à ses fonctionnaires. En France, le préambule de la Constitution qui affirme que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » s’applique pleinement aux fonctionnaires et donc aux enseignants. On peut prendre pour exemple les CAP, commissions administratives paritaires, où les représentants des personnels siègent à égalité avec l’administration pour donner un avis sur l’ensemble des actes individuels de gestion (mutations, promotions, sanctions disciplinaires, etc.) et que les organisations syndicales ont particulièrement réussi à faire vivre dans l’éducation au bénéfice d’un traitement équitable et transparent des personnels.
Le gouvernement parle de « refonder le statut » mais les 120 000 suppressions de postes annoncées et la réalité des projets qu’il a d’ores et déjà présentés ne laissent aucun doute sur son intention véritable. Qui peut croire que recourir à davantage de personnel précaire sera de nature à améliorer le service public ? C’est pourtant ce qu’a présenté le gouvernement comme une piste à développer massivement. Ainsi, le gouvernement espère créer deux voies de recrutement, une par le concours et une autre par la voie de la précarité, avec à termes un alignement de tous sur l’absence de statut. Quelle « modernisation » est attendue si le gouvernement supprime le CHSCT, seul espace de prise en compte des questions d‘organisation du travail ? Et en diminuant le rôle des commissions paritaires, ne cherche-t-on pas à renforcer le poids des hiérarchies intermédiaires dans la gestion des carrières et des mutations des agents, au risque de voir se développer opacité et phénomènes de favoritisme ?
À l’inverse des conceptions managériales qui prétendent faire des personnels des exécutants dociles des consignes de leur hiérarchie, le statut, en articulant principe hiérarchique, responsabilité individuelle et responsabilité collective permet un travail efficace et une continuelle adaptabilité aux besoins et aux finalités de l’action publique. Grâce à leur statut de fonctionnaires de l’État, les personnels d’enseignement répondent aux besoins d’un service public national à l’abri des pressions de tous ordres. L’Éducation du xxie siècle mérite une politique déterminée sur des objectifs de réussite pour tous les élèves et dotée des moyens nécessaires pour y parvenir.zzz
--------------------------
* Secrétaire général adjoint du SNES-FSU, membre du secrétariat national de la FSU.
Par Morin Alain, le 31 May 2018

Pour imposer un tel chambardement le gouvernement a frappé à la caisse des organismes pour les contraindre à accepter ses conditions et les modalités de restructuration du secteur du logement social. Dans ce projet, les locataires, les collectivités locales et le service public du logement sont dans le collimateur. Des contre-propositions ont été avancées, concernant la restructuration de secteur du logement social, notamment par la Fédération des OPH. Mais ce projet n’en reste pas moins globalement dans la continuité de l’offensive brutale qu’avait déjà révélé le coup de force de l’article 52 de la loi de finances 2018 privant les bailleurs de 3 milliards d’euros sur 3 ans. Le recours autoritaire aux ordonnances est annoncé pour l’adoption de nombreux articles.
Face à ce coup de force et au brouillage idéologique, l’information des locataires, des élus et de toutes les organisations et les institutions concernées doit s’amplifier et la contre-offensive s’organiser rapidement pour vraiment préserver et promouvoir, en le modernisant, cet outil du progrès social. En effet il y a urgence : le projet de loi sera discuté au parlement au mois de mai et juin prochain.
En réduisant autoritairement de 3 milliards d’euros les moyens des organismes de logement social, Emmanuel Macron a visé un double objectif :
– faire monter l’idée que l’argent des organismes de logement social est sous-utilisé et qu’une « mutualisation » de leurs moyens, renforcée par un grand mouvement de concentration des organismes du secteur programmée par la loi Elan dégagerait les financements pour relancer la construction et la réhabilitation du logement social tout en permettant un retrait des aides de l’État.
– déstabiliser l’ensemble du secteur HLM pour remettre en cause sa gouvernance. Alors que le modèle actuel oblige l’État à prendre en compte, dans son pilotage du logement social, les institutions du logement social (représentant les bailleurs et les locataires), les collectivités locales, les banques et les entreprises, le modèle qui se dessine marginaliserait les élus de proximité et le mouvement HLM dans sa diversité.
Les méthodes utilisées pour imposer ce choix aux acteurs du logement social ne sont pas sans rappeler celles pratiquées par les prédateurs financiers pour mettre la main sur une entreprise.
Le prélèvement massif de l’État sur les organismes HLM au titre de la Réduction de loyer de solidarité, qui ne bénéficie en rien aux locataires va déstabiliser le tissu HLM.
Cette réduction du loyer des allocataires de l’APL entraîne une perte sur 3 ans de 3 milliards d’euros pour les bailleurs sociaux. Il va mettre à la merci des organismes les plus puissants tout ou partie du patrimoine des bailleurs les plus fragiles qui représentent environ 40 % de l’ensemble des bailleurs sociaux. La RLS apparaît clairement comme ciblée pour affaiblir le secteur public du logement.
Si tous les organismes de logement social vont être affectés par la RLS, son impact sera très différent selon les cas. En effet, cette mesure frappe bien plus durement ceux qui ont le plus de locataires relevant de l’APL puisque la baisse des loyers privant les HLM de ressources correspond à celle des APL. C’est le cas des OPH qui comptent dans leur parc 54 % d’allocataires aux APL (47 % pour les ESH). Ces OPH logent les familles les plus modestes avec les loyers les plus bas2. Alors qu’ils disposent de moins de recettes ils pourraient subir les plus fortes baisses.
Si pour calmer le jeu une péréquation dans sa mise en œuvre a été annoncée, celle-ci selon l’accord-cadre ESH-Procivis3-état « permettra de prendre en compte la proportion de ménages défavorisés dans le parc de chaque organisme tout en accompagnant à moyen terme la restructuration du secteur ». Il s’agira donc d’une aide non encore chiffrée mais conditionnée à leur soumission aux exigences de la politique de concentration de la réforme.
Place au marché
La loi Elan accentuerait encore ce choc créé par la RLS puisqu’il va pousser au pas de charge sur 3 ans une restructuration de l’ensemble du secteur pour accélérer les concentrations. Dans ce but il obligerait tout organisme de moins de 15 000 logements à fusionner avec un ou plusieurs autres et donnerait au ministre du Logement le droit de dissoudre d’autorité des organismes gérant moins de 1 500 logements non intégrés dans un groupement4.
Mais comme le souligne Isabelle Rey-Lefebvre, les regroupements forcés de la loi Élan visent d’autres objectifs que ceux de la mutualisation de moyens : « Le projet Macron n’est en effet pas seulement d’organiser une péréquation entre organismes riches et pauvres, mais surtout de les transformer tous en entreprises à structure capitalistique, avec des actionnaires » 5… « Depuis son élection, Emmanuel Macron a, à plusieurs reprises, sonné la charge contre le logement social »… « il n’y a pas de bonne circulation du capital », justifiait-il, le 6 octobre 2017 »… «Il s’agit donc de donner une valeur à ce patrimoine dans la perspective de le vendre… Le gouvernement parle « d’accession à la propriété », « de vente aux occupants » au rythme de 45 000 cessions par an, soit 1 % du parc. Les bailleurs sociaux devront reverser 10 % du produit de ces ventes à un fonds national pour la construction, permettant à l’État de se désengager un peu plus encore. Mais intégrer la vente future d’un logement social dans son plan de financement, donc le montant de son loyer, c’est envisager une cession systématique : un changement radical de modèle économique. »
Vendre le patrimoine pour construire
La vente des logements sociaux est au cœur du projet Elan.
Dans le passé, le prétexte pour vendre était celui de l’aspiration à « l’accession sociale à la propriété » de ses occupants ou encore pour favoriser la mixité sociale. Dans le projet de loi Elan, les ventes doivent avant tout constituer la ressource essentielle pour construire de nouveaux logements et pour réduire les aides publiques à la construction6.
Déréglementation…
Les ventes de logements seraient « libérées » : l’autorisation préfectorale ne serait plus nécessaire, le droit de préemption des communes supprimé.
En cas de vente entre organismes, qui ne nécessiterait plus l’agrément du préfet sauf exception, le prix de vente serait fixé par le vendeur. Cela accélérerait les acquisitions par les groupes les plus riches et les concentrations, et briserait les principes de solidarité du logement social puisque les prix de ventes entre organismes seraient déterminés par le marché au lieu de l’être comme actuellement par leur valeur nette comptable.
La vente d’un logement vacant serait ouverte d’abord aux locataires du logement social du département, mais la quasi-suppression des APL accession rendrait très improbable la vente à ce public aux revenus insuffisants7. Puis dans l’ordre la collectivité locale pourrait l’acquérir et enfin toute autre personne physique. L’objectif visé est peut-être l’ouverture aux « personnes physiques » disposant des moyens financiers pour assurer des opérations juteuses, notamment dans les plus belles réalisations et les quartiers les plus attractifs.
Concernant le chiffrage du produit des ventes le rapport de l’étude d’impact de la loi reprend celui de l’étude du Conseil général de l’environnement et du développement durable : la vente de 32 000 logements pourrait rapporter 2,8 milliards €8, soit un prix moyen de 62 500 €. Or, par exemple, le coût d’un logement PLUS, le plus courant dans le logement social, réalisé qui s’élevait en 2000 à 78 000 € n’est-il pas largement amorti depuis 18 ans. Comment prétendre que les locataires pouvant postuler auraient les moyens de l’acquérir ?
Les outils de la réforme
De nouvelles institutions – les « sociétés de ventes d’habitations à loyers modérés » – seraient créées pour accélérer les ventes de logements. Elles auraient pour fonction l’acquisition de biens immobiliers. Action logement a déjà décidé de créer une filiale dédiée à l’achat en bloc de logements sociaux puis à leur vente. Ainsi l’argent des cotisations sociales des entreprises pourrait être mis au service du remplacement ou de la transformation de logements sociaux en logements intermédiaires ou pour la destruction d’une partie du logement social.
Ces ventes excluent les logements des quartiers de la politique de la ville, les immeubles de moins de 10 ans ainsi que les immeubles des communes qui ne respectent pas le quota obligatoire de logements sociaux. Mais cela représenterait encore un potentiel de 800 000 logements « vendables ».
Le ministre des Finances estime qu’une vente d’un logement pourrait permettre de construire trois logements. Et donc qu’avec 800 000 logements on pourrait viser un objectif de 2,4 millions de logements sociaux supplémentaires. Ce qui est totalement illusoire si ces logements ne sont pas livrés à la spéculation.
Il s’agit donc comme le souligne Eddie Jacquemart, Président de la Confédération nationale du logement, d’une « privatisation d’un bien public financé par la solidarité nationale » associant par leurs financements l’État, les collectivités territoriales, les entreprises et les locataires.
Danger pour les territoires
Les élus de terrain soucieux des besoins de leurs collectivités locales auront de moins en moins de prise sur les décisions de construction, de réhabilitation et d’intégration du logement social dans l’aménagement de leur ville. Certes on continuera pendant 10 ans (au lieu de 5 ans) à comptabiliser ces logements vendus dans les quotas de logement social au titre de la loi SRU mais chaque logement vendu sera retiré de l’offre faite aux demandeurs de logement.
Or les collectivités locales ont financé pour une part ces logements. Elles ont garanti les emprunts et permis ainsi aux bailleurs de bénéficier de taux plus bas. Mais elles n’ont aucune garantie que d’autres logements seront construits car avec la restructuration du secteur la prise des villes et des villages sur les décisions serait fortement réduite. Les décisions structurantes seront monopolisées par les groupes dominants du secteur social (Action logement, CDC – logement…), le marché, les banques et l’État.
Relever le défi
Mais ces objectifs guidés par le profit se heurtent aux exigences des locataires, des populations et des élus. Ils attendent des bailleurs du logement social qu’ils répondent à leurs besoins de logement en qualité et en quantité en rapport avec les revenus des familles, avec des projets immobiliers intégrés dans la ville, qu’ils élargissent leurs missions sociales avec le développement de nouveaux services pour les locataires (pour les personnes âgées, crèches de quartier, alphabétisation…), qu’ils aident les initiatives éducatives et culturelles.
Des contre-propositions sont avancées par les associations de locataires pour élargir leurs pouvoirs d’intervention dans la gestion et au sein des institutions et pour responsabiliser l’État dans le financement du logement social, en relevant massivement ses aides publiques à la pierre.
Particulièrement concernée par le projet de restructuration du secteur, la fédération des OPH a présenté un contre-projet avec :
– la création d’une institution : la Communauté d’organismes pour favoriser notamment « la mutualisation des fonds propres et la capacité collective de lever des fonds propres pour répondre aux attentes locales de l’habitat ». La création d’une telle institution, dont le statut serait celui de société anonyme, a été retenue dans le projet de loi ainsi qu’une partie limitée du contenu proposé par ses initiateurs. Ce sujet fera sans doute l’objet d’un large débat.
– Élargissement des compétences des organismes sociaux aux services des locataires (maisons médicales, ou maisons de santé, établissements et services sociaux et médico-sociaux).
– Élargissement des compétences des organismes sociaux aux services des collectivités locales (ingénierie).
Une campagne de sensibilisation des locataires et des élus de terrain pesant sur la discussion parlementaire devra s’intensifier pour défendre le service public du logement social. Celui-ci est menacé par les choix ultralibéraux de la politique gouvernementale et la constitution de groupes hyper dominants au service du marché. Ce combat doit aussi permettre au service public de conquérir les moyens d’affronter les nouveaux défis du logement social par des coopérations et des mutualisations respectueuses du choix de chaque organisme. Ce qui passe aussi par la conquête de pouvoirs des locataires et des élus, notamment sur l’utilisation de l’argent dans tout le secteur du logement.
-------------
1. Elan : portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
2. Les loyers des OPH sont en moyenne inférieurs de 18 % à ceux des ESH et de 40 % de ceux du secteur libre.
3. Procivis représente les intérêts de 53 sociétés anonymes d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété. Son réseau gère 200 000 logements sociaux.
4. Dans ce cas le ministre peut imposer son rachat par un organisme de logement social.
5. « Macron, le président qui voulait privatiser les HLM », par Isabelle Rey-Lefebvre, Le Monde, 24.01.2018.
6. Pour le député François Jolivet (LREM, Indre), qui envisage déjà certaines modifications du projet de loi, « l’idée est de sortir du « financement par les subventions publiques » en permettant aux offices HLM de se transformer en ESH, coopératives, Semop ou SPL ». « Elan : les pistes d’amendements évoquées par les parlementaires aux 13e rencontres pour le logement et l’immobilier » par Lucie Romano, publié le 28 mars 2018, Habitat et Urbanisme.
7. Le niveau de vie médian de locataires est inférieur à celui de la population générale : 15 900 €, contre 20 200 €.
8 - Etude d’impact de la loi Elan page 186.
le 31 May 2018
Dans une tribune parue dans le journal Les échos en 20171, Éric Le Boucher, journaliste et directeur de rédaction des Enjeux-les Échos, affirme que l’absence de culture économique des Français ne leur permet pas de comprendre les réformes portées par Emmanuel Macron.
Pire encore, l’apprentissage de l’économie leur en donne une vision tronquée !
Il affirme : « La vérité est que le lycée n’apprend pas l’économie aux Français, il lui apprend à se méfier de l’économie. Voilà pourquoi les Français ne comprennent rien aux réformes macroniennes et les “politisent” de façon caricaturale. Il faudra que le président de la République s’en préoccupe. »
Quel est donc l’apprentissage actuel de l’économie des jeunes qui les pousse tant à « politiser » les réformes et quelle direction semble prendre la rédaction des futurs programmes d’économie au lycée ?
Avant l’université ou les autres établissements d’enseignement supérieur, l’économie est étudiée pour la première fois au lycée. Les élèves peuvent l’aborder dès la classe de seconde en enseignement exploratoire et poursuivre en première et en terminale avec un bac ES (économique et social).
Ce bac est aujourd’hui choisi par de nombreux lycéens (33 % des bacs généraux en 2017), ses effectifs sont aussi en augmentation.
Les sciences économiques et sociales (SES) existent au lycée depuis 1969 (premier bac « B »).
Une place importante avait été faite à l’interdisciplinarité, les programmes avaient une approche par objet et par questionnement (par exemple concernant la notion d’inégalité : comment peut-on analyser les inégalités ?), l’économie ET la sociologie étaient alors mobilisées afin de traiter un chapitre. Les inégalités pouvaient être par exemple analysées en termes de revenus mais aussi d’inégalités d’accès à des positions de pouvoir.
En 2011, une réforme des programmes de SES a commencé à remettre en question cette logique d’interdisciplinarité. Le principe d’une séparation plus nette entre économie et sociologie a été acté, l’approche interdisciplinaire n’ayant lieu que dans quelques chapitres périphériques (les « regards croisés »), un certain recul de la sociologie a aussi été entériné.
N’en reste pas moins que les SES ont aujourd’hui une place importante au sein du bac économique et social avec un nombre important d’heures de cours ainsi qu’une diversité des thèmes abordés en classe (croissance, commerce international, développement durable, place et rôle de l’État dans l’économie, monnaie, marché etc.) permettant aux lycéens d’être formés aux sciences sociales, préparés aux études supérieures et d’être formés de manière critique à la citoyenneté.
Depuis 2017, le ministre Jean-Michel Blanquer met en place à marche forcée une réforme du lycée. Sans rentrer dans une description de cette réforme et au-delà des changements d’heures attribués aux SES ; la rédaction de nouveaux programmes devrait officiellement commencer à être discutée dès octobre 2018 (en effet, il est prévu que, dès 2020, le nouveau bac soit mis en place).
L’écriture de ces programmes risque d’être influencée par des lobbys pro-patronat parmi lesquels l’académie des sciences morales et politiques (ASMP) présidée par Michel Pébereau (ex PDG de la BNP Paribas).
Pour l’ASMP, l’enseignement actuel des SES « témoigne d’une ambition encyclopédique démesurée, illusoire, et finalement néfaste ». Les propos lors de l’un de ses colloques organisé le 30 janvier 2017 laissent entrevoir toutes les passions suscitées par l’idée que Marx puisse encore être étudié par des lycéens :
« Doit-on parler de Marx ? Pourquoi ne pas le laisser au programme d’histoire ? Qui parle encore aujourd’hui de classe sociale ? La précarité peut arriver à tous. »2
L’ASMP propose de réduire les programmes à des « concepts fondamentaux », de se recentrer sur la micro-économie3, et de parler davantage du fonctionnement de l’entreprise et des mécanismes de marché.
On apprendrait donc à des élèves à mieux gérer leur budget, à utiliser des modèles simplistes de fonctionnement d’une entreprise et surtout à en avoir une vision positive.
Dans la continuité de l’enseignement supérieur, une place plus importante serait faite à l’usage des mathématiques en économie.
Inquiétant car l’ASMP, malgré son absence de poids au sein des professeurs de SES, a l’oreille du ministre. Pierre-André Chiappori et Georges de Ménil, deux correspondants de l’Académie des sciences morales et politiques feraient partie du groupe d’experts chargé de rédiger les nouveaux programmes. Pour n’en présenter qu’un, Pierre-André Chiappori réprouvait que les manuels de SES présentent les risques sur les marchés financiers, quelques semaines avant que n’éclate la crise des subprimes !
Si le programme de SES actuel aborde de nombreuses notions et débats économiques, il ne faudrait pas non plus croire qu’un pluralisme idéologique y est présent. Si pluralisme il y a, c’est un pluralisme limité ; les débats économiques se résumant souvent à un face à face entre économistes keynésiens et néoclassiques.
Il est ainsi révélateur d’observer que la notion de capitalisme est inexistante dans les programmes actuels. Les analyses de Marx sont uniquement abordées en sociologie (analyse des classes sociales) mais jamais dans leur dimension économique. On peut d’ailleurs faire la même remarque en ce qui concerne l’université. Les libéraux qui prétendent défendre le pluralisme opèrent donc en réalité un contrôle très poussé de l’apprentissage de l’économie.
Une part très importante du programme de première et terminale est actuellement consacrée aux mécanismes de marché et laisse peu de place (et surtout de temps !) à l’étude de visions alternatives.
L’absence de pluralisme dans l’apprentissage de l’économie à l’université (rappelons que le programme de licence correspond au programme de pensée des économistes néoclassiques) risque donc d’arriver dans l’enseignement secondaire.
Cela est révélateur du fait que la bourgeoisie mène aussi la lutte sur le terrain des idées, il faut que les lycéens aient pour unique grille de lecture du monde le marché.
Il faut aussi rapprocher ces évolutions des attaques très violentes des économistes ayant une approche historique et politique (on peut notamment penser au débat ayant fait suite à la parution de l’ouvrage de Pierre Cahuc et André Zylberberg4 visant à disqualifier tous les économistes n’ayant pas leur méthode de travail en déniant la qualité scientifique même du travail des économistes hétérodoxes).
Il faudra donc être vigilant, se mobiliser pour un apprentissage de plusieurs grilles de lecture en économie au lycée. Ce sont bien les économistes marxistes et postkeynésiens qui avaient alerté de l’imminence d’une crise en 2008 quand les néoclassiques vantaient les mérites des marchés autorégulateurs, leur absence de culture économique se paie encore aujourd’hui.
Une seule certitude, c’est la mobilisation et la lutte qui paieront. L’APSES (association des professeurs de sciences économiques et sociales, de très loin majoritaire chez les professeurs de SES) avait appelé à un rassemblement le 11 avril 2018 devant le ministère de l’éducation nationale, initiative réussie mobilisant des centaines de professeurs de SES de toute la France, espérons que les mobilisations à venir. zzz
-------------------
* Pour plus d’informations concernant l’évolution de l’enseignement de l’économie au lycée, consulter la première partie de l’ouvrage de Marjorie Galy, Erwan Le Nader et Pascal Combemale, Les Sciences économiques et sociales, La découverte, 2015, pages 22 à 52.
** Professeur de sciences économiques et sociales.
1. « Macron face à l’inculture économique des Français », Les Échos, 2 novembre 2017.
2. « SES vs Académie : Premier round », article du site café pédagogique, 31 janvier 2017.
3. « Même si elle est utile, la macro-économie est encore trop présente aujourd’hui dans l’enseignement, alors que beaucoup de problèmes macro-économiques contemporains sont trop compliqués pour des lycéens. D’ailleurs, ils ne font pas l’objet d’un consensus », interview 2017 de Pierre-André Chiappori.
4. Pierre Cahuc et André Zylberberg, Le Négationnisme économique, Flammarion, 2016.
Par Boccara Paul, le 31 May 2018
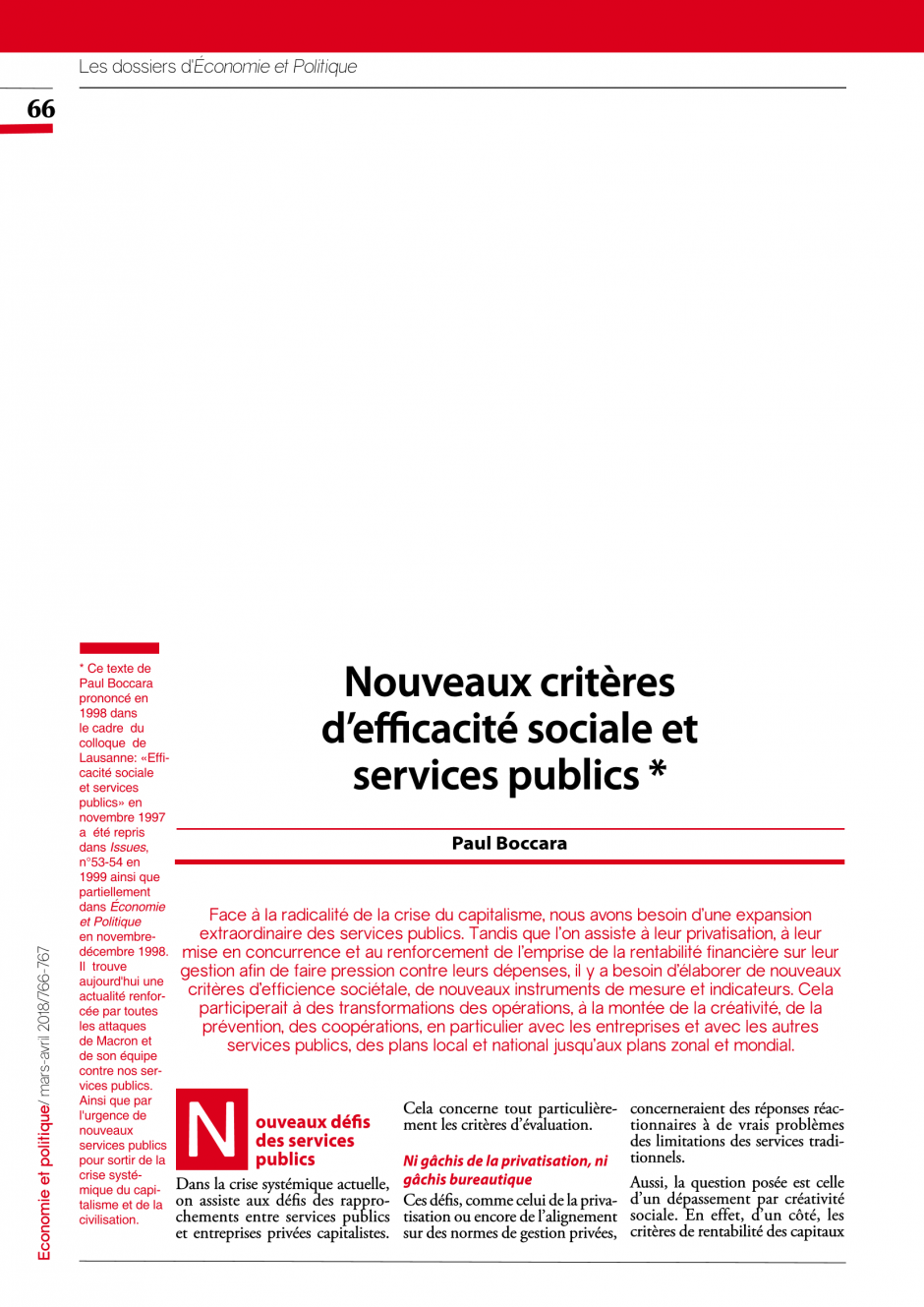
Face à la radicalité de la crise du capitalisme, nous avons besoin d’une expansion extraordinaire des services publics. Tandis que l’on assiste à leur privatisation, à leur mise en concurrence et au renforcement de l’emprise de la rentabilité financière sur leur gestion afin de faire pression contre leurs dépenses, il y a besoin d’élaborer de nouveaux critères d’efficience sociétale, de nouveaux instruments de mesure et indicateurs. Cela participerait à des transformations des opérations, à la montée de la créativité, de la prévention, des coopérations, en particulier avec les entreprises et avec les autres services publics, des plans local et national jusqu’aux plans zonal et mondial.
Dans la crise systémique actuelle, on assiste aux défis des rapprochements entre services publics et entreprises privées capitalistes. Cela concerne tout particulièrement les critères d’évaluation.
Ni gâchis de la privatisation, ni gâchis bureautique
Ces défis, comme celui de la privatisation ou encore de l’alignement sur des normes de gestion privées, concerneraient des réponses réactionnaires à de vrais problèmes des limitations des services traditionnels.
Aussi, la question posée est celle d’un dépassement par créativité sociale. En effet, d’un côté, les critères de rentabilité des capitaux développent le chômage massif et les gâchis des placements financiers. L’influence des critères de rentabilité entraîne non seulement la pression sur les salaires mais l’utilisation d’emplois précaires, à l’opposé de la garantie d’emploi statutaire de type public. Les privatisations peuvent concerner des écrémages des parties les plus rentables des services provoquant la tendance à des services à deux vitesses, avec un service minimum dit universel mal traité, etc.
Mais, d’un autre côté, l’absence de critères d’évaluation synthétique et d’indicateurs rigoureux corrélatifs des résultats des entreprises et services publics traditionnels a pu y développer des gâchis bureaucratiques, sans compter les rigidités, les cloisonnements et les faiblesses des coopérations, etc.
Or précisément, les mutations en cours, dans la crise systémique actuelle, poseraient le défi de dépassements radicaux pour que, partout, tous les acteurs sociaux concernés puissent intervenir de façon créatrice afin de promouvoir en coopération, à la fois, l’efficacité des entreprises et des services et leurs propres épanouissements. Il s’agit avant tout des défis de la révolution informationnelle.
Révolution informationnelle et mixité « marché et partage »
Les débuts de la révolution technologique informationnelle lanceraient des défis extrêmement profonds mais ambivalents : d’un côté la domination exacerbée mondialisée des marchés, de l’autre, en même temps et de façon contradictoire, des éléments effectifs de dépassement des marchés pour une minorité radicale « marché et partage » mettant aussi en cause la dichotomie « public/privé ».
Après la révolution informationnelle, des moyens matériels remplacent certaines fonctions du cerveau humain pour le stockage, la circulation et le traitement des informations ou données de toutes sortes (comme dans les ordinateurs) et non plus seulement les mains (comme avec la révolution industrielle de la machine-outil). En même temps, les informations et services informationnels, ainsi propulsés, tendent à devenir prédominants dans toutes les activités, y compris la production matérielle.
Mais une information, par exemple, le résultat d’une recherche, est essentiellement différente d’un produit industriel. Si je livre un produit industriel, comme le stylo avec lequel j’ai écrit cette communication, je ne l’ai plus. Ainsi pour le reproduire, celui à qui je le livre comme produit spécialisé doit me payer au moins tous les coûts. C’est la règle de l’échange sur le marché. Au contraire, si je livre une information – comme je le fais en ce moment – je ne la perds pas et beaucoup d’autres peuvent l’avoir. Aussi, on peut partager les coûts. Or les coûts de ce type deviennent colossaux et tendent à devenir prédominants. Au-delà de la notion traditionnelle restrictive de bien collectif, toutes les activités sont de plus en plus concernées par ces exigences de partage informationnel. Ainsi, la dichotomie « public/privé » peut commencer à être dépassée pour le progrès social par le partage, tout en maintenant une impulsion particulière du secteur public.
Cependant, on peut partager les coûts des recherches ou des informations et donc les abaisser pour chacun, d’autant plus qu’il y aura plus de gens formés, employés, équipés, traités en sujets créateurs et responsables pour les utiliser, dans une activité, dans un même pays, comme dans le monde.
D’où la question posée de la montée du partage des coûts, des informations et des pouvoirs, à l’opposé des échanges marchands et des monopoles, comme des dominations bureaucratiques des entreprises privées et publiques. Et cela, tout d’abord, dans une mixité partage et marché. D’où, aussi, la question posée du dépassement de la précarité du salariat, par la suppression du chômage, le rôle décisif de la formation et l’intervention créatrice de tous.
Toutefois, sous domination de la rentabilité financière, si les entreprises cherchent activement à partager les coûts informationnels, comme ceux de la Recherche-Développement, c’est de façon monopolisatrice pour détruire les concurrents dans la guerre économique. Et pour partager de façon monopoliste, on vise à dominer de vastes ensembles en réseau, et cela jusqu’à l’échelle mondiale, en utilisant les prises de contrôle en Bourse et le marché financier, la déréglementation, la concurrence de destruction, les privatisations. Pour la rentabilité financière, ses prélèvements parasitaires et chaotiques, on s’efforce d’abattre les cloisons et barrières entre public et privé ou entre services publics eux-mêmes aux plans national et international.
Cependant, on peut proposer des coopérations nouvelles institutionnalisées, intimes et ouvertes, pour partager les coûts nouveaux, les résultats informationnels et les pouvoirs, y compris entre services publics, jusqu’au plan international. Et cela, sans les gâchis des immenses dépenses financières de contrôle et sans les pressions de la rentabilité financière contre l’emploi ou pour des services à deux vitesses, etc.
En outre, les nouveaux moyens informationnels rendent possibles, sous condition d’une organisation sociale appropriée, une circulation et l’accès à l’information interactive de tous (travailleurs, usagers et consommateurs), à l’opposé du secret et de l’accaparement de l’information sans cesse relancés par les monopoles capitalistes et la domination bureaucratique.
Au contraire, la maîtrise et l’enrichissement de l’information passent, à travers sa circulation la plus large, par le respect des différences et de l’autonomie pour l’intercréativité de tous.
Voyons maintenant, de façon plus précise, les questions de critères et principes de gestion, en distinguant, relativement, les services publics marchands et les services publics non marchands.
Les services publics marchands et les entreprises publiques ou encore nationalisées développées surtout après la deuxième guerre mondiale (visant, au-delà des missions de service public, la modernisation nationale, avec le plein-emploi et un certain progrès social) ont été caractérisés par la levée ou la réduction de l’exigence de rentabilité des capitaux pour eux-mêmes, tout en tendant à les conforter en dehors d’eux. Déjà, Keynes parlait de la non exigence du « rendement commercial » pour l’investissement public. Mais s’il y a eu plusieurs expérimentations de règles et de calculs nouveaux, il n’y a pas eu création de critères synthétiques marchands décentralisés, dépassant à la fois les côtés négatifs et les côtés positifs des critères de rentabilité des capitaux, et favorisant aussi des coopérations intimes au plan régional et national, comme au plan zonal et international.
D’où, après de grands progrès, finalement la montée de gâchis bureaucratiques et aussi de ceux dus à la pression de la rentabilité privée environnante. D’où les défis actuels de la privatisation, face aux exigences de la révolution informationnelle.
C’est pourquoi de nouveaux critères d’efficacité sociale des entreprises peuvent être proposés. Je l’ai fait, pour ma part, pour une mixité conflictuelle viable et évolutive avec les critères de rentabilité, notamment avec un livre de 1985 Intervenir dans les gestions avec de nouveaux critères, Éditions Sociales, puis avec un autre ouvrage, collectif, en 1995, Nouvelles approches des gestions d’entreprises, L’Harmattan). Cela a suscité en France d’autres approches, plus ou moins apparentées ou rivales, quoique visant plutôt à élargir la réalisation de la rentabilité et non des critères vraiment alternatifs, à la fois compatibles et opposés par rapport à la rentabilité capitaliste, dans une mixité radicale.
D’ailleurs, un rapport du Commissariat du Plan en France vient de sortir, partant en fait de ces propositions de critères et d’indicateurs nouveaux de gestion des entreprises, tout en tendant à refouler l’aspect alternatif des propositions et la distinction entre entreprises publiques et entreprises privées (Entreprise et performance globale, outils, évaluation, pilotage, Economica, 1997).
J’évoquerai ici, de façon succincte, quatre ensembles, à partir des critères de rentabilité capitaliste : ceux de la rentabilité économique (profit total/capital total) et de la rentabilité financière : profit disponible (profit total moins intérêts + produits financiers)/capital propre (capital total moins capital emprunté).
1er ensemble : l’efficacité du capital
On peut opposer et relier à la rentabilité économique capitaliste, ou rapport « profit/capital », ce qu’on peut appeler l’efficacité du capital de l’entreprise. Elle est définie par le rapport « valeur ajoutée/capital matériel et financier » : VA/Cmf.
Au numérateur, VA, au lieu du profit, le but c’est toute la valeur ajoutée : la richesse nouvelle produite. Celle-ci comprend les profits, mais aussi les salaires, les dépenses de formation, les prélèvements publics et sociaux. Dans ces conditions, le salaire n’est pas seulement un coût à réduire, y compris par le chômage (comme quand le but est le profit) mais aussi un but de la production.
Au dénominateur, Cmf, on a le capital matériel et financier. Son économisation, relativement à la VA produite, définit l’efficacité. Et celle-ci se relie ainsi à l’utilisation de la révolution informationnelle sans les gâchis des placements financiers.
2e ensemble : l’efficacité sociale
Grâce à cette économie des capitaux, relativement bien sûr à la croissance de la valeur ajoutée produite, il y aurait moins besoin de profit pour l’accumuler en augmentant les capitaux, toujours relativement à la valeur ajoutée produite. On peut donc, sur cette base, accroître la partie de la valeur ajoutée disponible pour les travailleurs et la population, et aussi la masse, correspondant à cette partie, que j’appelle la valeur ajoutée disponible, la VAd.
Elle comprend les salaires, mais aussi les dépenses de formation, ainsi que les prélèvements publics et sociaux, tout ce que le but exclusif du profit tend à réduire.
Ces dépenses pour les capacités et ressources humaines (y compris les capacités de recherche) favoriseraient à leur tour l’efficacité des capitaux.
3e ensemble : la productivité de tous les facteurs ou l’économie sur tous les coûts, orientées socialement
Il ne s’agit pas seulement d’économiser sur les coûts en capital matériel et financier, même si c’est prioritaire. Il s’agit d’économiser sur tous les coûts, y compris en élevant la productivité du travail vivant, sur les salaires : mais toujours grâce à l’efficacité du capital pour que cela revienne aux travailleurs et à la population, donc pour une Valeur Ajoutée disponible supplémentaire ou VAds. Cette VA disponible supplémentaire peut concerner des augmentations de salaires, ou de dépenses de formation, de prélèvements sociaux (y compris des prélèvements mutualisés pour la formation), etc.
On rechercherait donc aussi le bénéfice (c’est-à-dire la différence entre recettes et coûts totaux) mais pas pour le réserver à l’augmentation des capitaux matériels et financiers, ce qui est le rôle du profit au sens strict distingué du bénéfice, ou encore à des sorties de profit de l’entreprise, et au contraire pour accroître la VAds.
Aussi, on peut écrire :
Bénéfice = profit + Valeur ajoutée disponible (pour les travailleurs et la population) supplémentaire.
4e ensemble : la coopération et le partage de certaines dépenses, avec comme but la population elle-même
Il s’agit de partager les dépenses de recherche, de formation, de cadre de vie ou écologiques, etc. Et cela vise toute la population du bassin ou du territoire où se trouve l’entreprise.
Cela renvoie au but de l’apport de Valeur ajoutée disponible par tête d’habitant d’un territoire donné, où se situe l’entreprise (VAd/tête d’habitant).
Cela s’oppose donc, tout particulièrement, au chômage et favorise l’emploi en coopération. En effet, une entreprise, même si elle maintenait voire si elle élevait le taux de salaire par tête employée, tout en faisant des licenciements et du chômage, s’opposerait à l’élévation de la VA disponible par tête d’habitant du bassin d’emploi.
Cela renvoie aussi évidemment, à travers les coopérations entre entreprises, aux coopérations avec les services publics non marchands.
Un but déterminant des concertations et coopérations serait un très nouveau type de plein-emploi et plus exactement, au-delà du plein-emploi traditionnel, une Sécurité d’emploi ou de formation pour toutes et tous, avec de bons revenus et de bons passages entre emplois et formations.
En outre, le but de valeur ajoutée disponible concernerait aussi la VAd « potentielle » distinguée de la VAd effective (en tenant compte des effets d’une réduction du temps de travail) et encore la VAd en volume (c’est-à-dire hors inflation) distinguée de sa distribution par les mouvements de prix.
Ces nouveaux critères de gestion d’efficacité sociale pourraient être démultipliés en des batteries d’indicateurs partiels à l’intérieur de l’entreprise, en fractionnant selon les besoins locaux les « ratios » des rapports globaux. Ils seraient utilisés, avec des pouvoirs d’intervention concertés des personnels et des populations, principalement dans les entreprises publiques et services publics marchands. Ils ont d’ailleurs déjà été expérimentés par mon ami Claude Quin à la Régie autonome des transports parisiens, avec des batteries d’indicateurs spécifiques donnant vie aux nouveaux critères.
Mais aussi, ils seraient dans une certaine mesure utilisables, dans une sorte de mixité avec les critères de rentabilité, dans les entreprises privées, grâce à des pouvoirs nouveaux des salariés et des populations et à l’impulsion de la fiscalité, du crédit, des coopérations avec les entreprises et services publics.
Ainsi ces nouveaux critères d’efficacité sociale pourraient se combiner, de façon conflictuelle mais viable et évolutive, avec les critères de rentabilité, eux-mêmes dissuadés de la recherche de la croissance financière ou des licenciements, sans reclassement convenable. En effet, avec la rentabilité, ils sont à la fois compatibles (la VA inclut le profit et l’efficacité des capitaux peut conditionner leur rentabilité) et opposés : la valeur ajoutée disponible pour les travailleurs et la population est favorisée au contraire du profit, économisée le plus possible grâce aux procédés technologiques et aux conditions de financement.
Il s’agit des Services publics qui ne vendent pas leurs produits ou prestations sur le marché, mais qui peuvent plus ou moins directement en acheter.
Ces Services ne pourraient utiliser, tels quels, les critères de gestion d’efficacité sociale que nous venons de présenter. Cependant, ils peuvent s’en inspirer et aussi développer de nouveaux principes directeurs spécifiques dans le même esprit.
Voyons, de façon extrêmement sommaire, quatre ensembles de principes, en attendant des études ultérieures à partir d’eux sur des critères et indicateurs proprement dits, notamment dans des analyses des rapports entre « coûts et effets », sur lesquels nous pourrions coopérer à partir de vos réflexions et de vos expérimentations dans le cadre du « Plan Qualité » du Service Public du Canton de Vaud.
1er ensemble : inspiration des critères d’efficacité sociale dans les interfaces avec les marchés
Côté coût : Cela concernerait les économies d’efficacité relative des moyens et charges matériels et financiers, en relation avec les dépenses pour les ressources humaines des services (salaires, formation, recherche, circulation de l’information, etc.) ainsi que de nouveaux pouvoirs de proposition des personnels et usagers ou des coopérations et partages de coûts.
Cela se rapporterait aussi aux effets induits de l’activité des entreprises ou services marchands publics ou privés. Cela comprendrait notamment les impacts sur les conditions écologiques ou d’environnement, avec leurs répercussions sur des coûts nécessaires des services publics non marchands, en liaison avec les exigences de la révolution écologique.
Côté effets : Cela concernerait les effets indirects sur l’efficacité des capitaux et les productions de valeur ajoutée disponible potentielle, par tête d’habitant, des entreprises publiques marchandes et des entreprises privées, en liaison avec de nouvelles coopérations et évaluations communes.
Cela se rapporterait tout particulièrement à l’apport aux capacités et ressources humaines des entreprises. Je laisse de côté l’articulation de ces résultats recherchés avec les conditions de financement des services, les prélèvements mutualisés éventuels, l’impact sur les tarifications, la fiscalité, le crédit aux entreprises, etc.
2e ensemble : la qualité du côté des coûts et son efficience
À l’opposé des tendances unilatérales issues de la production marchande standard, la recherche de la qualité du service apporté contredit, en apparence et dans l’immédiat, l’économie prioritaire des coûts.
Mais cela peut rejoindre, dans une certaine mesure, le problème de l’effectivité des outputs, évoqué dans notre colloque par le Pr. Knopfel, quoique de façon orientée pour améliorer cette effectivité.
En effet, la qualité effective du service rendu, qui nécessite au départ des coûts supérieurs, finit, dans le long terme et l’espace social global, par apporter des économies supérieures que l’on pourrait mesurer. C’est le cas, par exemple, de meilleurs soins de santé, plus coûteux par acte mais dont les meilleurs résultats font qu’on a moins besoin d’actes ; ou encore d’une meilleure recherche plus coûteuse et plus longue avec bien plus de résultats en définitive.
Cela se rapporterait aussi aux dépenses et concertations de prévention. C’est le cas des services de santé, non pas réservés aux pathologies déclarées, mais de plus en plus étendus à la prévention en permanence ; ou encore de la prévention écologique, etc.
Cela peut donc concerner aussi les besoins de nouveaux services, comme ceux d’aide aux études des enfants (en dehors du travail normal dans l’institution scolaire), ou encore de services en permanence aux personnes âgées (en dehors des institutions spécialisées). Cela renvoie aux exigences de la révolution de la géritude (d’allongement de la vie) démographique et parentale, avec une population moins féconde mais l’allongement de l’éducation et l’explosion du travail des femmes, etc.
Cela renvoie encore à la participation décisive aux services de ceux qui les reçoivent, sur laquelle nous reviendrons, comme tout particulièrement pour la santé et la prévention.
3e ensemble : le temps disponible, du côté des effets
L’économie de temps, rendu disponible pour la population, serait un objectif pour un critère traversant l’ensemble des services.
C’est par exemple l’économie de temps (temps d’attente, temps de trajet) pour les transports. Mais c’est aussi le temps disponible accru contre le temps d’indisponibilité par exemple pour la santé, ou encore le temps de redoublement évité contre l’échec scolaire, la réduction du temps d’attente pour les formalités administratives, pour un procès, etc.
Cette question du temps rendu disponible renvoie aussi à tout l’aménagement des temps, pour l’ouverture des services en permanence sur toute la vie, de type formation permanente ou continue des adultes.
Cela se réfère aussi aux systèmes d’évaluations non monétaires (à côté des seuls équivalences monétaires des éléments non monétaires), qu’il s’agisse des temps, ou encore des volumes physiques, des indicateurs qualitatifs, etc.
4e ensemble : les apports de la participation intercréative de tous les personnels et de toutes les populations aux services
L’intervention ainsi que la concertation horizontale et décloisonnée de toutes les catégories de personnels dans la définition et la gestion des Services sont décisives, à l’opposé de secret des informations, du monopole des décisions, de la verticalité hiérarchique, etc.
Mais aussi, et de façon corrélative, tous les sujets des populations concernées doivent pouvoir intervenir non seulement comme usagers de Services publics mais encore comme des apporteurs d’informations cruciales pour des prestations dont ils deviendraient les co-auteurs, ce qui va bien au-delà de la définition des besoins.
Il y aurait une exigence de rotation des rôles, à l’opposé des monopoles de rôle, du type « éducateurs/éduqués », « concepteurs/exécutant ou utilisateur », avec des pouvoirs de proposition et de contrôle décentralisés et concertés de tous et de toutes les générations.
Ainsi les institutions d’État, au lieu de coiffer la coordination des acteurs sociaux, comme les associations non lucratives et bénévoles dont l’importance doit être stimulée, tout en étant elles-mêmes soumises directement ou indirectement à la pression de la rentabilité financière, feraient partie d’un réseau mixte, ouvert aux interventions de tous les acteurs possibles.
D’ailleurs, au-delà de l’efficacité sociale au sens strict, évaluant des rapports « dépenses/résultats », il s’agirait avec la qualité de la vie de tous, recherchée par la qualité des Services publics insérés dans un réseau ouvert, de la participation de chacun à l’élaboration de son style de vie et à la félicité de sa vie. Dans une éthique d’intercréativité, il ne conviendrait pas de prétendre faire le bonheur des gens en dehors d’eux (de façon charitable, paternaliste ou autoritaire) mais de fournir et d’organiser, avec eux, le plus de facilités, formalisées ou non, pour qu’ils contribuent à créer eux-mêmes leur propre félicité, toutes et tous, sans exclusion et donc en solidarité.
ANNEXE : QUATRE RATIOS
1. L'efficacité du capital : VA/cmf (Valeur ajoutée/capital matériel et financier) 2. L'efficacité sociale Vad = Valeur ajoutée disponible pour les travailleurs et la population 3. La productivité orientée de tous les facteurs Vads = Valeur ajoutée disponible supplémentaire Bénéfice = Profits + Vads 4. La coopération avec comme but la population : Vad/tête de population |
* Ce texte de Paul Boccara prononcé en 1998 dans le cadre du colloque de Lausanne: «Efficacité sociale et services publics» en novembre 1997 a été repris dans Issues, n°53-54 en 1999 ainsi que partiellement dans économie et Politique en novembre-décembre 1998. Il trouve aujourd'hui une actualité renforcée par toutes les attaques de Macron et de son équipe contre nos services publics. Ainsi que par l'urgence de nouveaux services publics pour sortir de la crise systémique du capitalisme et de la civilisation.
Par Caquant Léon, le 31 May 2018

Dans une tribune parue dans le journal Les échos en 20171, Éric Le Boucher, journaliste et directeur de rédaction des Enjeux-les Échos, affirme que l’absence de culture économique des Français ne leur permet pas de comprendre les réformes portées par Emmanuel Macron.
Pire encore, l’apprentissage de l’économie leur en donne une vision tronquée !
Il affirme : « La vérité est que le lycée n’apprend pas l’économie aux Français, il lui apprend à se méfier de l’économie. Voilà pourquoi les Français ne comprennent rien aux réformes macroniennes et les “politisent” de façon caricaturale. Il faudra que le président de la République s’en préoccupe. »
Quel est donc l’apprentissage actuel de l’économie des jeunes qui les pousse tant à « politiser » les réformes et quelle direction semble prendre la rédaction des futurs programmes d’économie au lycée ?
Avant l’université ou les autres établissements d’enseignement supérieur, l’économie est étudiée pour la première fois au lycée. Les élèves peuvent l’aborder dès la classe de seconde en enseignement exploratoire et poursuivre en première et en terminale avec un bac ES (économique et social).
Ce bac est aujourd’hui choisi par de nombreux lycéens (33 % des bacs généraux en 2017), ses effectifs sont aussi en augmentation.
Les sciences économiques et sociales (SES) existent au lycée depuis 1969 (premier bac « B »).
Une place importante avait été faite à l’interdisciplinarité, les programmes avaient une approche par objet et par questionnement (par exemple concernant la notion d’inégalité : comment peut-on analyser les inégalités ?), l’économie ET la sociologie étaient alors mobilisées afin de traiter un chapitre. Les inégalités pouvaient être par exemple analysées en termes de revenus mais aussi d’inégalités d’accès à des positions de pouvoir.
En 2011, une réforme des programmes de SES a commencé à remettre en question cette logique d’interdisciplinarité. Le principe d’une séparation plus nette entre économie et sociologie a été acté, l’approche interdisciplinaire n’ayant lieu que dans quelques chapitres périphériques (les « regards croisés »), un certain recul de la sociologie a aussi été entériné.
N’en reste pas moins que les SES ont aujourd’hui une place importante au sein du bac économique et social avec un nombre important d’heures de cours ainsi qu’une diversité des thèmes abordés en classe (croissance, commerce international, développement durable, place et rôle de l’État dans l’économie, monnaie, marché etc.) permettant aux lycéens d’être formés aux sciences sociales, préparés aux études supérieures et d’être formés de manière critique à la citoyenneté.
Depuis 2017, le ministre Jean-Michel Blanquer met en place à marche forcée une réforme du lycée. Sans rentrer dans une description de cette réforme et au-delà des changements d’heures attribués aux SES ; la rédaction de nouveaux programmes devrait officiellement commencer à être discutée dès octobre 2018 (en effet, il est prévu que, dès 2020, le nouveau bac soit mis en place).
L’écriture de ces programmes risque d’être influencée par des lobbys pro-patronat parmi lesquels l’académie des sciences morales et politiques (ASMP) présidée par Michel Pébereau (ex PDG de la BNP Paribas).
Pour l’ASMP, l’enseignement actuel des SES « témoigne d’une ambition encyclopédique démesurée, illusoire, et finalement néfaste ». Les propos lors de l’un de ses colloques organisé le 30 janvier 2017 laissent entrevoir toutes les passions suscitées par l’idée que Marx puisse encore être étudié par des lycéens :
« Doit-on parler de Marx ? Pourquoi ne pas le laisser au programme d’histoire ? Qui parle encore aujourd’hui de classe sociale ? La précarité peut arriver à tous. »2
L’ASMP propose de réduire les programmes à des « concepts fondamentaux », de se recentrer sur la micro-économie3, et de parler davantage du fonctionnement de l’entreprise et des mécanismes de marché.
On apprendrait donc à des élèves à mieux gérer leur budget, à utiliser des modèles simplistes de fonctionnement d’une entreprise et surtout à en avoir une vision positive.
Dans la continuité de l’enseignement supérieur, une place plus importante serait faite à l’usage des mathématiques en économie.
Inquiétant car l’ASMP, malgré son absence de poids au sein des professeurs de SES, a l’oreille du ministre. Pierre-André Chiappori et Georges de Ménil, deux correspondants de l’Académie des sciences morales et politiques feraient partie du groupe d’experts chargé de rédiger les nouveaux programmes. Pour n’en présenter qu’un, Pierre-André Chiappori réprouvait que les manuels de SES présentent les risques sur les marchés financiers, quelques semaines avant que n’éclate la crise des subprimes !
Si le programme de SES actuel aborde de nombreuses notions et débats économiques, il ne faudrait pas non plus croire qu’un pluralisme idéologique y est présent. Si pluralisme il y a, c’est un pluralisme limité ; les débats économiques se résumant souvent à un face à face entre économistes keynésiens et néoclassiques.
Il est ainsi révélateur d’observer que la notion de capitalisme est inexistante dans les programmes actuels. Les analyses de Marx sont uniquement abordées en sociologie (analyse des classes sociales) mais jamais dans leur dimension économique. On peut d’ailleurs faire la même remarque en ce qui concerne l’université. Les libéraux qui prétendent défendre le pluralisme opèrent donc en réalité un contrôle très poussé de l’apprentissage de l’économie.
Une part très importante du programme de première et terminale est actuellement consacrée aux mécanismes de marché et laisse peu de place (et surtout de temps !) à l’étude de visions alternatives.
L’absence de pluralisme dans l’apprentissage de l’économie à l’université (rappelons que le programme de licence correspond au programme de pensée des économistes néoclassiques) risque donc d’arriver dans l’enseignement secondaire.
Cela est révélateur du fait que la bourgeoisie mène aussi la lutte sur le terrain des idées, il faut que les lycéens aient pour unique grille de lecture du monde le marché.
Il faut aussi rapprocher ces évolutions des attaques très violentes des économistes ayant une approche historique et politique (on peut notamment penser au débat ayant fait suite à la parution de l’ouvrage de Pierre Cahuc et André Zylberberg4 visant à disqualifier tous les économistes n’ayant pas leur méthode de travail en déniant la qualité scientifique même du travail des économistes hétérodoxes).
Il faudra donc être vigilant, se mobiliser pour un apprentissage de plusieurs grilles de lecture en économie au lycée. Ce sont bien les économistes marxistes et postkeynésiens qui avaient alerté de l’imminence d’une crise en 2008 quand les néoclassiques vantaient les mérites des marchés autorégulateurs, leur absence de culture économique se paie encore aujourd’hui.
Une seule certitude, c’est la mobilisation et la lutte qui paieront. L’APSES (association des professeurs de sciences économiques et sociales, de très loin majoritaire chez les professeurs de SES) avait appelé à un rassemblement le 11 avril 2018 devant le ministère de l’éducation nationale, initiative réussie mobilisant des centaines de professeurs de SES de toute la France, espérons que les mobilisations à venir. zzz
-------------------
* Pour plus d’informations concernant l’évolution de l’enseignement de l’économie au lycée, consulter la première partie de l’ouvrage de Marjorie Galy, Erwan Le Nader et Pascal Combemale, Les Sciences économiques et sociales, La découverte, 2015, pages 22 à 52.
** Professeur de sciences économiques et sociales.
1. « Macron face à l’inculture économique des Français », Les Échos, 2 novembre 2017.
2. « SES vs Académie : Premier round », article du site café pédagogique, 31 janvier 2017.
3. « Même si elle est utile, la macro-économie est encore trop présente aujourd’hui dans l’enseignement, alors que beaucoup de problèmes macro-économiques contemporains sont trop compliqués pour des lycéens. D’ailleurs, ils ne font pas l’objet d’un consensus », interview 2017 de Pierre-André Chiappori.
4. Pierre Cahuc et André Zylberberg, Le Négationnisme économique, Flammarion, 2016.
Par Tournebise Alain, Ternant Evelyne, le 31 May 2018

Conformément à la conception macronienne de la démocratie, le gouvernement poursuit sa tâche de démantèlement du groupe Alstom, au mépris des salariés et des parlementaires. Le 28 mai 2018, le ministre de l’Économie a donné son autorisation à Siemens au titre du décret sur les investissement étrangers.
Cette autorisation permet à Siemens de poursuivre tranquillement son travail d’absorption. Le futur Conseil d’administration de l’entité combinée a été présenté : comme prévu, il sera composé de 11 membres dont six (Président inclus) désignés par Siemens ; quatre administrateurs indépendants ainsi que le Directeur général compléteront le Conseil. Siemens a prévu de proposer la nomination de Roland Busch, membre du Directoire de Siemens AG, au poste de Président du Conseil d’administration de l’entité combinée. Notons au passage que Roland Busch était également devenu membre du conseil d’administration d’Atos après le rachat de la branche informatique de Siemens qu’avait piloté un associé-gérant de la banque Rothschild : Emmanuel Macron. Il aura donc ses entrées au sommet de l’État.
De leur côté, les dirigeants d’Alstom poursuivent leur plan de démantèlement au profit de leurs actionnaires et notamment du premier d’entre eux : le groupe Bouygues. On se souvient que l’accord avec Siemens prévoyait le versement d’une “prime de contrôle” de 4 € par action payés par la trésorerie d’Alstom, suivi d’un dividende exceptionnel de 4 € par action, financé par la vente de la participation détenue par Alstom dans les co-entreprises avec GE créées lors de la vente de d’Alstom Énergie.
Pour satisfaire leur actionnaire de référence, Bouygues, qui, dans l’opération, toucherait un chèque de l’ordre de 500 M€, les dirigeants d’Alstom se sont empressés de négocier avec GE la cession de leur participation dans les trois co-entreprises. Rappelons que ces trois co-entreprises avaient été créées lors de la vente d’Alstom Énergie pour qu’Alstom reste présent dans trois activités stratégiques : les smart grids, les turbines hydrauliques (avec la co-entreprise Hydro) et les turbines du nucléaire. Un accord, dont la teneur n’a pas été révélée, a été annoncé en mai 2018. La vente devrait être effective au début du mois d’octobre 2018.
Si elle se faisait, cette vente constituerait à la fois une perte de savoir-faire technologique considérable et un abandon de souveraineté nationale dans le secteur de l’énergie. Car ces trois filiales sont détentrices du savoir-faire et surtout de brevets essentiels pour notre indépendance énergétique. En particulier, c’est une de ces co-entreprises qui est détentrice des contrats de maintenance du parc nucléaire d’EDF et la commission d’enquête a révélé que depuis le rachat par GE, les relations avec EDF s’étaient dégradées en raison de problèmes de prix et de qualité des prestations de maintenance.
Les risques sont encore plus importants à l’exportation.
Comme le souligne Loïk Le Floch Prigent sur son blog : « Nous avons une politique énergétique autonome mais elle est désormais dépendante de l’attitude de General Electric, compagnie américaine qui va devoir choisir entre l’obéissance aveugle aux règles de son pays ou l’accompagnement en France et à l’étranger des intérêts français et européens -les turbo-alternateurs « nucléaires », c’est-à-dire les matériels appelés « Arabelle » conçus et fabriqués par les Français équipent plus de la moitié des centrales nucléaires mondiales. Les constructeurs de centrales nouvelles sont majoritairement aujourd’hui les Chinois et les russes. Quelle peut-être la réponse de General Electric à une demande de Rosatom (le Russe) d’acquérir un matériel Arabelle ? Regardons avec attention les accords General Electric-Alstom bénis par les pouvoirs publics français, la réponse n’est pas évidente.
Le département hydraulique d’Alstom est en fusion avec un dégraissage de moitié de l’effectif mondial. Mais c’est une compétence française d’excellence et des équipements de « premier mondial ». Les pays concernés par une augmentation de cette « énergie renouvelable » sont en priorité l’Iran, la Russie et les pays de l’Est ex-soviétiques.
General Electric n’est pas dans la meilleure position… politique… pour soutenir ces activités et recherche des candidats. Si ces candidats sont chinois, que faisons-nous ? Si ce sont les concurrents allemands ou autrichiens qui arrivent, quelle sera notre réponse ? »
Mais comme l’a révélé la commission d’enquête parlementaire, la question ne semble préoccuper ni Macron ni Le Maire. Ce dernier fait d’ailleurs une grande confiance à l’américain. « S’agissant de GE, j’ai l’impression que vous en faites le grand méchant loup… C’est un peu trop facile de faire peur aux gens en leur disant : « Attention, GE vous menace, c’est le grand méchant loup ! », a-t-il répondu aux parlementaires.
Il y a pourtant lieu de s’inquiéter. Le groupe qui a changé de patron sous la pression de la bourse l’été dernier a subi des pertes records en 2017. Il cherche par tous les moyens à réduire ses coûts. Pour cela, il continue d’élaguer son portefeuille activités, avec l’objectif de se séparer d’activités représentant au moins 20 milliards de dollars, dans le cadre d’un plan de restructuration sur trois ans. Il n’est donc pas exclus que GE ne vende ces activités au plus offrant. À qui sera dévolue la maintenance et le développement des activités nucléaires françaises ? Qui récupérera les brevets des turbines nucléaires, hydrauliques ou éoliennes ?
La confiance aveugle de Le Maire en GE est décidément mal placée. En France, GE, en dépit de ses engagements, n’a créé que 365 emplois en trois ans. Si l’on inclut les suppressions d’emploi à Grenoble, le solde est donc nul. GE avait pourtant promis de créer 1 000 emplois d’ici à la fin 2018. Cela n’a pas empêché Bruno Le Maire de répéter pendant des mois qu’il veillerait au respect des engagements pris par GE. Jusqu’au 14 juin 2018 où le PDG de GE lui-même a annoncé qu’il ne tiendrait pas ses engagements d’emploi. Un joli bras d’honneur qui en dit long sur l’estime dans laquelle le groupe américain tient le gouvernement français.
Seule réaction de Le Maire, son intention de faire payer la pénalité prévue. En effet, le non-respect de ses engagements est assorti d’une pénalité de 50 000 euros par emploi non créé. Dérisoire…
Il est donc vital, pour l’indépendance nationale, pour le maintien et le développement d’une filière industrielle en France et pour préserver l’emploi, de poursuivre la bataille pour empêcher l’absorption d’Alstom par Siemens.
Un pognon de dingue !Le bradage d’Alstom aura été une bonne affaire pour le groupe Bouygues. Tout a commencé avec le ministre de l’économie et des finances N. Sarkozy en 2006 qui, pour limiter la participation d’état, a fait rentrer son ami Bouygues dans le capital. Ce dernier avait pour ambition de mettre la main sur la filière nucléaire, en commençant par Alstom, et en finissant par Areva, qui se portait bien à l’époque. Bouygues a mis 2 milliards dans Alstom, pour 20 % du capital. Il en détient aujourd’hui 28,3 %. Voici le décompte des sommes récupérées ou à récupérer par Bouygues avec cette participation dans le capital d’Alstom : 377 millions de dividendes courants entre 2006 et 2016 ; 1 milliard en février 2016 de dividendes extraordinaires pour la vente d’Alstom énergie à GE ; au moins 495 millions en 2018 de dividendes extraordinaires (8 € par action) financés par la trésorerie d’Alstom et par le retrait des co-enteprises Alstom-GE. Cela fait 1,872 milliard de dividendes en 10 ans pour un investissement de 2 milliards. Soit un rendement annuel de plus de 7 %. Bouygues peut remercier son ami Sarkozy. Mais l’actionnaire principal sait aussi être généreux avec ceux qui l’ont bien servi. La revente de la branche Énergie d’Alstom à GE apportera à 21 dirigeants d’Alstom un bonus additionnel de 30 millions d’euros dont un peu plus de 4 millions d’euros pour le seul Patrick Kron. Certes, c’est seulement 1,6 % de son gain total, mais un bon pourboire tout de même… |
En bande organiséeComme à la chasse à courre, au sommet de l’État le dépeçage du gibier se fait entre amis. Ainsi, le dépeçage d’Alstom a été prémédité et méticuleusement exécuté par un petit groupe de compères, membres actifs des deux cénacles affairistes qui aujourd’hui règnent sur l’économie et la politique française : le groupe Bouygues et le banque Rothschild. À tout seigneur tout honneur, commençons par le premier d’entre eux, Emmanuel Macron. C’est lui qui, ministre de l’économie, a autorisé l’opération de rachat de la branche énergie d’Alstom par General Electric le 5 novembre 2014. Mais, comme l’ont révélé la commission d’enquête parlementaire, Mediapart et Le Canard Enchaîné, il en avait déjà lui-même tracé les grandes lignes dès 2012, en s’inspirant du rapport A.T. Kearney qu’il avait commandé en tant que secrétaire général adjoint de l’Elysée. Emmanuel Macron a été associé-gérant de la banque Rothschild de 2008 à 2012. Il y avait notamment travaillé au rachat par Atos de la branche informatique de… Siemens. Selon ses propres mots, il y avait gagné “de quoi être à l’abri du besoin jusqu’à la fin de ses jours” Grâce à l’absorption d’Alstom par Siemens, Bouygues s’apprête à percevoir un dividende exceptionnel de près de 500 M€. Car quelques années auparavant, c’est le prédécesseur d’Emmanuel Macron, François Perol, alors secrétaire général adjoint de l’Elysée sous Sarkozy, qui avait négocié avec Bruxelles l’entrée de Bouygues au capital d’Alstom, à hauteur de près de 30 %. Avant d’être au secrétariat général de l’Elysée, François Perol était associé gérant à la Banque Rothschild de 2005 à 2007 Comme l’a souligné le président de la commission d’enquête parlementaire, la vente d’Alstom Energie à GE s’est faite au bénéfice essentiel de Bouygues et de GE. « Si cette fusion représente un projet industriel, c’est celui de GE qui réalise une opération de croissance externe. Côté Alstom, elle exprime le projet financier (légitime) de son actionnaire, et côté État, elle n’exprime qu’un laisser faire. » On imagine assez bien que la négociation n’a pas été très tendue. D’ailleurs elle a été bouclée en quatre mois. Et pour cause, les deux acteurs opérationnels de la vente d’Alstom Energie à General Electric, le PDG d’Alstom Patrick Kron et le PDG de GE France Clara Gaymard se connaissent bien. Ils se côtoient régulièrement dans les fauteuils… du Groupe Bouygues. Patrick Kron est administrateur du groupe Bouygues depuis 2006. Clara Gaymard, elle, a été nommée au Conseil d’Administration de Bouygues le 21 avril 2016 quelques mois après l’acquisition d’Alstom Energie. Soyons juste, le Groupe Bouygues s’efforce tout de même de renouveler périodiquement son conseil d’administration. Dernière nomination en date, en avril 2017, celle d’Alexandre de Rothschild, PDG de la banque Rothschild... |
Par Bordes Jean-Jacques , le 31 May 2018

Ambition universelle, transition alimentaire, croissance, transformation, digital ; des concepts qui reflètent bien la capacité du capitalisme à capter pour son profit les tendances sociétales. Il en va ainsi de la demande pour une alimentation plus saine et l’utilisation des technologies numériques.
Bien sûr, le volet compétitivité et productivité n’est pas occulté. Il constitue l’axe de cette inflexion stratégique (fermeture du siège du groupe, suppression de 2 400 postes en France, réduction des coûts de 2 Md€, abandon de 273 magasins de proximité…). Mais la terminologie utilisée vise à faire accepter deux idées :
– Le groupe serait en phase avec les nouveaux modes de consommation, d’où l’abandon de positions comme celles acquises avec les magasins ex-DIA,
– Il aurait besoin de reconstituer des marges de manœuvre financière pour accompagner cette mutation, d’où les investissements dans la filière Bio et les économies recherchées sur le dos des personnels.
La transition alimentaire
Que nous dit l’éminent PDG Alexandre Bombard (ex FNAC- DARTY) ?
« Les modes de production intensifs ont atteint leurs limites. Les consommateurs n’ont jamais été aussi préoccupés par ce qu’ils mangent. Ils veulent à juste titre plus d’informations, de qualité et de transparence, sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. Carrefour veut désormais porter un combat : celui de la transition alimentaire pour tous. »
Vous l’avez rêvé, Carrefour va le faire !
Comment ne pas souscrire à l’investissement que le groupe va faire dans la filière Bio ? Comment ne pas applaudir à son ambition de promouvoir les producteurs locaux ? Comment ne pas acquiescer à son objectif de transparence ?
Mais comment ne pas être inquiets pour les producteurs (et in fine les consommateurs) lorsqu’il déclare : « Carrefour utilisera ses politiques de prix, de promotion et de fidélisation en faveur de la démocratisation du bio. » ?
On ne peut qu’être également dubitatif quand il annonce : « Un soutien financier et durable à la conversion au bio d’agriculteurs : Carrefour annonce ce jour un partenariat avec WWF sur le financement de la conversion au bio et la création d’un étiquetage spécifique WWF ». Ou bien : « La mobilisation de la Fondation Carrefour pour financer des projets d’agriculture biologique ».
De son côté, le groupe Leclerc affiche lui aussi l’ambition d’être le numéro 1 du Bio en 2020.
Les producteurs et les consommateurs de produits Bio sont souvent désireux de s’évader du système de la grande distribution, Carrefour entend, comme les autres groupes, à les y faire « revenir par la fenêtre ».
Investissement massif sur le digital
Les consommateurs désertent de plus en plus les hypermarchés parce qu’ils ne souhaitent plus y consacrer autant de temps. Les grands de la distribution ont beau multiplier les concepts de rayonnages, de galeries marchandes ou d’animation, les chiffres d’affaires de ces grandes cathédrales de la consommation reculent. Les groupes comme Carrefour ont bien saisi le phénomène et mobilisent les nouveaux outils numériques et les offres de proximité pour séduire les internautes.
Carrefour investira ainsi 2,8 Md€ sur 5 ans (soit « six fois plus que les investissements actuellement consentis », dixit le PDG) pour changer de dimension sur le numérique. Il vise un objectif de 5 Md€ de chiffre d’affaires dans l’e-commerce alimentaire d’ici 2022 (850 M€ en 2017).
Il y en aura pour toutes les aspirations :
– La livraison à domicile : surfant sur le développement de la livraison rapide et avec son accord avec Stuart filiale de La Poste, carrefour veut étendre en France, la livraison à domicile à 26 villes et la livraison express en 1h dans 15 villes dès 2018.
– Le Drive : dès 2018, 170 nouveaux Drive seront ouverts en France et la qualité de service améliorée, notamment grâce à des moyens logistiques automatisés.
– Le Click & Collect (commande internet et retrait en magasin) : plus de la moitié des magasins dès 2019.
Le corollaire à cette nouvelle offre (pas si nouvelle que ça) réside dans une nette déshumanisation de la relation au client, l’automatisation des procès et une mutation des métiers.
Faut-il rappeler que le « e-client » communique également son profil d’acheteur (ce que le groupe traduit par : « identifier les habitudes d’achats et les préférences », ou « passer à une communication ciblée ».
Mondialisation
Le groupe Carrefour représente 12 300 magasins, 380 000 salariés et 88 Md€ de chiffre d’affaires dans 30 pays. Mais il n’est pas inutile de considérer que près de la moitié de l’activité (45 %) se situe en France.
Si le plan entend se débarrasser de 273 magasins de proximité en France, il vise à en ouvrir 2 000 dans les 5 prochaines années dans les grandes métropoles.
Le groupe ne s’adapte donc pas qu’aux nouveaux comportements d’achat, il cherche également à profiter des zones de croissance.
Il s’appuie pour cela, sur une grande part des profits réalisés en France et en Europe, pour se déployer dans les autres zones du globe.
Tout cela pour : « Conserver une structure financière solide et maintenir une politique de dividendes inchangée soit un taux de distribution de 45 à 50 % du bénéfice. »
Constatons en premier lieu que malgré ses développements à l’étranger, Europe, Asie et Amérique Latine, le groupe Carrefour réalise toujours près de la moitié de son chiffre d’affaires en France.
Malgré les difficultés de croissance des grands de la distribution, notamment du côté des hypermarchés, le groupe parvient à faire progresser son chiffre d’affaires consolidé en 2017 de 2,6 % (cf. annexe 1).
C’est en Amérique latine (Brésil particulièrement) qu’il réalise la meilleure performance avec un bond de 10,6 % malgré les difficultés persistantes en Argentine.
Le deuxième contributeur à la croissance est la zone des autres pays d’Europe (particulièrement dans les pays du nord) avec un CA en hausse de 5,1 %.
En Asie, le groupe est clairement en perte de vitesse avec un CA en recul de 4,4 % et de 11 % en deux ans. Cela explique l’accord passé avec deux opérateurs locaux que le groupe présente ainsi : « La prise de participation potentielle dans Carrefour Chine de Tencent, leader technologique mondial, et Yonghui, distributeur spécialiste du frais et des petits formats en Chine, ainsi que la signature d’un partenariat stratégique avec Tencent, ouvrent de grandes opportunités pour Carrefour dans ce pays, notamment sur le e-commerce alimentaire. »
En France, le chiffre d’affaires épouse une trajectoire assez plate, ce qui n’est pas une mince performance compte tenu du contexte de désamour vis-à-vis des hypers et de l’agressivité de la concurrence. Il reste que l’intégration des ex-magasins DIA aura été un échec puisque la hausse de chiffre d’affaires qu’ils ont apporté est quasiment résorbée en 2017.
La faute aux magasins ou à la stratégie d’absorption adoptée ?
Carrefour n’aura pas été le premier groupe de distribution à être confronté à des difficultés d’intégration d’une acquisition. Ce cas mériterait une analyse plus profonde car Carrefour entend continuer sa politique de croissance externe (cf. acquisition de Quitoque en mars 2018 : 60 salariés dans les paniers repas).
Enfin, on soulignera que la productivité (mesurée par le CA/salarié) reste très élevée en Europe. Ce ne sont donc pas les salariés qui sont le premier facteur de pression sur la rentabilité mais les marges commerciales (cf. annexe 2).
Le groupe offre une rentabilité élevée malgré le contexte difficile de la grande distribution. Il n’y a qu’en Asie où le retour sur investissements n’est pas là (cf. annexe 3).
Ainsi, de 2011 à 2017, le groupe a dégagé 17,5 Md€ d’autofinancement, qu’il a utilisé pour :
– 14,8 Md€ aux investissements ;
– 2,5 Md€ aux dividendes aux actionnaires ;
– 1,3 Md€ en restructurations (dont la moitié au cours des trois derniers exercices et en grande partie pour DIA).
Sa situation financière est excellente puisqu’il dégageait, à la fin du dernier exercice, 3.6 Md€ de trésorerie nette :
– 7,5 Md€ de trésorerie et quasi-trésorerie ;
– contre 3,9 Md€ de dettes financières à moins d’un an.
Le groupe fait appel, pour sa politique de croissance externe et d’investissements, à des financements longs au travers d’emprunts obligataires.
Le montant des emprunts, à fin 2017, avoisinait 7,4 Md€ (à comparer à des capitaux propres de 12,2 Md€). Les échéances s’étalent jusqu’en 2025, à raison de 1 Md€ par an.
Disposant par ailleurs de facilités de crédit pour 2,2 Md€ à échéance janvier 2022 et de 1,4 Md€ à maturité 5 ans (2022), le groupe n’a pas de difficultés à solliciter les banques, d’autant plus que :
– la charge de la dette ne représente que 0,4 % du chiffre d’affaires ;
– et est en constante réduction depuis 2013 (cf. annexe 4).
En guise de conclusion
Carrefour, comme Leclerc ou Auchan, est confronté à des modifications de comportement de la part des consommateurs : économie de temps, achats par internet, fragmentation et réduction du panier moyen, demande de circuits courts, etc.
Le groupe, qui a des objectifs de maintien de sa rentabilité, utilise plusieurs vecteurs :
– réduction des coûts ;
– investissement des nouvelles pratiques d’achat ;
– automatisation ;
– croissance externe à l’international ;
– croissance externe dans d’autres métiers périphériques ;
–…
La restructuration mise en œuvre ne répond, ni à des difficultés financières, ni à une absence de résultats en France et ailleurs (sauf en Asie).
Il n’y avait donc pas d’urgence à restructurer et la mutation pouvait très bien s’opérer en conservant les personnels et en leur permettant d’accompagner celle-ci tout en restant dans le groupe.
Il est ainsi anachronique de constater que le groupe va « investir » dans un plan social, formations de reconversion à l’appui, alors qu’il n’a pas consenti les efforts nécessaires auparavant pour assurer l’« employabilité » de ses salariés. On en voudra pour preuve l’indigence de l’effort de formation (graphique ci-dessous), alors que c’est un secteur en pleines mutations.
12 heures par an en moyenne et par personne ! Sachant que, d’une part, ce sont souvent les cadres ou ceux qui y sont les plus ouverts qui en bénéficient le plus, et que, d’autre part, les entreprises intègrent dans leurs budgets de formation des actions éloignées de la formation qualifiante, cela laisse peu de possibilités pour les employés de maîtriser leur évolution de carrière.
Ceci nous amènera à nous interroger sur le contenu des métiers, les passerelles entre les filières, le lieu de création de la valeur ajoutée.
Dans le cas de Carrefour (mais Leclerc et Auchan sont sur la même trajectoire), est-ce que le développement de l’offre Bio peut s’exonérer de l’information et du conseil au consommateur ? Peut-on imaginer que la relation avec les producteurs puissent persister à ne privilégier que le prix ? Comment ne pas envisager alors qu’il y a là des reconversions à proposer aux salariés vers des métiers plus qualifiants ?
Si l’on considère que le modèle économique de la grande distribution va continuer d’évoluer, la formation est un axe majeur d’anticipation de protection de l’emploi qui ne peut qu’être mis en avant par les représentants du personnel.
L’autre interrogation portera sur l’intégration (l’échec de l’intégration) de DIA. Quelles ont été les conditions opérationnelles de l’intégration de ces magasins ? Quels étaient les objectifs initiaux ? Comment la culture et les modes opératoires ont-ils été respectés ?
Les objectifs de rentabilité conduisent le plus souvent à opérer des harmonisations (systèmes d’informations, politiques d’achats, rémunérations des commerciaux, absorption d’enseignes, etc.) à marche forcée. Est-ce que c’est ce scénario qui a été à l’œuvre pour DIA ?
Il serait intéressant de connaître ce qu’en disaient les salariés au moment de l’opération et les points de vigilance (alerte ?) qu’ils avaient émis pour ne pas reproduire les mêmes difficultés.
Cela pose la question de la consultation des salariés et de leurs représentants et de la prise en compte de leurs avis.
Enfin, ce cas interroge sur l’interaction entre les stratégies des grands de la distribution et l’urbanisation. Après avoir investi les périphéries d’agglomérations, ils quadrillent les centres villes. Est-ce anodin pour les populations ?

---------------
* Cette analyse a été produite à partir des publications du Groupe : communiqués, et documents de référence pour l’essentiel. Les données sont exprimées en millions d’euros, sauf rare exception. Les textes en italiques sont des citations du groupe.